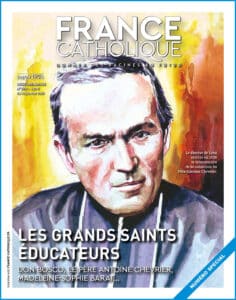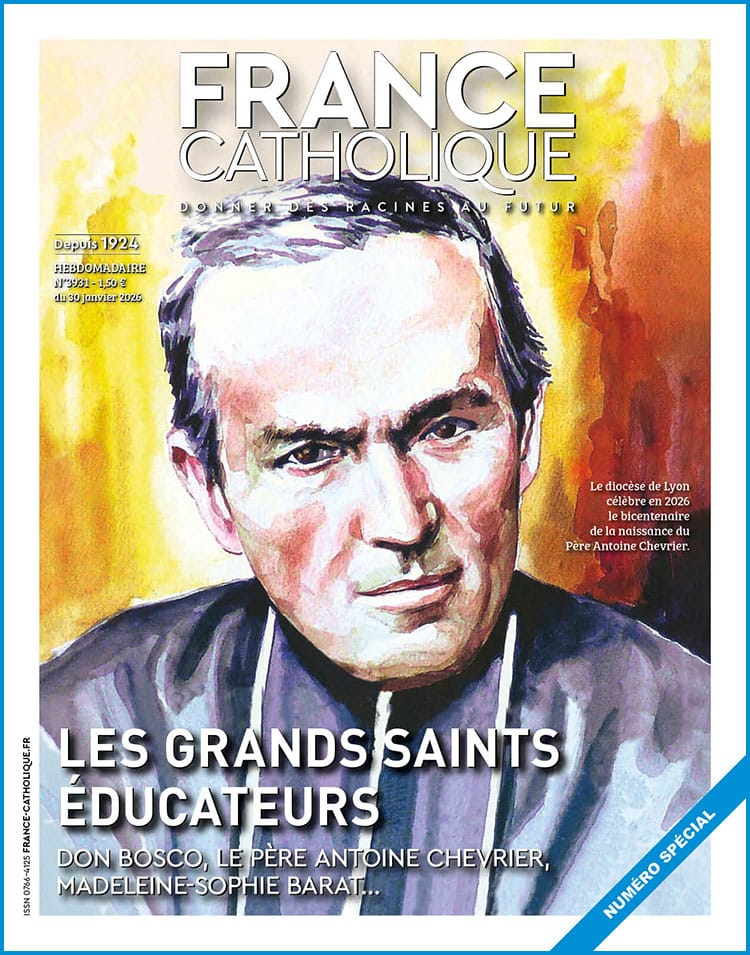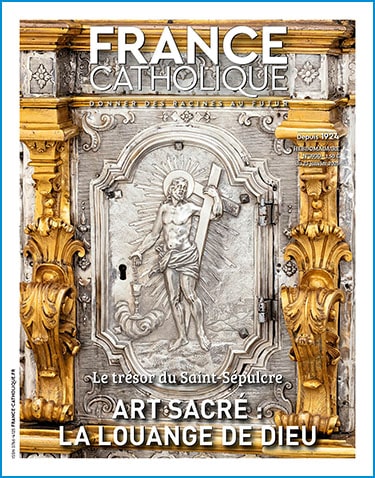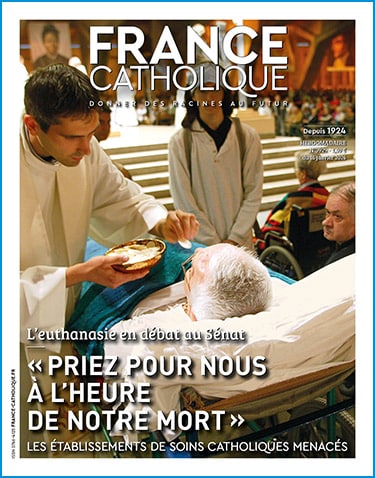Je viens de prendre connaissance de l’étrange recension que le P. Gitton publie sur votre site du livre du P. Gallez, Le malentendu islamo-chrétien, et j’entends bien m’expliquer avec vous à ce sujet. Je m’étais permis de signaler à Mr Yves Floucat toutes les faiblesses de ce livre et je sais que le site en avait publié son appréciation critique ainsi que la réponse du P. Gallez, sans que rien n’en soit publié dans les colonnes de France Catholique. Or voici que le P. Gitton en fait l’éloge global, sans en analyser le contenu, alors qu’il n’en cite rien et oublie de signaler que « la mystique du dialogue » n’est pas une invention de L. Massignon, mais bien une décision du Concile Vatican II (Nostra Aetate), reprise par Paul VI, Jean Paul II et Benoît XVI. Rien n’est cité de leurs textes essentiels en la matière.
Dites-moi pourquoi le P. Gallez, en son livre, ne cite rien du Document Nostra Aetate ? Est-ce faire œuvre d’Eglise ? Qui plus est, si vous lisez son livre (je l’ai fait, plume à la main), vous verrez qu’il ne propose rien de concret en vue du « dialogue de salut » dont il est trop souvent parlé. Je vous offre la recension détaillée que j’en ai faite pour nos responsables d’Eglise. Je vous invite aussi à prendre connaissance de mon livre Dialoguer avec les musulmans : une cause perdue ou une cause à gagner ? (Téqui, 2011), pour mieux connaître et comprendre mes sentiments et ceux de ceux et celles qui sont engagés existentiellement dans ce dialogue depuis plus de 50 ans. En toute amitié.
Père Maurice Borrmans
Edouard-Marie Gallez, Le malentendu islamo-chrétien, Postface de Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon, Paris, Salvator, 2012, 222 p.
Prêtre catholique de la Communauté Saint Jean, théologien spécialiste en histoire religieuse, E.-M. Gallez est l’auteur d’une thèse importante qu’il a publiée sous le titre Le Messie et son prophète (Editions de Paris, 2005, 2 tomes) qui fait remonter l’islam à un « postchristianisme judéo-nazaréen », lequel serait contemporain des origines mêmes du christianisme. C’est au nom de son approche historico-critique qu’il met en cause le dialogue islamo-chrétien tel qu’il a été vécu depuis 50 ans : selon lui, il y aurait « urgence à changer de cap » car ce dialogue n’a jusqu’à présent produit aucun fruit, d’où le titre de ce livre, Le malentendu islamo-chrétien. On s’efforcera donc d’en résumer loyalement le contenu avant d’en proposer une évaluation sereine et critique pour un meilleur service de ce même dialogue.
Selon l’Introduction (7-11), « nous sommes, dit l’auteur, face à un triple désert. Celui-ci fonde l’affirmation fondamentale de l’islam : la révélation coranique ne doit rien ni au passé judéo-chrétien, ni à son messager présumé ; elle doit tout à Dieu. Pour lui, la raison humaine se trouve face à un dilemme. Ou bien on entre en harmonie avec une logique islamique a contrario, ou la révélation coranique divine sert de conclusion en fonction de laquelle ses conditions d’apparition sont imaginées (le triple désert) ; ou bien on cherche ce qui s‘est réellement passé (selon la méthode historico-critique). Les protagonistes occidentaux des dialogues islamo-chrétiens officiels ont fait indubitablement le premier choix. Ils espéraient en tirer des avancées en terme de rapprochement. Ces rapprochements se sont-ils réalisés, ou est-ce l’inverse qui s‘est produit ? » Le livre a pour but de prouver que c’est « l’inverse qui s’est produit ».
Le ch. 1 (13-27) parle d’ Un dialogue islamo-chrétien en crise. Se fondant exclusivement sur les propos de Benoît XVI à Assise, le 27 octobre 2011, et passant sous silence ce que Jean-Paul II a pu y dire, il insiste sur la nouveauté de « se retrouver ensemble en marche vers la vérité », preuve de « la volonté (du Pape) de changer de cap », alors que « la seule volonté du pape et de quelques conseillers ne pouvait pas suffire à réorienter une pratique du dialogue érigée en système de pensée depuis un demi-siècle, et à propos de laquelle il est permis de s’interroger : quels sont les fruits de cette pratique ? » Selon l’auteur, ils seraient inexistants et il n’y aurait pas eu de crise « si l’Eglise d’Occident avait gardé des liens vivants avec les chrétiens d’Orient. Le contexte des années soixante, dit-il, (expliquerait que les) structures de ‘dialogue’ dans l’Eglise latine (aient ajouté, à ce système de pensée), le dédain pour la recherche historique en islamologie, (car) l’enthousiasme de la période postconciliaire prêtait davantage au rêve et à la contestation qu’à une recherche rigoureuse ». Pour l’auteur, « la pensée théologique occidentale a continué à s’enfermer dans des jeux d’abstractions et de spéculations, ce qui l’a amené à penser que l’opposition séculaire entre l’islam et le christianisme proviendrait d’une incompréhension mutuelle (tout en reconnaissant que), de fait, celle-ci était aussi réelle du côté du clergé latin que du côté du musulman moyen ». Et d’accuser « les dialoguistes » de prendre pour argent comptant les affirmations islamiques et de manquer d’un « minimum d’honnêteté » dans leur présentation de l’islam. Tout le chapitre est du même ton, avant d’affirmer que « les intentions conviviales du ‘dialoguisme’ ont toujours été accompagnées d’un objectif théologique, tel qu’il apparaît dans la théologie des religions : celle-ci forme indubitablement le cadre idéologique des dialogues islamo-chrétiens. Cette pensée théologique s’est donnée ce nom et se diffuse notamment dans les lieux de formation qui, en France, portent précisément le nom d’Instituts de Science et de Théologie des Religions (ISTR), fondés en marge des Instituts catholiques. Son projet est-il de discerner, par des études rigoureuses, ce qui serait bon dans telle ou telle tradition religieuse, en faisant la part entre ce qui y serait marginal ou essentiel ? Ceci n’est vraiment pas central dans cette théologie. Son propos apparaît bien davantage de promouvoir les religions « autres » (que chrétienne) au rang de religions inspirées, voire révélées ». Comme on le voit, l’accusation est grave, tout comme les affirmations du chapitre s’avèrent infondées. Rien n’y est dit des études et des déclarations du Secrétariat (romain) pour les Non Chrétiens, fondé en 1964, devenu le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interrreligieux (CPDI), en 1988, telles celle de 1984, « Attitude de l’Eglise catholique devant les croyants des autres religions » et celle de 1991, « Dialogue et annonce : réflexions et orientations concernant le Dialogue interreligieux et l’Annonce de l’Evangile ». Sont passés sous silence le Rapport « Le christianisme et les religions » de la Commission théologique internationale (1996) et l’encyclique de Jean-Paul II, « Redemptoris Missio » (1990), alors que le document « Dominus Jesus » est à peine effleuré. L’auteur semble enfin ignorer que le CPDI a toujours eu des membres, consulteurs et experts tant d’Orient que d’Occident et que des Orientaux y ont eu la charge du dialogue avec l’islam : François Abou Mokh (1975-1978), Antoine Mouallem (1979), Martin Sabanegh (1980-1985) et Khaled Akasheh (1995 à nos jours). Le Père Gallez voudrait-il intenter un procès d’intention tant aux hommes qu’aux institutions qui, depuis 1964, n’ont cessé de correspondre aux textes de la Constitution « Lumen Gentium » (§ 16) et de la Déclaration « Nostra Aetate » ( §3) dont nulle citation n’est faite en ce livre qui prétend résoudre la crise dont souffrerait le dialogue islamo-chrétien ?
Le long ch. 2 (29-86) met en question L’élaboration du concept du ‘non-chrétien’. Il en faut résumer la substance, après que le ton en ait été donné dans le ch. 1. Critiquant « un vieux désir de classifier l’humanité », l’auteur considère qu’ « un tel concept négatif est complètement fictif ; il est vide et conduit à trois impasses car conceptuellement, on en vient donc à scinder le bloc des non-chrétiens entre ceux qui, dès cette terre, sont sauvés, et ceux qui ne le sont pas ». Et lui d’égratigner l’encyclique « Ecclesiam Suam » de Paul VI (1964) dont il critique la répartition religieuse de l’humanité et sa volonté d’évaluer les religions en fonction d’une « vision en dégradé de (leur) contenu catholique ». Selon l’auteur, à la question : dialoguer « avec des gens réels ou avec leurs systèmes de pensée présumés ? », la « théologie des religions » dont il récuse les variantes, les méthodes et la finalité, a pensé plus judicieux de débattre de « leurs systèmes ». Il critique, à juste titre, avec « le mythe de la violence religieuse », la fausse attribution de celle-ci aux religions au nom d’une laïcité dont il constate qu’elle aussi ne garantit ni la tolérance ni la convivialité. Affirmant, à propos du Concile Vatican II, que « cette manière dialectique d’opposer le nouveau et l’ancien tente chaque génération chrétienne », il en illustre la pleine réalisation dans « la dogmatique islamique » et dans « la dogmatique laïciste » (les Lumières) qu’il considère comme étant les deux « postchristianismes » possibles, le « messianiste » et le « gnostique ». Pour lui, l’histoire s’articulant autour de la Révélation chrétienne, il y a donc « ce qui est préchrétien » et « ce qui est postchrétien » : aussi, dit-il, « parer les adeptes de postchristianismes de valeurs et de vérités telles qu’elles existaient dans le monde au temps des Apôtres, c’est se tromper gravement d‘époque » . Selon lui, une phrase de « Lumen Gentium » (n° 16) offre une malheureuse ambiguïté en parlant alors de « préparation à l’Evangile ». « Dès la fin du 1er siècle »,dit-il, les deux postchristianismes fondamentaux se sont déjà structurés (les premières hérésies), celui de la gnose, spiritualiste et individualiste » (salut personnel par soi-même) (relayée par tous les humanismes et laïcismes contemporains) « et celui du messianisme » (ici, le mal à extirper n’est pas d’abord dans l’homme individuel mais dans les structures du monde, d’où sa dérive politico-eschatologique) : pour l’auteur, comme le démontrera sa thèse (ch. 6), l’islam en est la manifestation paragdimatique. Et devant « l’impasse » qu’il attribue à « la théologie des religions (opposer le particularisme supposé du Jésus historique à l’universalisme du Christ qui sauve) », il lui reproche de « fonder son discours sur le pluralisme des voies de salut ».
Le ch. 3 (87-110) entend analyser la relation qu’il y a entre Salut personnel et présupposé théologique. Il accuse « la théologie latine » de réduire le salut à un acte d’adhésion, qui devrait être exprimé avant la mort. Il reproche à la « théologie des religions » « la sacralisation de celles-ci » et s’étonne de voir tant saint Thomas d’Aquin que les cardinaux Journet et Cottier admettre une foi implicite ou inchoative (« éclairage ambigu du thomisme, conception réductrice et contradictoire de la foi »). Pour lui, « l’abandon des limbes » par Benoît XVI renvoie au mystère d’un salut possible postmortem (« Le Christ est descendu aux enfers »). Oubliant que toute la théologie le dit aussi, il rappelle que le Pape insiste sur « la ‘théologie de la rencontre’ avec le Christ qui sauve, si bien que celui qui meurt rencontre Jésus dans la descente aux enfers qu’il a vécue en son âme humaine (c’est le jugement particulier) et que pour ceux qui n’ont pas encore rencontré le Christ, la vie terrestre n’est pas le lieu du salut mais celui de sa préparation, et la providence n’en est pas absente » (en « cherchant » et en « faisant la vérité »). « En conclusion », dit l’auteur, « il ressort que le dialogue islamo-chrétien tel qu’il a été imaginé dans l’Eglise occidentale se place dans un vieux contexte théologique étonnamment discutable, et qui ne la préparait pas du tout au défi ‘interreligieux’, en particulier par rapport à l’islam, pour plusieurs raisons : l’absence de réflexion sur les postchristianismes comme tels, le manque de rationalité des raisonnements qui refusent de regarder sur quels présupposés ils sont bâtis, la mise à l’écart des chrétiens orientaux », toutes choses qui auraient, selon lui, engendré « une intelligentsia déjà prête à l’islamophilie » ! Mais comment peut-il lui reprocher un manque de rationalité alors qu’il l’accuse d’avoir mis la foi au service de la raison et la Bible à la mesure de l’exégèse ? L’accusant de « faire dépendre le salut d’une intentionnalité qui établirait un lien imaginatif-mémoriel avec l’événement historique de la Passion », il oublie, à ce propos, tout ce que dit le Concile Vatican II du salut en Jésus-Christ.
Le ch. 4 (111-124) s’en prend à Louis Massignon et aux « massignoniens » : Massignon et le dialogue islamo-chrétien pratiqué par ces derniers seraient étroitement co-responsables de la crise actuelle. Selon l’auteur, « la méconnaissance profonde de l’islam » est ce dont souffraient et souffrent « les universitaires parisiens ou les clercs romains » ! Et d’attribuer « le rôle déterminant » de L. Massignon à « une mystique fondée sur une expérience » (serait-elle fausse ?) qui se cristalliserait en « trois commotions (Dieu juge, Dieu amour, Eglise mystico-spirituelle attirant tous les hommes en son unité) », d’où sa vision d’ « une communion ‘mystique’ avec les musulmans, une communion pour le salut qui se placerait pour ainsi dire au-dessus du christianisme et de l’islam : il l’exprimera dans l’idée de la paternité abrahamique, supposée être commune entre chrétiens et musulmans ». N’ayant pas tout lu des livres qui parlent de L. Massignon et n’ayant pas pris connaissance de tous ses écrits, l’auteur se contente d’insister injustement sur les rapports étranges de L. Massignon avec Huysmans et Boullan et sur leur doctrine du « rachat » humain des autres par la « substitution rédemptrice », ce qui est bien mal comprendre L. Massignon lui-même, car c’est Jésus Christ qui est pour lui l’unique compatient, sauveur et juge de l’heure ultime. Rien n’est dit de sa fraternité spirituelle avec Charles de Foucauld, dont il se disait le disciple, et Jean-Mohammed Abd-el-Jalil, dont il était le parrain. Et peut-on l’accuser d’avoir été « inattentif aux chrétiens d’Orient » alors que sa sodalité de la Badaliya (1947-1962) a été fondée avec eux et pour eux (il suffit d’en lire les textes) ? « Aujourd’hui encore, dit l’auteur, ce terme (badaliya, substitution en arabe) forme la référence de la pensée de ses adeptes et du dialogue islamo-chrétien tel qu’ils le conçoivent ». Les « dialoguistes » s’inscriveraient ainsi dans la foulée de ses « illuminations », dues au « gnostique al-Hallâj » et confortées par l’ « amie Cairote, spirite », que serait Mary Kahil ! Selon l’auteur, Massignon aurait circonvenu et Pie XII et Paul VI et après sa mort, surtout du fait de l’absence de pensée islamologique étayée dans les milieux romains, sa pensée perça au point de s’institutionnaliser, notamment par la création du PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica)! Tel est l’étrange procès injustement fait aux « dialoguistes », surtout quand on se permet une note totalement fausse à leur sujet (p. 120).
Le ch. 5 (125-142) fait le bilan de La recherche islamologique : histoire et impasses en Occident, car « en Orient, autant qu’ils étaient libres de le dire, les chrétiens (« les araméens mais non les byzantins », sera-t-il précisé) ont toujours transmis que l’islam provient d’une ‘dérive’ d’origine chrétienne, que les pires potentialités de l’islam ne restent jamais longtemps latentes et que ‘l’évolution de l’islam’ est une illusion idéologique occidentale ». Et l’auteur de refaire une brève histoire de l’orientalisme et de l’islamologie en Occident selon leurs étapes successives : « les premiers pas de la recherche, les réductionnismes de type sociopsychologique, Cuse et les réductionnismes de type ‘mystique’ (et ces rêveries relativistes répandant ‘le présupposé théologique de la voie parallèle, posant l’islam comme seconde voie de salut, parallèle à la voie judéo-chrétienne’, (idée) que la théologie des religions a poussé à son paroxysme » ! Cette affirmation sommaire et très partiale de l’auteur l’amène alors à constater « le clivage persistant de l’islamologie », laquelle ne résoudrait rien des origines de l’islam.
Le ch. 6 (143-183) offre des Pistes qui déblaient la connaissance de l’islam, car « des percées, dit l’auteur, ont eu lieu au cours du XXème siècle, dans le domaine de la recherche historique d’abord, puis dans celui de la compréhension idéologique du phénomène islamique », ce qui lui permet, utilisant ces percées non sans les interpréter en sa faveur, de présenter sa thèse (« la piste historique du proto-islam ») qui n’est, somme toute, que l’une des nombreuses hypothèses possibles quant à l’émergence de l’islam au VIIème de notre ère. « C’est seulement en 2004, affirme-t-il, qu’une synthèse de tous ces travaux de recherche a été élaborée dans le cadre d’une thèse doctorale. Parue en 2005 sous le titre ‘Le Messie et son prophète’, elle proposait un réassemblage du puzzle dont beaucoup de chercheurs ne détenaient que des pièces éparses ». Récusant « le discours islamique légendologique » relatif à Mahomet, sa thèse soutient l’existence de « nazaréens », contemporains de la primitive Eglise, ébionites messianistes désireux d’assurer le retour de Jésus, conçu comme Messie temporel. Il y aurait ainsi « un proto-islam en amont de l’islam arabe : l’identité de fond de ce qui sera appelé ‘islam’ est préislamique et a demeuré : elle repose sur la conviction d’avoir été choisi par Dieu en vue de son projet politico-religieux de salut ; c’était déjà la conviction des nazaréens (et de leur) projet messianiste et guerrier ». L’auteur invite donc à comprendre « les dérives du judéo-christianisme » primitif (« postchristianisme ») et de sa grande espérance, celle d’un retour du Messie. Ceux qu’il appelle « judéo-nazaréens » se seraient retrouvés dans la Syrie maritime et leur alliance avec des Arabes et leur leader au début du VIIème siècle aurait amené à l’hégire de ceux-ci à Yathrib/Médine, avant que l’islam naissant ne supplante enfin les premiers et ne se constitue en religion autonome avec un livre qui lui est propre. D’où, dit l’auteur, « la force de la’ foi’ messianiste » de l’islam. C’est ainsi qu’il entend proposer son hypothèse « doctorale » sur les origines de celui-ci, avant d’en faire la pierre d’angle du dialogue qu’il pense promouvoir. Si elle est à respecter, bien qu’elle ne soit guère convaincante, comme toutes les autres hypothèses relatives aux origines de l’islam, elle ne saurait jamais prétendre rejoindre la seule vérité historique.
Le ch . 7 (185-205), Vers un dialogue de salut, propose-t-il de nouvelles voies pour le « changement de cap » souhaité en matière de dialogue ? L’auteur souhaite « une réorientation profonde de la culture de l’Eglise latine, marquée par un intellectualisme de plus en plus éloigné de la Révélation, et donc de plus en plus soumis à des influences opposées à celle-ci ». Selon lui, « l’idée de faire dialoguer les trois religions ‘abrahamiques’ est un vieux serpent de mer qui resurgit ici et là par souci de convivialité et de compréhension mutuelle, et dont les résultats se font toujours attendre. Les ‘dialoguistes’ sont les héritiers de cette méconnaissance récurrente de l’islam et de l’histoire, la méconnaissance de la Révélation et l’ignorance des mécanismes postchrétiens qui contrefont celle-ci ». Alors, que faire ? « Il est possible, dit-il, de repenser le dialogue islamo-chrétien sur des bases saines, en y distinguant deux axes : la nécessité de repartir du point premier de la divergence » (telle qu’elle s’est exprimée entre l’Eglise primitive et les judéo-nazaréens) « et le sens du Jugement qui vient », celui de Jésus Christ à la fin des temps (or ce dernier axe est paradoxalement « axial » chez L. Massignon !). Mais peut-on imaginer que le dialogue consiste à « débattre (aujourd’hui) des discussions et objections que les judéo-nazaréens eurent contre la foi des Apôtres ? (Et s’) il faut aussi reparler de l’Antichrist dans les dialogues interreligieux », comme pense-t-il y amener ses interlocuteurs ? L’auteur imagine que « de tels dialogues peuvent être fructueux, et même fraternels », encore faudrait-il que les musulmans se reconnaissent fidèles descendants de ces « judéo-nazaréens », ce qui n’est pas le cas, et aient des idées claires sur le retour du Messie ! Mais faut-il remonter dans le temps, et même jusque là, pour parler ensemble d’un même « souci partagé de l’avenir de ce monde en crise avec une exigence de vérité » ? L’auteur oublie (ou ignore !) que, depuis cinquante ans, tous les dialogues n’ont fait que porter sur ce thème essentiel, même si l’auteur n’y voit qu’un « discours ‘droits-de-l’hommiste’ » de mauvais aloi. Il lui est trop facile de citer Benoît XVI tout en dénonçant l’ambiguïté de certains de ses propos. Et que pourrait-il penser de tout ce que celui-ci a dit à Beyrouth en septembre dernier ? Mais il a raison de dénoncer la collusion incroyable (voire hypocrite) entre les Etats occidentaux, champions des droits de l’homme, et les monarchies pétrolières, responsables de la wahhâbisation de l’islam contemporain.
La Conclusion s’explique-t-elle sur le « changement de cap, important et nécessaire », tel qu’il est souhaité par l’auteur, en son livre, et par Mgr Cattenoz, en sa « postface » ? Rien n’y est suggéré de positif, hélas ! Il y est répété que « la théologie occidentale s’est représenté l’islam non comme un postchristianisme historique mais comme un assemblage abstrait de néopaganisme et d’emprunts au judaïsme et au christianisme ; elle s’est contentée alors de réinterpréter les légendes islamiques relatives aux Arabes païens de La Mecque à l’aune de ses élucubrations » ! Alors qu’il rappelle opportunément que Jean Paul II invitait à « une connaissance objective de l’islam », pourquoi l’auteur passe-t-il sous silence tous les efforts des communautés chrétiennes en vue de l’assurer auprès de tous ? Et pourquoi se plaindre encore de ce que « les instances qui se sont fait confier un quasi-monopole en matière de formation chrétienne en islamologie ont continué à s’opposer à toute recherche objective, et à promouvoir une image irréelle de l’islam fabriquée par leur théologie des religions, faisant miroiter l’évolution de celui-ci vers une ouverture ‘à visage humain’ » ? Rien ne semble donc ici proposé qui puisse enrichir l’actuel dialogue islamo-chrétien qui serait en crise, à bien entendre l’auteur. Le fait est que celui-ci prend ses distances vis-à-vis du Concile Vatican II dont il ne mentionne aucun texte, ignore l’enseignement de Jean Paul II et de Benoît XVI en matière de dialogue, oppose vainement une Eglise d’Occident, jugée mal informée, à une Tradition orientale qu’il exalte curieusement en son expression araméenne, et voudrait que son hypothèse scientifique sur les origines de l’islam soit au cœur même du dialogue. Le malentendu n’est donc pas islamo-chrétien, mais bien plutôt intra-catholique entre, d’une part, E.-M. Gallez lui-même et les auteurs auxquels il se réfère en sa bibliographie et, d’autre part, ces « dialoguistes » qu’il accuse d’ingénuité intellectuelle ou suspecte de brader leur foi. Il est donc plus que temps de s’expliquer sans préalable entre chrétiens sur tout ce qui fait problème, surtout si tous veulent reprendre à leur compte ce que dit Mgr Cattenoz en sa postface : « L’Eglise, dans le trésor de sa foi, affirme que des grâces de suppléance sont données à tous les hommes qui ne connaissent pas le Christ sans qu’il y ait faute de leur part, pour les orienter vers le bien. Tout homme qui, tout au long de sa vie, aura cherché à faire le bien, quand il arrivera au terme de son chemin ici-bas, découvrira le Christ ; et le poids de tout le bien qui aura habité sa vie le conduira à reconnaître en Jésus l’unique sauveur de tout homme ».
Cf. Dialoguer avec les musulmans : une cause perdue ou une cause à gagner ?, Paris, Téqui, 2011
Pour aller plus loin :
- Edouard Marie-Gallez, Le malentendu Islamo-chrétien, éd. Salvator, septembre 2012, 21 euros.
- François Jourdan, La Bible face au Coran (Les vrais fondements de l’islam), L’Œuvre, 2011, 140 p., 18 e.
- L'islam en Occident : « Une Révolution sous nos yeux »
- L’islam, le judaïsme et les autres
- Un monastère cistercien en terre d’Islam ?