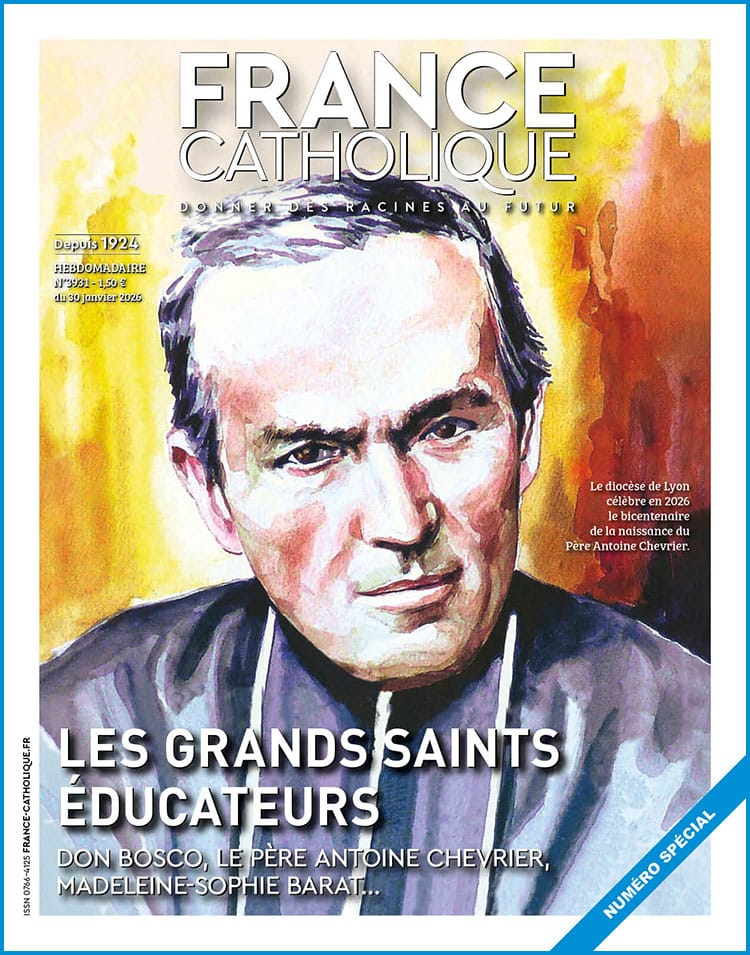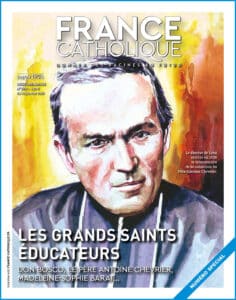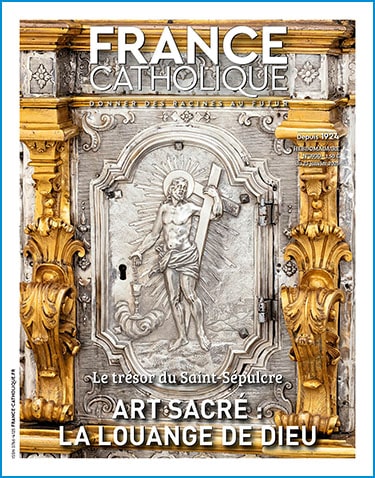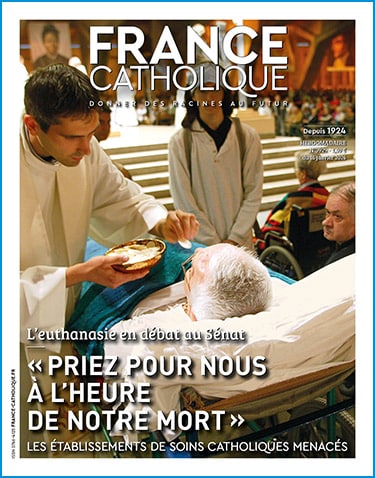Quand le ministère de l’Éducation nationale veut être efficace, il y parvient. En témoigne la diligence avec laquelle ont été menées des centaines d’inspections dans les écoles, collèges et lycées catholiques sous contrat, dans la foulée du scandale qui a frappé l’institution Notre-Dame de Bétharram à la suite des révélations de Mediapart en février 2025. Sur les 1000 annoncées par Élisabeth Borne en mai dernier, lorsqu’elle officiait encore rue de Grenelle, près de 900 ont été réalisées en un semestre. Si nul ne conteste l’objectif affiché de ces inspections – s’assurer de la sécurité des mineurs accueillis dans ces établissements – leurs modalités ont en revanche de quoi laisser pantois.
À telle enseigne que Guillaume Prévost, le secrétaire général de l’Enseignement catholique a évoqué « de graves abus d’autorité » le 2 décembre dernier devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale qui l’auditionnait. Interrogatoires intrusifs, fouille des cartables, ouverture des messageries… Tous les moyens ont semblé bons aux émissaires du ministère pour mesurer le degré de catholicité – puisque c’est bien de cela qu’il s’agit – des établissements concernés, de leurs cadres, de leurs enseignants et même de leurs élèves. Un rapport, établi par le SGEC, dont des extraits ont été diffusés le 8 décembre, est accablant. On y découvre notamment que des professeurs ont pu être interrogés sur leur pratique dominicale, ou encore que des injonctions se sont multipliées, visant à éradiquer tout symbole chrétien des classes au nom de leur prétendue neutralité.
Antichristianisme administratif
Cette offensive laïcarde, si elle se singularise par son périmètre et son mode opératoire, n’a rien de nouveau dans son inspiration. Elle n’est qu’une nouvelle déclinaison d’un antichristianisme administratif qui avait sans doute connu son paroxysme au début du siècle dernier et avait abouti à la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, laquelle, convenons-en, n’a pas eu que des incidences néfastes pour les chrétiens, en ce qui concerne notamment l’entretien des édifices cultuels. Mais s’il fallait affiner encore le parallèle entre le scandale récent et les épisodes du passé, c’est surtout l’affaire des fiches que l’histoire fait surgir, même si l’entreprise avait été clandestine avant que n’éclate la controverse. À l’époque, ce n’est pas l’enseignement catholique que ciblent les officines : et pour cause, les dernières congrégations enseignantes ont été expulsées après l’adoption de la loi Combes en juillet 1904. Non, le nouveau bastion auquel s’attaquent les laïcistes, c’est l’armée.
À la manœuvre, on trouve le général Louis André (1838-1913) qui, depuis qu’on lui a attribué le portefeuille du ministère de la Guerre en 1900, n’a de cesse de purger la Grande Muette de ses officiers chrétiens. Issu d’une famille croyante, devenu positiviste, il se considère comme investi d’une mission depuis l’affaire Dreyfus au cours de laquelle il avait pris position en faveur du capitaine juif injustement accusé de traîtrise : il veut débarrasser l’armée de toute trace antirépublicaine afin de s’assurer de son loyalisme. Cette mission correspond précisément à la directive que lui a donnée Pierre Waldeck-Rousseau, président du Conseil : son ordre de mission suppose de « rapprocher le corps des officiers de la nation républicaine ».
Listes « Corinthe » et « Carthage »
Or aux yeux du général, qui dit antirépublicain, dit chrétien. Dès sa prise de fonction, le voici donc qui s’attelle à la constitution de fiches pour distinguer les éléments sûrs des dissidents potentiels. La liste « Corinthe » recense les premiers, la liste « Carthage » les seconds. Pour enrichir ces documents, le général André s’appuie sur le Grand Orient de France, favorable à l’entreprise, qui dispose de loges efficaces dans la plupart des garnisons du pays. Une fraternelle spécifique est même constituée pour orchestrer la remontée des informations : la « Solidarité des Armées de Terre et de Mer », rebaptisée « Solmer ». Au fil des mois, à partir d’une première base réalisée par le ministère de l’Intérieur, les notes et les dénonciations remontent à son bureau, où elles sont traitées par son officier d’ordonnance et son chef de cabinet, tous deux initiés au Grand Orient.
Au total, près de 18 000 dossiers sont constitués. « Les fiches indiquent si l’officier assiste ou non à la messe, s’il communie et suit les processions religieuses. Toutes les actions à caractère religieux sont épiées, les journaux lus sont mentionnés, tout comme sont rapportées des bribes de conversations aux paroles hostiles au gouvernement ou à la République. Les salons et les dîners auxquels il se rend servent aussi à le juger. L’enquête est également élargie à son épouse et ses enfants. Les rédacteurs indiquent si l’épouse fréquente l’église, les œuvres charitables et signalent si les enfants sont inscrits à l’école publique ou privée », explique en 2008 l’historien Emmanuel Thiébot, dans un entretien publié par la revue Humanisme, éditée par le Grand Orient.
Le scandale éclate
Que le sommet de l’Armée veuille connaître l’orientation de ses cadres n’a en soi rien de choquant : la réalisation d’ « enquêtes de moralité » fait partie de la routine dans la gestion des effectifs militaires. Mais que ces enquêtes clandestines, en partie confiées à une organisation farouchement antichrétienne, soient utilisées pour piloter l’avancement ou l’attribution des décorations des officiers, voilà qui relève du scandale. Celui-ci éclate le 28 octobre 1904 lorsque le député Jean Guyot de Villeneuve, mis au fait de la manœuvre par un dignitaire du Grand Orient, Jean-Baptiste Bidegain, révèle le pot au rose devant la Chambre des députés.
La déflagration est considérable. Le général André, sans nier l’existence de ces dossiers, affirme découvrir le rôle actif des francs-maçons dans leur constitution, mais rien n’atténue la vindicte qui s’abat sur lui – il est même giflé à deux reprises par le député Gabriel Syveton – ce qui le conduit à démissionner au mois de novembre 1904. Le gouvernement ne se relève pas non plus de l’affaire : le « Petit Père Combes », qui est à sa tête, démissionne le 18 janvier 1905. Le scandale ne met pas fin pour autant aux menées anticléricales de l’époque, lesquelles ne prendront véritablement fin – pour cette séquence de l’histoire contemporaine – que dans les tranchées, lors de l’Union sacrée.