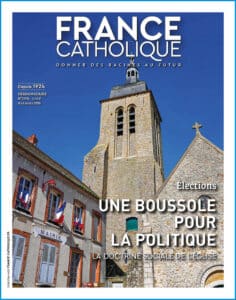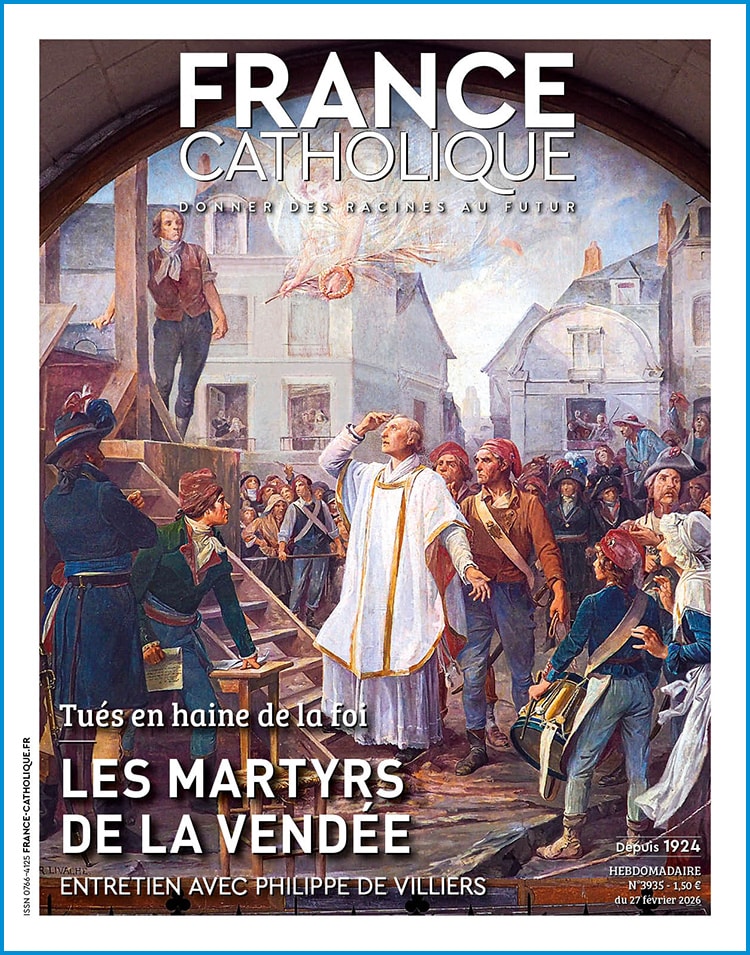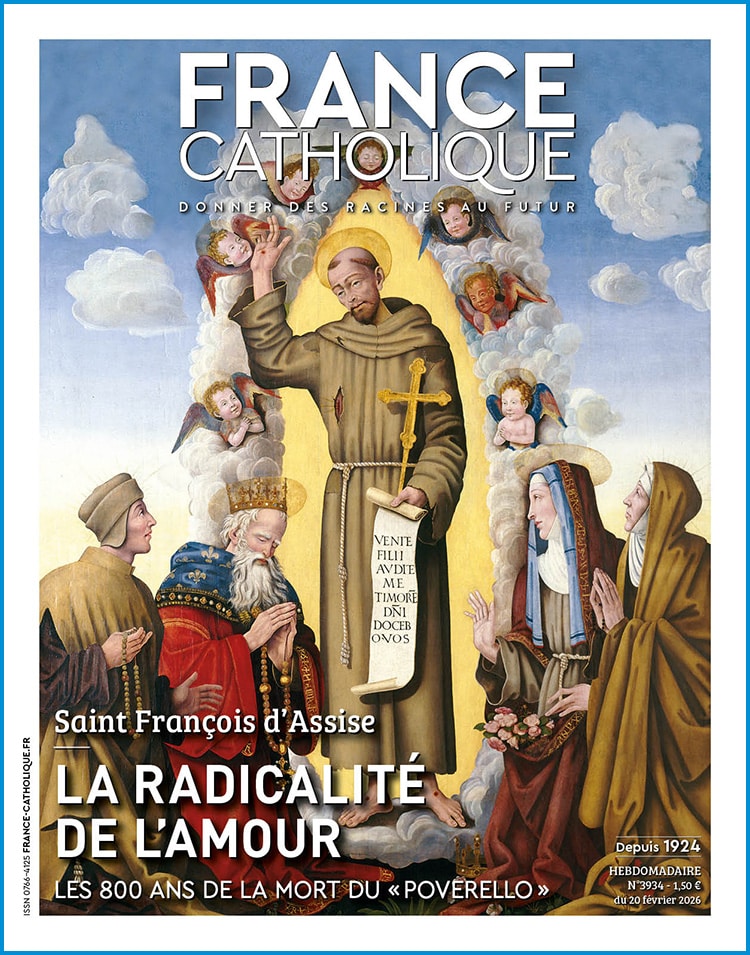« [On ne vit, on ne souffre et] on ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, et peut-être même les uns à la place des autres. »
Cette phrase tirée des Dialogues des Carmélites de Bernanos, paraphrasant saint Paul aux Romains (14, 7) – et à laquelle je me suis permis d’adjoindre les deux premiers termes – est d’une vérité tragique et lumineuse : elle résume mieux que bien des traités de théologie l’énigme humaine de la souffrance et de la mort. À l’heure où nos députés veulent légaliser l’euthanasie sous couvert de compassion et de dignité, il est urgent de méditer ce que ces mots signifient. Car notre époque, qui se croit lucide et bienveillante, entretient avec la mort et la souffrance un rapport étrange, ambigu, profondément marqué par l’individualisme moderne et par l’oubli de l’éternité.
La mort occultée
L’homme contemporain vit dans une contradiction que peu osent nommer. D’un côté, il dissimule la mort : il la refoule, il l’évacue des discours, des rites, des regards. Elle est reléguée dans les espaces médicaux, stérilisée par la technologie, anesthésiée par les sédatifs et les euphémismes. On ne meurt plus, on « s’endort paisiblement », on « quitte les siens ». La mort n’est plus une réalité partagée, elle devient un accident individuel, presque indécent.
Mais, dans le même temps, l’homme réclame le droit de la provoquer à sa guise. Il ne veut plus seulement mourir – il veut choisir comment, quand, et dans quelles conditions mourir. Ce désir, déguisé en liberté, traduit moins un progrès qu’une capitulation : une peur de la dépendance, un refus du réel, une volonté de maîtrise absolue. L’euthanasie, ainsi comprise, n’est pas une réponse humaine à la souffrance, elle est une fuite devant la condition humaine. Car celle-ci suppose justement, dans sa finitude, que nous ne nous appartenons pas entièrement. Nous ne sommes pas la cause de notre vie ; pourquoi prétendrions-nous en être les arbitres derniers ?
Qui sait encore aimer ?
La revendication euthanasique est symptomatique d’une anthropologie fragmentée. L’individu s’y conçoit comme une monade fermée sur elle-même, n’ayant de compte à rendre qu’à sa propre volonté. La souffrance devient intolérable dès qu’elle n’a plus de sens pour moi. La mort est tenue pour scandaleuse si elle échappe à mon consentement. Dans cette perspective, toute dépendance, tout besoin des autres est vécu comme une déchéance.
Mais la vérité humaine est tout autre. Nous ne sommes pas seuls, et nous ne mourons pas seuls. Toute mort est un événement communautaire, une blessure dans le tissu des relations. Le mourant n’est jamais seul à mourir : il meurt en laissant derrière lui des fils, des amis, une communauté. Et il meurt, souvent, en portant avec lui les souffrances des autres – ou en les expiant. La parole de Bernanos n’est pas une simple métaphore : elle est une clé spirituelle. La souffrance est toujours mystérieusement partagée, et la mort peut avoir une fécondité invisible, une fécondité d’amour, offerte pour autrui, comme le fut celle du Christ.
La question morale
D’un point de vue chrétien, l’euthanasie est un péché grave. Elle est, dans son principe, un suicide, et, dans sa pratique, un homicide. Même enveloppée de compassion ou de sédatifs, elle reste une transgression de la loi divine : « Tu ne tueras point » (Exode 20, 13). La vie est un don de Dieu, elle ne nous appartient pas. La mort, elle aussi, lui appartient : « Le Seigneur fait mourir et fait vivre » (1 Samuel 2, 6).
Celui qui demande l’euthanasie – en pleine connaissance de cause et de manière délibérée – met donc en péril son Salut éternel, car le suicide, volontaire et lucide, est un péché mortel. Bien sûr, Dieu seul connaît les cœurs, et il peut, dans sa miséricorde, tenir compte des troubles psychiques ou de l’ignorance morale. Mais la règle demeure : mettre fin volontairement à sa propre vie, c’est refuser l’espérance, nier la Providence, se fermer à l’offrande salvifique de la Croix. Le chrétien sait que la souffrance peut être unie à celle du Christ, qu’elle peut devenir féconde, rédemptrice, sanctifiante. L’euthanasie est, en ce sens, une apostasie silencieuse.
Le scandale de l’éternité
Quant aux médecins, et plus encore aux législateurs, leur responsabilité est redoublée : ils engagent non seulement leur conscience personnelle, mais aussi l’ordre social. Introduire dans la loi civile la possibilité de tuer légalement, sous prétexte de souffrance, c’est nier la vocation de la loi à protéger les plus faibles. Le politique devient alors complice du nihilisme contemporain, quand il devrait au contraire être un rempart contre lui.
Mais le cœur du problème, c’est l’éternité. L’homme moderne ne sait plus quoi faire de l’éternité. Il l’a oubliée. Il vit comme si la mort était le néant, comme si tout s’arrêtait là. Il ne veut pas de l’au-delà, parce qu’il ne veut pas du jugement. Or, il y a un jugement : « Le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis d’être jugés » (Hébreux 9, 27). La mort n’est pas une sortie, c’est une entrée. Une entrée dans l’invisible, dans le face-à-face avec Dieu, dans la vérité toute nue. La vie ici-bas est un temps de choix, un temps d’épreuve, elle est faite pour nous conduire à Dieu, ou pour nous en éloigner.
Mourir chrétiennement
Parler de l’euthanasie sans parler des fins dernières, c’est parler de la mort comme le païen ou l’athée. Mais nous, chrétiens, savons qu’il y a une âme, qu’il y a un enfer, un purgatoire, un paradis. Nous savons qu’on ne meurt pas « pour en finir », mais pour répondre. Le chrétien qui meurt dans la grâce va à la rencontre du Christ ; celui qui meurt en état de péché mortel, sans repentir, se coupe pour toujours de Dieu. C’est une vérité terrible, mais salutaire. Elle seule donne son vrai poids à nos décisions morales.
Face à cette dérive, il est urgent de retrouver une vision intégrale de la vie et de la mort. Le chrétien est appelé à mourir comme il a été appelé à vivre : en fils de Dieu, en frère des hommes, en membre souffrant du Corps mystique du Christ. La mort n’est pas le moment d’un repli individualiste, mais celui d’un ultime acte d’offrande. La souffrance de la fin peut devenir prière, intercession, purification. Elle peut être vécue pour les autres, et même, mystérieusement, à leur place. C’est la logique de la Croix : ce que le monde rejette comme absurdité devient, dans la lumière de la foi, l’expression suprême de l’amour.
Il appartient donc aux familles, aux prêtres, aux médecins et à toute la communauté chrétienne d’entourer les mourants avec respect, compassion et foi. Il ne s’agit pas de prolonger la vie à tout prix, mais de ne jamais refuser à l’homme cette dignité ultime : mourir comme un être humain voulu, connu et aimé de Dieu, dans la paix, dans la vérité, et – si possible – dans la grâce.
Notre devoir est de préparer les âmes à bien mourir. Car une bonne mort, une mort sainte, est le couronnement de toute une vie. Et cela, aucune législation humaine ne pourra jamais le remplacer.
« L’euthanasie en débat »
Voici un petit livre précieux dans le débat actuel. Son auteur, Matthieu Lavagna, y passe méthodiquement en revue les « justifications » des partisans de l’euthanasie pour les réfuter avec clarté, du point de vue philosophique et juridique. Passés au crible de la raison, et sous l’angle d’une vraie compassion, aucun de ces motifs ne tient, ni les arguments de fond – la souffrance, l’autonomie, l’indignité supposée de la fin de vie – ni les motifs de circonstances : « si on ne légalise pas l’euthanasie ici, les gens iront la demander ailleurs », ou encore « la plupart des Français y sont favorables »… La conclusion s’impose : « Il n’existe aucune bonne raison de remettre en cause l’illégalité du meurtre ». Une démonstration imparable qui s’appuie aussi sur l’expérience de soignants et les témoignages touchants de malades.
L’euthanasie en débat. Peut-on donner la mort par compassion ?, Matthieu Lavagna, éditions Salvator, 158 pages. À paraître le 30 mai 2025.