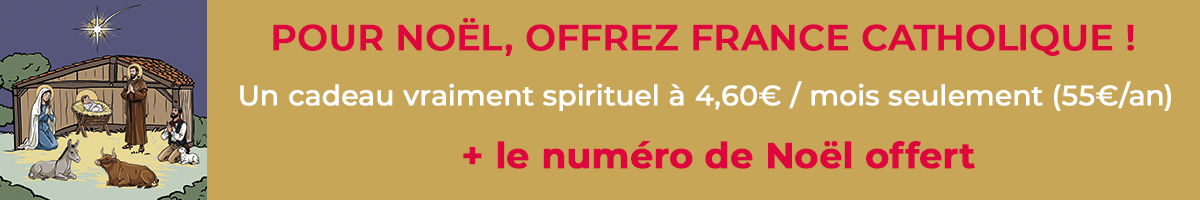Il y a cent ans, Broca eut l’idée saugrenue de mesurer le tour de tête de ses étudiants et de ses infirmiers. II trouva que les étudiants en médecine avaient en moyenne un crâne plus volumineux. C’était le beau temps du scientisme simpliste. Taine déclarait que le cerveau produit la pensée comme le foie sécrète la bile. Les mesures de Broca n’étonnèrent personne, attendu (car alors cela allait de soi) que les étudiants sont plus intelligents que les infirmiers.
On peut supposer que Broca lui-même était muni d’un crâne conforme à ses théories. C’est bien l’impression que donnent ses photos. Sinon, de quoi eût-il eu l’air en enseignant ses étudiants ? De quoi eût-il eu l’air, doté, par exemple, du crâne déplorablement minuscule de Gambetta ou d’Anatole France, ses contemporains, vrais microcéphales ?
Voilà plusieurs fois que j’aborde ici cette question du rapport entre la matière et la pensée1. C’est que cette vieille énigme est actuellement attaquée par de nombreuses méthodes sans aucune relation entre elles et qui néanmoins s’éclairent peut-être les unes les autres.
Aux États-Unis, le psychologue Arthur Jensen multiplie les expériences tendant à montrer que toutes les mesures de l’intelligence, de quelque façon qu’on les établisse, sont en rapport avec l’hérédité génétique. J’ai déjà parlé de certaines de ces expériences très discutées2, et il faudra y revenir, car il y a du nouveau.
Les rats de Berkeley
Toujours aux États-Unis, deux autres savants, P. B. Baltes et K. W. Schaie, viennent de montrer de façon tout à fait convaincante que les données admises jusqu’ici sur le vieillissement de l’intelligence étaient illusoires. A priori, on est évidemment curieux de connaître l’âge de deux savants qui contestent ce vieillissement. Présomption favorable : ce ne sont pas des vieillards, loin de là ! Baltes a trente-quatre ans, Schaie guère plus.
Mais pour cette fois nous laisserons là l’intelligence humaine et les périlleuses études qu’elle fait d’elle-même. Il faut toujours, dans ce problème, se rappeler l’objection de Jacques Bergier : Et si le savant est un crétin ?3
Personne, assurément, ne pense que le Pr Mark Rosenzweig, de l’Université de Berkeley, se range dans cette regrettable catégorie (qui existe, j’en connais). En serait-il ainsi que ses expériences n’en seraient pas forcément compromises, puisque ce n’est pas l’intelligence humaine qu’il étudie, mais celle des rats de laboratoire. Examinons donc les expériences du Pr Rosenzweig.
Ce neuropsychologue part de la constatation, bien établie depuis longtemps, que l’apprentissage joue un rôle primordial dans les performances intellectuelles de tout animal (a)4. Un rat qui a eu l’occasion d’affronter des problèmes variés est beaucoup plus dégourdi.
Pensons du reste à la maladresse de nos animaux d’appartement lâchés dans la nature. En revanche, ces mêmes animaux d’appartement savent parfois faire certaines choses qu’ignore l’animal sauvage : là aussi il y a apprentissage.
D’où la question posée par Rosenzweig : Se pourrait-il que l’apprentissage modifie physiquement le cerveau ?
Pour le savoir, il prend vingt rats issus de mêmes parents et les répartit, dès leur naissance, en trois lots :
1) Un premier lot de quatre rats est élevé dans ce qu’il appelle un « milieu appauvri » : chaque rat vit seul dans une cage grillagée de dimensions convenables, avec de la nourriture et de l’eau à volonté ; il ne voit aucun autre rat, ne subit aucune stimulation ni contrainte ;
2) Un deuxième lot de quatre rats est élevé en « milieu standard », c’est-à-dire dans une cage exactement identique à la précédente, à une différence près : les quatre rats vivent dans la même cage, et peuvent donc jouer et s’occuper entre eux ;
3) Enfin, les douze derniers rats sont placés dans une grande cage contenant des objets nombreux et divers avec lesquels ils peuvent jouer : c’est le « milieu enrichi » (b).
Au bout d’un mois, ces vingt rats sont examinés sous toutes les coutures. Un premier fait (prévisible) est que les douze rats du « milieu enrichi » sont plus dégourdis que ceux du « milieu standard », lesquels, à leur tour, se débrouillent mieux que ceux du « milieu appauvri ».
Mais voici qui est plus inattendu. Rosenzweig prélève le cerveau de tous ces rats et les pèse : le poids accuse les mêmes inégalités ! En moyenne, le cerveau des rats élevés − pendant un mois seulement − en milieu enrichi pèse 6% de plus que celui des rats « standard », et les rats élevés en milieu appauvri ont les plus petits cerveaux.
Rosenzweig veut préciser la nature de ces différences. On sait que les fonctions supérieures de l’encéphale sont localisées dans le cortex. Il sépare donc le cortex du reste du cerveau et le pèse : la différence atteint cette fois 10 %. Mais peut-être ces variations sont-elles le résultat d’un coup de hasard, une fluctuation, comme disent les statisticiens. Il recommence son expérience, il en varie les circonstances : les mêmes résultats chaque fois apparaissent, montrant qu’il s’agit bien d’une loi.
Un cerveau dont on se sert davantage acquiert du poids au cours de l’enfance, exactement comme les muscles de l’athlète à l’entraînement !
Rosenzweig veut alors savoir avec plus de précision ce qui se passe dans les cerveaux stimulés par une pensée plus active et examine la structure microscopique des cellules cérébrales (neurones et névroglies). Et cette fois la surprise est de taille : là où le poids a augmenté de 10%, le volume des neurones s’est accru de 13% : autrement dit, leur nombre a décru ! Poussant plus loin son analyse, il découvre que les neurones ayant eu une forte activité contiennent plus d’acide ribonucléique (ARN)5.
Il n’y a plus de « croulants »…
Ces découvertes sont fondamentales. Sans aller au fond pour aujourd’hui, je rappellerai qu’à partir de l’âge de quinze ans environ, le nombre des neurones cérébraux primaires ne cesse de diminuer. On tenait jusqu’ici cette diminution pour le commencement de la sénescence6. Il va falloir sans doute abandonner cette idée. La diminution du nombre des neurones (10 000 par jour à vingt-cinq ans, 100 000 à quarante) n’est peut-être due, au contraire, qu’à l’acquisition de l’expérience et du savoir.
Aimé MICHEL
(a) Le livre classique sur l’apprentissage est celui du directeur du Département comportement animal de Cambridge, W. H. Thorpe : Learning and Instincts in Animals. Mais voir aussi le manuel de notre ami Rémy Chauvin : Psychophysiologie (Masson, Paris), vol. II.
(b) On peut voir des photos de ces cages dans Science et Vie de mars 1974.
Chronique n° 182 parue dans France Catholique-Ecclésia − N° 1427 − 19 avril 1974
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 17 février 2014
Pour aller plus loin :
- Sur la relation entre la pensée et le cerveau voir notamment la chronique n° 127, Le café, le lactate et l’âme – Qu’est-ce qu’un état d’âme, sujet à des manipulations chimiques ? (11.06.2012).
- Les travaux d’Arthur Jensen ont été présentés dans la chronique n° 127, citée ci-dessus. Voir aussi les chroniques n° 114, L’homme chiffré – Les sciences humaines aussi permettent de prévoir : l’exemple du QI (23.04.2012) et n° 162, La moulinette qui nous menace – La planification de l’homme sous prétexte de sciences humaines est une escroquerie (10.06.2013).
- Que l’infirmier de Broca puisse être un génie et le savant de Bergier un crétin est une de ces déconcertantes possibilité qu’Aimé Michel garde toujours présente à l’esprit. C’est l’une de ses convictions, fondée sur une vie qui l’a conduite « à bien voir toute l’échelle sociale, banquiers, ministres et académiciens compris, en France et ailleurs » (chronique n° 228, Le Q.I. d’Ivan Denissovitch – La réussite d’une vie ne se mesure pas à la hauteur atteinte sur le perchoir social, 03.0.9.2012), qu’il y a le même pourcentage d’imbéciles et de cracks dans toutes les catégories sociales.
- À l’appui de l’affirmation que l’apprentissage joue un rôle primordial dans les performances intellectuelles de tout animal, Aimé Michel cite en note les travaux de William H. Thorpe (1902-1986) qui fut professeur d’éthologie animale à l’université de Cambridge et l’un des pionniers de cette discipline. En voici un exemple. Étudiant des pinsons, Thorpe montre qu’un oiseau isolé, élevé en l’absence d’autres oiseaux de son espèce et sans qu’il puisse les entendre, produit un chant très simplifié mais néanmoins apparenté au chant normal. Autrement dit l’oiseau chante quelque chose mais qui n’est tout à fait correct que s’il a la possibilité d’entendre ses congénères.
Concernant les mammifères, Jacques Lecomte note que les comportements appris des parents sont plus difficiles à mettre en évidence que chez les oiseaux. « Par exemple, les jeux de la mère chatte avec son chaton ne sont pas du tout indispensables pour enseigner à chasser. Un chat élevé sans contact avec une chatte saura très bien tuer une souris. Cependant la reconnaissance de la proie n’est pas absolument innée et un chat élevé avec des souris ne leur montrera par la suite aucune hostilité. Gardons-nous de généraliser, car en ce qui concerne les chiens il semble bien que les cris des souris et autres petits rongeurs, cris presque inaudibles pour l’homme car ils voisinent les ultra-sons, évoquent une réaction innée de chasse et de poursuite. » (Les animaux, Flammarion, Paris, 1962, p. 67).
- Les expériences de Rosenzweig ont été parmi les premières à fournir des arguments directs permettant de faire un lien entre des performances comportementales (intellectuelles si on veut) et des modifications observables du cerveau. On comprend donc qu’elles aient suscitées autant d’intérêt et que leur auteur ait été invité à les présenter à un large public dans un article du Scientific American (« Brain changes in response to experiences » dans le n° 226, février 1972, pp. 22-29).
Bien que ces expériences ne prétendent nullement attribuer les changements observés à la seule mémoire, il n’est pas inutile de dire deux mots des modifications cérébrales liées à celles-ci, d’autant que l’allusion aux travaux de Thorpe sur l’apprentissage y incite.
On suppose depuis très longtemps que les mémoires à long terme sont encodées d’une manière ou d’une autre dans les connexions entre neurones du cerveau. On a été ainsi conduit assez naturellement à penser que des modifications durables des synapses sont la base structurelle de la mémoire dans le cerveau. Rappelons que les synapses sont les points de contact entre neurones au niveau desquels se trouvent des spécialisations de leurs membranes permettant l’échange de signaux entre eux : le neurone dit présynaptique libère des petites molécules de neurotransmetteurs, dont le plus connu est l’acétylcholine (il en existe plusieurs autres), qui traversent le court espace intercellulaire, se lient à des protéines réceptrices portés par le neurone dit postsynaptique et ainsi y déclenchent de petits courants électriques. Ces courants provoquent soit une diminution du potentiel électrique de la membrane capable d’exciter le neurone (on parle alors de neurotransmetteur excitateur et de potentiel postsynatique excitateur PPSE), soit au contraire une augmentation du potentiel qui diminue ou annule l’excitation du neurone (neurotransmetteur inhibiteur et PPSI). Le plus souvent les parties présynaptiques sont portées par les terminaisons des axones (les sorties des neurones) tandis que les parties postsynaptiques le sont par les dendrites (les entrées). Dans le cerveau l’activité de chaque neurone est ainsi influencée par plusieurs milliers de synapses arrivant sur son arborisation dendritique : son activité augmente ou diminue selon que domine à chaque instant le poids relatifs des synapses excitatrices ou inhibitrices. Chez les mammifères il n’y a pas de preuves que les voies neuronales majeures du cerveau se modifient après leur formation initiale au cours du développement embryonnaire. Par contre, on conçoit que les petits changements de connectivité entre neurones nécessaires à la mémoire puissent se faire en modifiant les synapses. Par exemple on peut les faire grossir ou modifier leur nombre, soit en créant de nouvelles synapses, soit en les faisant régresser. C’est bien ce que suggèrent les premiers résultats de Rosenzweig et qu’ont confirmé les nombreuses expériences ultérieures.
De nombreux neurones du cerveau de tous les vertébrés et de certains invertébrés (notamment dans certaines parties du cerveau des insectes) présentent des petites protubérances sur leurs dendrites que l’on appelle épines dendritiques. Une grande cellule pyramidale du cortex visuel peut porter jusqu’à 15000 épines et les cellules de Purkinje du cervelet humain jusqu’à 200 000 ! En outre, plus de 90% des synapses excitatrices du cortex des vertébrés se trouvent sur ces épines contre moins de 20% des synapses inhibitrices. Mais le plus remarquable est que le nombre et la forme de ces épines peut changer au cours du développement du nouveau-né à l’adulte et aussi en fonction des stimulations externes, ce qui laisse penser que ces épines jouent un rôle central dans la transmission et la plasticité synaptique.
D’autre part, on a pu mettre en évidence des modifications du fonctionnement des synapses selon leur usage ou non usage. Il en existe plusieurs formes dont la plus étudiée est la potentialisation à long terme (PLT, ou LTP en anglais). Elle a été décrite pour la première fois en 1973 par T.V.P. Bliss et T. Lømo dans une synapse reliant deux cellules pyramidales de l’hippocampe des mammifères ; ils ont montré que l’association expérimentale de la dépolarisation du neurone postsynaptique et d’une stimulation à haute fréquence d’une terminaison du neurone présynaptique provoquait un doublement de l’efficacité de la transmission synaptique entre ces neurones. D’autres auteurs ont montré que cette efficacité accrue s’accompagnait d’une augmentation moyenne de 40% du diamètre des épines. Cet accroissement rapide et durable (de plusieurs heures à plusieurs semaines ou plus) de l’efficacité synaptique à la suite d’une stimulation brève a été découverte par la suite dans d’autres régions du cerveau. Bien qu’elle soit riche de controverses et que peu de résultats y soient unanimement acceptés, la recherche sur la PLT est très populaire parce qu’elle porte l’espoir d’expliquer l’apprentissage et la mémoire en termes moléculaires.
L’extraordinaire accumulation de résultats obtenus depuis une quarantaine d’années sur ces sujets contraste, et peut-être explique, la non moindre remarquable difficulté à les rassembler en une théorie cohérente et bien validée expérimentalement. De même que les « mémoires » d’un ordinateur (CD, DVD, disque dur, mémoire vive, mémoire cache, registres) diffèrent par leurs mécanismes, leurs capacités et leurs temps d’accès, de même, peut-on penser, le cerveau fait lui aussi appel à un ensemble de mécanismes, mais bien plus variés encore eu égard à sa formidable complexité. Dans ces conditions on ne doit pas être surpris que la neurobiologie soit encore dans une phase exploratoire, prenant progressivement la mesure de la difficulté de la tâche à laquelle elle s’est attelée, contrainte à des conjectures somme toute fragiles et fort éloignée des synthèses robustes et claires que tout chercheur ou vulgarisateur aimerait présenter pour sa propre satisfaction intellectuelle et celle de ses lecteurs !
- Cette diminution du nombre de neurones avec l’âge n’a pas été confirmé par les recherches ultérieures. Elle résultait d’erreurs systématiques dans les méthodes de comptage.
Sur la question du vieillissement voir la chronique n° 175, Pourquoi vieillit-on ? – Saura-t-on ralentir voire supprimer les effets de l’âge ?, mise en ligne le 11.01.2014.