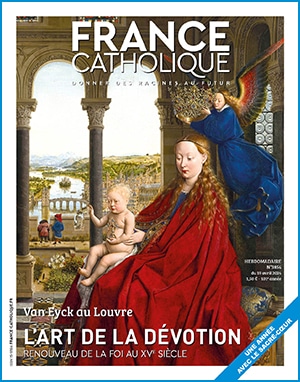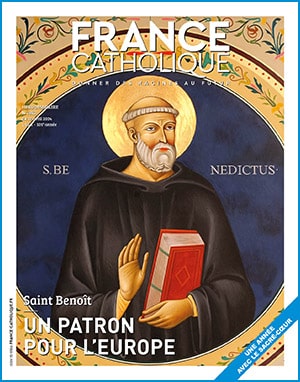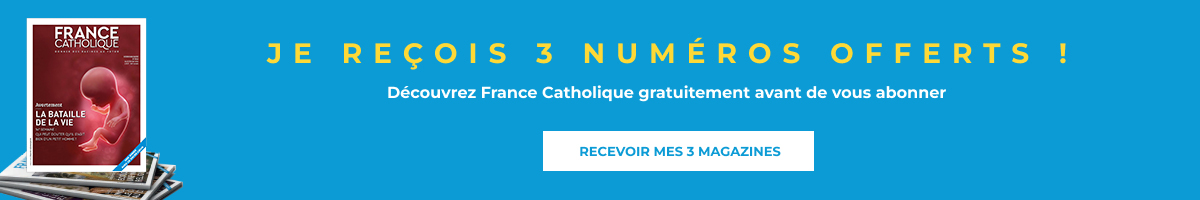7 février 2008
L’approche du quarantième anniversaire de mai 68 provoque une floraison en librairie où j’ai envie d’établir une sélection rigoureuse. Je suis rarement satisfait de ce que j’entends ou lis çà et là. Le discours-charge que Nicolas Sarkozy avait prononcé entre les deux tours des présidentielles à Bercy m’avait à la fois médusé et amusé. D’après Yasmina Reza, qui l’a suivi durant toute la campagne, le futur président aurait avoué que c’était « limite mauvaise foi » et que même c’était « terrifiant de mauvaise foi, mais enfin il faut y aller ! » (L’Aube, le Soir ou la Nuit – Flammarion) ; cela ne m’étonne pas. On peut certes développer des réquisitoires contre mai 68, mais ils devraient être autrement agencés et argumentés. Je ne crois pas du tout que l’esprit de mai se confondait avec le cynisme. Je plaiderais plutôt pour une certaine candeur. Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Ce pouvait être un mauvais remake du mauvais rêve révolutionnaire, l’illusion de recommencer Lénine sans sombrer dans le terrorisme d’État. Mais c’était aussi plus vraisemblablement l’illusion d’instaurer un monde neuf, transparent au pur désir, assez dans la tonalité de Marcuse. Et là on était dans l’apesanteur qui a d’ailleurs réellement existé en mai, et qui a durablement marqué certains de ses acteurs, en les transformant en inadaptés pour la vie.
Le cynisme, s’il s’est emparé de beaucoup d’ex-barricadiers s’est révélé beaucoup plus tard, avec l’absorption de l’esprit libertaire et ludique par le capitalisme de consommation qui a su admirablement jouer de la captation libidinale et des retombées de l’hypertrophie des idéologies du désir. Mais les plus lucides héritiers de mai 68 ont parfaitement compris cela et l’ont dénoncé avec beaucoup de pénétration. Je songe en premier lieu à Cornelius Castoriadis, infatigable dénonciateur de « la montée de l’insignifiance ». Castoriadis est, hélas, loin de nous, et je ne connais pas tellement d’héritiers véritables de l’esprit de mai, pour peu d’ailleurs que l’on puisse s’accorder sur un tel concept forcément problématique. Il y a une pluralité d’acceptions possibles et même si l’on s’accorde sur une originalité propre à l’événement, et qui défie les catégorisations courantes de la science politique, il n’est pas avéré que l’on sera sur la même longueur d’ondes. Par exemple, entre Castoriadis et Maurice Clavel il existe un abîme, et pourtant l’un et l’autre se retrouvent dans un climat de haute tension culturelle et politique, celui qui, brouillant tous les clivages et toutes les idées reçues, tente de faire émerger une autre appréhension de soi-même par le corps social, un instant sorti de ses routines existentielles.
On pourra toujours dire que tout cela ressortit trop de l’utopie pour pouvoir survivre au retour du réel. Mais il faut faire très attention à cette catégorie du réel car, parfois, le refoulé, que masque l’habitude, peut resurgir comme un réel redoutable. Castoriadis pense le refoulé à l’aune d’un imaginaire social qui pourrait aboutir à une reconstruction politique totale. Clavel le pense à l’aune de l’absolu, c’est-à-dire du Dieu présent dans l’histoire profonde d’un Occident qui ne se comprend que par l’intrusion en son sein de la révélation biblique.
Comment tomber d’accord sur mai 68 ? Il faudrait d’abord se retrouver sur une « méthode », au sens le moins technique du terme, c’est-à-dire un chemin qui mène à l’énigmatique et mystérieuse question qu’il nous pose. On y reviendra souvent.
12 Février
Je garderai l’anonymat quant aux convives de ce déjeuner dans une salle à manger d’un grand journal parisien. Mais il vaut mieux les caractériser par leurs fonctions et le symbolisme qui s’y rattache. J’étais le quatrième convive d’une table où il y avait un archevêque, un ancien ministre toujours très actif et un éditorialiste également universitaire. Des intellectuels de belle culture et de grande sagesse.
Il n’y eut à vrai dire qu’un sujet de discussion au cours de ce très agréable moment d’échanges : le religieux. Et l’athée des quatre n’était pas le moins passionné sur ce terrain qui lui paraissait le plus essentiel à notre société moderne. On me dira que la présence de l’archevêque expliquait ce tropisme de la conversation, mais ce n’est vrai qu’en partie. Elle lui donnait certes plus de réalité parce que nous disposions d’un témoin direct, d’un homme du terrain religieux qui nous permettait de demeurer « dans le réel » abordé. Je ne dirais pas qu’il était le plus prosaïque, mais, s’il ne perdait rien de nos éventuelles envolées spirituelles, il nous ramenait aux nécessités quotidiennes d’une Église qui sait comment se vit la foi dans la France d’aujourd’hui et quelles difficultés rencontrent chaque jour prêtres et fidèles.
Telle lycéenne qui a osé dire en début d’année qu’elle était chrétienne devant toute sa classe de terminale s’est trouvée soumise au harcèlement continuel du professeur de philosophie qui l’a prise pour cible de son ironie voltairienne. Joyeuse laïcité ! Et comment emmener aujourd’hui des jeunes en camps de vacances dans un but de formation spirituelle ? La législation est devenue tellement tatillonne qu’il vaut mieux partir en Afrique pour organiser un camp scout. Voilà des touches concrètes auxquelles le président Sarkozy ne songeait sûrement pas lorsqu’il a prononcé son désormais fameux discours du Latran. Cela explique que les évêques français ont des soucis assez étrangers à la révision de la loi de 1905, qui, avec la distance et les transactions discrètes qui ont suivi leur a donné une liberté inappréciable à l’égard du pouvoir politique.
Justement, notre discussion à propos de la laïcité montre un bel accord de fond assorti de nuances substantielles. C’est vrai qu’il n’y a ici aucun représentant de la laïcité idéologique et que tous réprouvent le laïcisme. Mais il y a tout de même débat sur la laïcité, si elle est autre chose qu’un accord empirique qui crée les conditions de la liberté de conscience et du libre exercice du culte. Pour l’ancien ministre c’est aussi l’arbitrage de la seule raison dans le domaine de la morale publique. Je n’ai pas voulu compliquer les choses en objectant qu’ainsi la laïcité risquait de devenir une option philosophique en soi, comme telle refusée par certains représentants éminents de la pensée politique moderne comme John Rawls. Cela nous aurait menés trop loin et puis il y avait quand même ce terrain commun de la raison, si cher à Benoît XVI et à Jürgen Habermas. Il s’agit, il est vrai, d’une raison ouverte car soumise à l’impératif de discussion. Et j’ajoute non fermée à l’interrogation religieuse.
Mais voici le plus remarquable de nos échanges. Le religieux demeure une instance d’identification personnelle et sociale indispensable. Il n’y avait, je pense, qu’un seul vrai sarkoziste engagé parmi nous en vis-à-vis avec un anti-sarkoziste déclaré. Mais nul ne songe à reprocher au président le fond de son discours du Latran. De ce point de vue, le script de notre conversation, s’il était publié par le journal qui nous recevait, en surprendrait plus d’un, et mettrait en grande colère la partie la plus laïquement idéologique de son public. En brisant un tabou, le président de la République a reçu l’accord, en partie secret, de beaucoup d’hommes de pensée très insatisfaits d’une prétendue neutralité qui aboutit à la neutralisation du débat.
Le silence imposé sur l’essentiel dans l’espace public pourrait bien correspondre au plus désuet des préjugés. Alors d’évidence, il y a aussi beaucoup de défenseurs de ce préjugé qui persistent et qui crient haut et fort leur « défense à Dieu d’entrer dans nos laboratoires ». Mais, il se pourrait bien que les choses ne fussent pas définitivement figées et qu’un discours comme celui du Latran et d’autres interventions aboutissent à la fin de la glaciation idéologique, une glaciation qui ne concernait pas seulement le défunt système soviétique.
15 Février
Mon fils aîné a voulu retrouver les deux chroniques que j’avais écrites sur Raymond Aron, notamment celle sur ses Mémoires parues au moment de sa mort. Je la relis et constate qu’écrite il y a vingt-cinq ans, elle développe strictement les mêmes arguments que ceux que j’ai énoncés ici-même. C’est un peu normal, puisque j’avais repris le volume des Mémoires et que j’y retrouvais ce qui m’avait particulièrement frappé, notamment les pages sur Gaston Fessard. C’est aussi parce que la thématique de l’histoire n’a cessé de me retenir à travers mes maîtres théologiens et aussi la pensée d’Henri-Irénée Marrou dont j’ai mieux compris à quel point elle était redevable à celle de Raymond Aron. Je viens de le vérifier avec les références contenues dans les Carnets posthumes du grand historien de l’Antiquité tardive (plubliés en 2006 au Cerf). Le cardinal Lustiger en avait rédigé la préface. Il connaissait bien l’auteur puisqu’il avait été son directeur spirituel. Marrou signale ce fait en usant d’une formule latine, avec ce développement impressionnant : « Regulae quaedem ad directionem animae, Lustiger curante Deo » [ Quelques règles pour la direction de l’âme, Lustiger avec l’aide de Dieu ] : l’acte de foi qui t’est demandé est de remettre entre les mains du seigneur le soin de faire de toi un saint. Tu n’as pas à te soucier de savoir si tu progresses (nul ne progresse jamais assez), ni de chercher comment y arriver. Tiens toi disponible et ne mets pas de coton dans tes oreilles. »
C’est une note datée des Cendres 1974. Jean-Marie Lustiger est alors curé de Ste-Jeanne de Chantal. Je présume que Marrou l’a connu dans la période précédente, celle de l’aumônerie universitaire. Mort le 11 avril 1977, l’historien n’a connu ni l’avènement de Jean-Paul II, ni la consécration épiscopale de Jean-Marie Lustiger. Ces événements correspondaient sans aucun doutes à ses vœux les plus chers. Mais j’en reviens à ses rapports avec l’auteur de l’Introduction à la philosophie de l’histoire. Marrou a lu la thèse d’Aron dès sa publication en 1938 et, dès lors, sa pensée n’a cessé de le stimuler.
Aron a reçu avec attention De la connaissance historique, en 1954, et il a formulé, de vive voix, à l’intéressé ses objections critiques. D’ailleurs, il est l’un des auteurs les plus cités de cet essai admirable et figure dans le tableau qui, en tête du volume, dresse une sorte de panorama géographique des penseurs du savoir historique. En reprenant le livre j’ai encore mieux pris conscience qu’avec les Carnets, Aron avait été peut-être son interlocuteur essentiel et qu’il n’avait cessé de penser avec lui en vis-à-vis, parfois contre lui, sans jamais pouvoir se passer de son savoir accumulé et de sa problématisation. En revanche, Aron est absent de Théologie de l’histoire que Marrou publia en 1968 (réédité par le Cerf en 2006). Comment aurait-il pu y figurer dès lors que cette notion ne peut correspondre pour lui qu’à un vide que faute de foi il est incapable de remplir, sans toutefois nier la possibilité qu’elle corresponde à une réalité ? Marrou : « La véritable histoire, celle qui a un sens, ne s’accomplit pas dans l’espace-temps empiriquement observable : Nous n’avons pas ici-bas de cité permanente mais nous sommes en route vers celle qui doit venir (He,13,14).
En reprenant Théologie de l’histoire, je m’aperçois que rien n’a vieilli dans la réflexion spéculative de l’historien, parce qu’il n’était pas prisonnier pour un sou des modes idéologiques. Il ne faut pas imaginer cette théologie construite sur le modèle des grandes philosophies de l’histoire, qui, au moment où Marrou composait son essai, faisaient encore la loi. Il échappait même à un certain teilhardisme fort en vogue dans les milieux chrétiens. Le cardinal de Lubac a beaucoup lutté contre cette tendance qui réduisait Teilhard à une sorte d’optimisme mondain obligatoire. Il a montré, avec des arguments et des citations convaincantes, que son ami jésuite n’ignorait rien des forces de dissociations qui menaçaient l’histoire des hommes.
En un mot, il n’est pas possible de renvoyer à Marrou le caractère obsolète des « grands récits » que la post-modernité aurait décrédibilisés. S’il a une vue surplombante du temps, le philosophe-théologien n’est pas assujetti à un déterminisme historique qui ordonnerait strictement le devenir de l’humanité. Toutes les figures de ce monde sont destinées à passer, elles sont transitoires. Saint Augustin parlait d’échafaudages provisoires, étant sauve la demeure destinée à durer. Saint Thomas parlait de réalités modestes à propos des articulations de sa propre pensée. Donc pas d’hypertrophies du grand récit mais différences des ordres, catastrophes toujours possibles avec la menace du mal et du péché.
Attention toutefois de ne pas se laisser aller à un pessimisme excessif ou à ce relativisme outré qui faisait dire au jeune Karl Barth que « tout cela était un jeu, une activité symbolique sans fins réelles ». Là encore, il ne faudrait pas qu’une idée prématurée de la gloire fasse oublier la théologie de la croix, celle qui, ici, nous révèle la précarité de la cité des hommes.