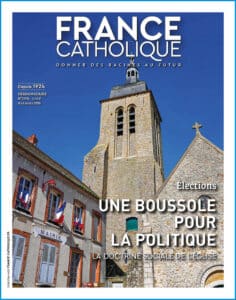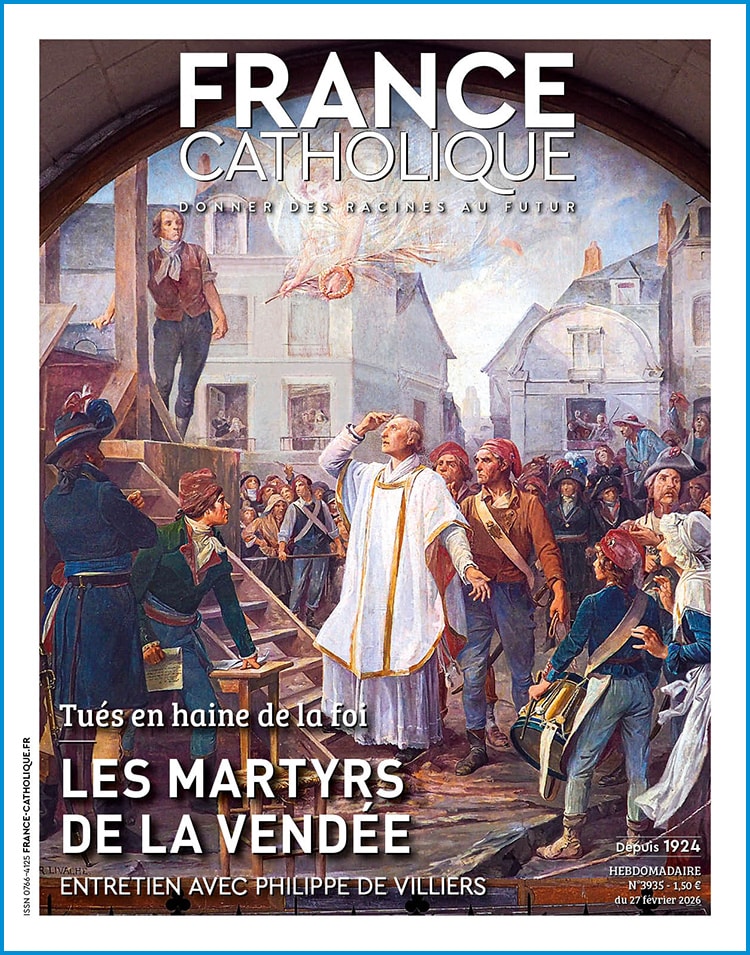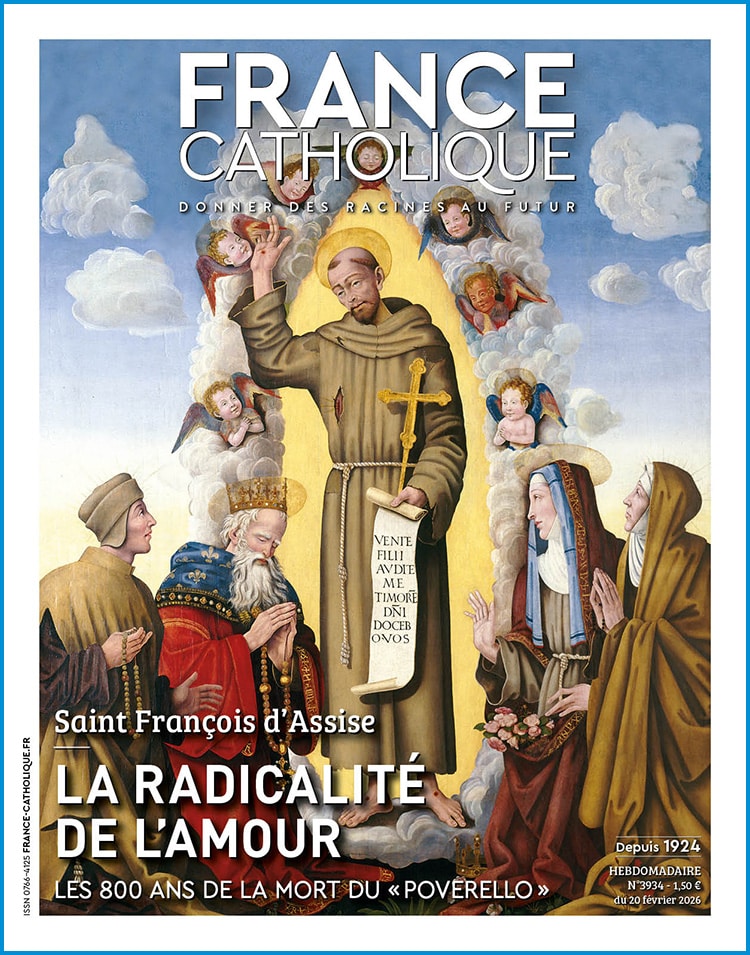— C’est tout ? dit le Sultan.
— C’est tout, dit le Vizir.
Le Sultan se tourna vers Zadig, son neveu.
— J’espère, dit-il, que tu tires profit des observations que tu fais ici en assistant à mon Conseil. J’espère que tu t’en souviendras quand je chanterai les louanges de Dieu dans un monde meilleur et que tu seras sultan à ma place. Je viens d’écouter pendant une heure la fade éloquence de mon ministre des Affaires étrangères. Il nous a assommés d’un tas de faits sans importance tels que rencontres de chefs d’Etat, signatures de traités, guerres, révolutions, et quand je lui demande si c’est tout, ce crétin répond oui.
— Mais, sire…
— Silence. Je vous paie pour me tenir au courant de ce qui est vraiment important. Le reste, c’est à vous de vous en occuper. Or, vous m’avez parlé de tout, sauf de ce marché de Sibérie que mon cousin Léonide est en train d’offrir aux marchands américains1.
— Mais, sire, justement, c’est une affaire de marchands, cela ne saurait vous intéresser ! Il n’y a là aucune politique, ou du moins rien de neuf : nous le savions depuis longtemps, que les Russes et les Américains brûlaient de déposer leurs armes au vestiaire pour discuter gros sous. C’est ce qu’ils font enfin, et quant à moi, je n’en suis point surpris. C’est dans l’ordre des choses. Votre Majesté n’ignore pas que les mêmes trafics sont en gestation entre les Chinois d’une part, les Japonais et les Américains de l’autre2. On se dispute, on se querelle, mais enfin, les affaires sont les affaires…
Choisis bien tes vizirs
— Ecoute bien cela, Zadig. Et quand tu seras sultan, sois plus habile que moi à choisir tes vizirs. Comment, monsieur, vous n’êtes pas étonné de cet événement, qui est, j’ose le dire, le plus extraordinaire survenu en matière de politique depuis 1917 ? Voulez-vous, je vous prie, expliquer à mon Conseil ce qui intéresse respectivement les Russes et les Américains dans ce marché de Sibérie.
— Très simple, dit le ministre. Du côté Russe, c’est la puissance technique et l’efficacité américaines. Ils savent que les Américains possèdent le secret de mettre sur pied aux moindres frais, en un temps record, et de façon qu’elle marche, n’importe quelle entreprise, si énorme soit-elle. Ils savent qu’il en coûtera beaucoup moins à leur pays de payer les Américains pour le faire que de le faire eux-mêmes, que ce sera plus vite fait, et mieux. Ils savent, en somme, que la technique américaine est inégalable.
Quant aux Américains, ce qui les aguiche, eh bien, les gazettes l’ont dit et redit. D’une part, l’argent n’a pas d’odeur, et un marché passé avec les Russes est une affaire de père de famille : l’État soviétique est stable, solide, sérieux, il paie rubis sur l’ongle, et avec lui on est garanti contre ces retours de bâton qui rendent les affaires si aléatoires dans les pays où l’on doit compter avec les fluctuations de l’opinion publique, avec des élections, aux résultats imprévisibles, avec des changements de politique ou même de régime. De plus, les Russes paieront en partie avec des matières premières3. Et enfin, la main-d’œuvre russe est bon marché, et il n’y a pas chez eux de troubles sociaux. Mettez-vous à la place des financiers américains : n’ont-ils pas lieu de préférer faire leurs affaires avec les Russes, plutôt que, par exemple, avec les Anglais, dont on ne sait ni si leur monnaie va tenir, ni s’ils ne vont pas renvoyer M. Heath, ni si leurs syndicats ne mettront pas le pays en grève ?4
— Et rien de tout cela ne vous étonne !
— Mais, dit le Vizir, pourquoi m’en étonnerais-je ? Qu’y a-t-il de plus naturel ? Je ne vois là, des deux côtés, que des calculs aussi évidents qu’élémentaires. Il n’y a aucune surprise, aucune subtilité. Je ne vois que deux pays réalistes passant sur leurs divergences idéologiques pour ne considérer que leurs intérêts respectifs. Si c’est le cynisme qui surprend Votre Majesté…
Des prophètes nommés Marx et Lénine
— Messieurs, je pense, dit enfin Sa Majesté. Je pense à un certain prophète appelé Marx, qui, voici cent ans, analysait les mécanismes de la misère et prônait une doctrine destinée à l’effacer de la surface de la terre en délivrant le travailleur exploité des griffes de son exploiteur. Vous rappellerai-je qu’alors le travailleur n’avait rien, qu’il travaillait de douze à dix-sept heures par jour, ainsi que son épouse et souvent ses enfants, sans autre assurance que celle de mourir dans le dénuement, la faim et la maladie. Marx expliquait très clairement les mécanismes économiques qui fondaient à la fois cette horrible condition et la prospérité de la classe possédante. Il énonçait les règles de la révolution appelée à y mettre fin. Son analyse était si claire, si convaincante, les objectifs qu’il assignait si évidents, que sa doctrine inspira dès lors plus ou moins directement toutes les luttes des travailleurs exploités5.
Je pense aussi, poursuivit le Sultan, à un autre prophète nommé Lénine, qui consacra sa vie à établir le système décrit par Marx dans le plus vaste pays du monde. Ce devait être le paradis des travailleurs, celui d’où toute trace d’oppression serait effacée. En même temps, ce paradis des travailleurs serait celui de la science libératrice, donc du progrès, car la doctrine de Marx se voulait fondée sur la science. Je pense enfin à l’immense effort de millions et de millions d’hommes pour réaliser ce formidable projet, à ceux, innombrables, qui moururent à l’édifier.
Et tout cela pour aboutir à quoi ? Au marché de Sibérie. Au stupéfiant spectacle des petits-fils de Marx et Lénine offrant sur un plateau d’argent au capitalisme triomphant non seulement l’exploitation de leurs matières premières, mais celle de leurs travailleurs : « Venez, venez chez nous, il n’y a pas de grèves, et les salaires sont bas. »
Le Sultan se tut. Zadig se racla la gorge :
— Mais, sire, dit-il, dans l’idée des dirigeants russes, ce marché n’est qu’un épisode tactique dans la lutte contre l’impérialisme ; Marx a prévu que plus le capitalisme progresse et plus il voit ses contradictions s’aggraver. Le marché sibérien aura pour résultat, du côté américain d’exciter un peu plus encore les tensions internes dont souffre l’Amérique, et du côté russe la modernisation de la Sibérie. C’est donc un calcul révolutionnaire légitime.
— Je ne vois pas que ces fameuses tensions internes troublent beaucoup l’Amérique. Je ne vois pas qu’elles l’empêchent de s’enrichir sans cesse, d’accroître sa puissance, de renforcer sa maîtrise universelle. Bien au contraire. Ce que je vois, c’est plutôt qu’elles la talonnent sur la voie de l’évolution technique, économique, scientifique et même sociale. A supposer même que cela doive mal finir, ce qui reste à prouver, je voudrais que quelqu’un m’explique pourquoi les Russes ont besoin de ce marché, et quelle est la cause du sous-développement dont ils souffrent. Au moment de la Révolution d’octobre, la Russie était certes sous-développée. Mais pas plus que la Pologne, les Pays baltes, la Finlande, qui d’ailleurs faisaient partie de l’empire russe, pas plus que la Roumanie, la Bulgarie et les pays de l’actuelle Yougoslavie. Actuellement, en 1970, le revenu moyen du Russe vient en queue de tous les pays de l’Est. Pourquoi ? Il y a peut-être des causes que j’ignore. Mais la principale que je distingue entre ces pays, c’est que la Russie est communiste depuis cinquante ans, et les autres depuis vingt-cinq ans seulement. Si le régime n’est pas la cause du retard, comment expliquer l’échec universel des divers socialismes sur le plan économique et technique ? Comment comprendre que la Tchécoslovaquie, qui égalait l’Occident en 1945, est très loin derrière lui en 1972 ?6
Le système imaginé par Marx et Lénine ne marche pas. Ou plutôt, il ne marche (admirablement) que pour faire la révolution. C’est une république qui n’est belle que sous l’Empire. Tant qu’il n’est pas au pouvoir, il constitue un moteur politique presque irrésistible, enflammant les foules, séduisant les intellectuels, armant les guérilleros.
Puis, il prend le pouvoir, et aussitôt tout se gâte.
Il y a toujours un texte
Le dynamisme devient immobilisme, l’organisation pagaïe, l’ardeur dégoût. Son échec est universel, sauf sur un point : la stabilité du pouvoir. Et dès lors tout se déroule comme une mécanique d’horloge pour inévitablement aboutir au marché sibérien. Quand le retard économique devient politiquement dangereux sur le plan international, le pouvoir socialiste n’a plus d’autre choix que d’offrir ses marchés à l’ennemi. Rien ne l’empêche d’agir ainsi, et tout l’y pousse. Rien ne l’empêche : son autorité intérieure est illimitée, il n’a pas d’opposition à convaincre, pas d’opinion publique à ménager. Tout l’y pousse : c’est la solution la plus facile, celle qui assure sa survie dans le moindre effort, et l’inépuisable Marx fournira toujours un texte pour la justifier.
De sorte que la destinée des partis communistes semble être d’abord de supprimer le capitalisme dans les pays où ils prennent le pouvoir pour préparer à long terme la néocolonisation de ces mêmes pays par le capital étranger. De devenir en somme les gestionnaires d’un colonialisme ressuscité. Ce colonialisme est très différent de l’autre. Il gèle pour ainsi dire les relations d’hostilité en les cantonnant dans le verbalisme politique. On s’insulte en faisant des affaires.
Comment cela finira-t-il ? Qui peut se flatter de le savoir ? Mais je trouve, messieurs, que cette époque est bien intéressante. Rien ne s’y passe comme prévu. Zadig, mon neveu, toi qui gouverneras après ma mort, je te souhaite bien du plaisir.
Aimé MICHEL
Chronique n° 115 parue dans France Catholique — N° 1350 — 27 octobre 1972
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 4 janvier 2014
Pour aller plus loin :
- Dans la présente chronique, comme dans la précédente de la série des Zadig, n° 95, Du bon usage des ennemis – Zadig IV ou pourquoi les Américains avaient intérêt à la Révolution d’Octobre (07.01.2013), parue quelques mois auparavant, Aimé Michel poursuit sa réflexion sur le communisme en URSS. Quatre ans plus tard il évoquera à nouveau les investissements américains prévus en Sibérie (chronique n° 244, La bataille de Kent State University – Le repli américain ne signifie pas la fin de la suprématie américaine, 21.10.2013). Même si ces investissements-là ne se sont pas faits, la prééminence des intérêts économiques ces dernières quarante années a été manifeste : « On s’insulte en faisant des affaires ».
- Les relations entre les États-Unis et la République populaire de Chine ont été longtemps fort limitées. C’était une conséquence des guerres de Corée et du Vietnam et de l’alliance des États-Unis avec la Corée du Sud, le Japon et Taïwan, trois pays entretenant avec la Chine des relations conflictuelles. Jusqu’en 1972 il n’y eut pas de relations diplomatiques entre les deux pays et Washington tenait la République de Chine à Taïwan comme le gouvernement légitime de la Chine continentale. Tout changea avec la rupture sino-soviétique et la visite surprise de Nixon à Pékin à l’invitation de Mao Zedong en février 1972 (voir la chronique n° 48, Les casseurs de Babylone, 05.07.2010). Dès lors les États-Unis et la Chine commencèrent à renouer des relations commerciales, qui n’ont cessées de se développer depuis, en dépit des tensions diverses entre les deux pays. L’interdépendance de leurs économies est aujourd’hui considérable compte tenu des investissements américains en Chine, de la part de la dette publique américaine détenue par la Chine, et du déficit commercial américain (qu’il faut toutefois relativiser car les méthodes comptables actuelles le surévaluent, voir la chronique n° 192, La culture qui vient par les airs, L’urgence d’un humanisme scientifique dans un milieu spirituel technico-scientifique, 02.09.2013).
Le déblocage des relations sino-américaines entraîna celle des relations sino-japonaises. Le Japon a commencé à faire fabriquer en Chine des pièces détachées nécessitant beaucoup de main d’œuvre. Il en est résulté un fort accroissement des échanges. Après avoir favorisé les investissements aux États-Unis et en Europe, le Japon s’est tourné vers l’Asie et la Chine à partir des années 80. A la fin des années 1990, la croissance de la consommation domestique chinoise et l’entrée de la Chine à l’Organisation Mondiale du Commerce en 2001, ont conduit à accroître l’activité des entreprises japonaises dans ce pays (voir web-japan.org).
- Cette remarque apparemment anodine sur le fait que l’URSS paie « en partie avec des matières premières » traduit concrètement le retard technologique et économique du pays. Ce fait sera utilisé quatre ans plus tard par Emmanuel Todd pour établir la réalité de ce retard, voir la recension de son livre la Chute finale (Laffont, 1976) dans la chronique n° 270, C’est la « chute finale » ? – Comment Emmanuel Todd démontra que l’URSS était un pays sous-développé (11.11.2013).
- La Grande Bretagne traversa une période difficile de 1972 à 1974. Edward Heath (1916-2005), Premier ministre conservateur de juin 1970 à février 1974, eut à faire face à une montée du chômage (qui passa officiellement de moins de 600 000 en juin 70 à plus d’un million en janvier 72) et à une inflation galopante que l’opinion imputa à l’entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun en janvier 1972. Par 5 fois il aura recours à l’état d’urgence pour assurer le ravitaillement et faire face aux conséquences des grèves des mineurs (deux fois), des dockers (deux fois) et des salariés du secteur électrique (une fois).
Les grèves de mineurs surtout frappent les esprits. Elles se situent dans un contexte à long terme de déclin des charbonnages : en 1947, 704 000 mineurs produisaient 200 millions de tonnes de charbon par an. En 1974 les mineurs sont encore 252 000 et produisent 130 millions de tonnes. A la fin de 1983, 186 000 mineurs fournissent environ 100 millions de tonnes : sur cette période la productivité double presque tandis que la production chute de moitié et le nombre de mineurs des 2/3 du fait d’une réduction d’usage du charbon.
Le 9 janvier 1972, les mineurs se mettent en grève car ils contestent l’augmentation de salaire de 7,9% annuel qui leur est proposée (ils veulent 11%). L’arrêt des centrales électriques qui en résulte affecte toute l’économie du pays. Après 47 jours d’arrêt les mineurs obtiennent une augmentation de plus de 8% et reprennent le travail. En juin de la même année, abandonnant sa politique néolibérale, Heath décide d’encadrer le crédit, de bloquer les prix et les salaires et de nationaliser Rolls Royce (voir la note 1 de la chronique n° 27, L’ordinateur-roi, 12.07.2010). Du 28 juillet au 21 août 1972 c’est au tour de 42 000 dockers d’arrêter le travail. En février 1974, les mineurs se mettent à nouveau en grève pour améliorer encore leur situation par rapport aux sidérurgistes et aux électriciens avec lesquels ils se comparent et conserver leur statut de catégorie la mieux payée de la classe ouvrière. Heath dissout le Parlement et convoque de nouvelles élections législatives qu’il perd. Il doit démissionner et céder la place au travailliste Harold Wilson qui accorde ce qu’ils veulent aux mineurs…
- Aimé Michel décrit dans des termes semblables la profonde influence sur Rousseau dont « le Contrat social est tellement évident, tellement irrésistible » qu’un lecteur du XVIIIe siècle ne pouvait qu’être « transporté d’enthousiasme et désireux de faire descendre sur terre cette société si facile à établir, si simple, si juste, si gratifiante » et que « se laisser entraîner à tout sacrifier pour un idéal si beau, si parfait, si rédempteur d’une histoire jusque-là criminelle » (Anniversaire 1778-1978 : Voltaire et Rousseau, dans La clarté au cœur du labyrinthe, pp. 387-389). C’est un exemple parmi d’autres de la tendance naturelle des hommes à se laisser entraîner par leurs raisonnements sans tenir compte des réalités.
- Sur la Tchécoslovaquie voir la note 5 dans la chronique n° 220, La crise dans les pays de l’Est (II) – Avantages et inconvénients de la vie dans les pays de l’Est (13.08.2012).