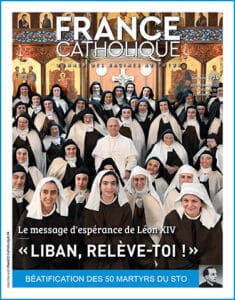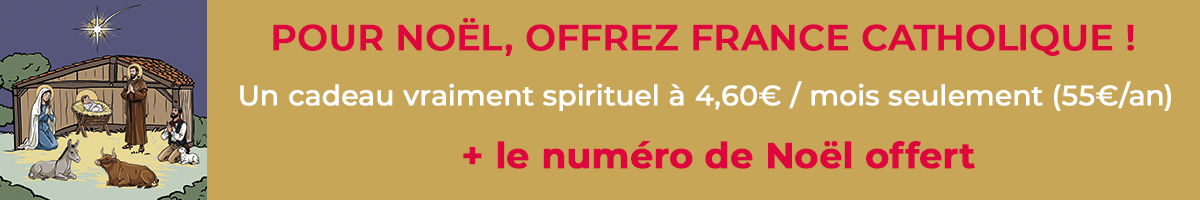Édouard de Castelnau naît à Saint-Affrique le jour de Noël 1851. Son père, Michel, qui est avocat et sera maire de la ville de 1882 à 1884, mène une vie aisée de propriétaire terrien : il se consacre à l’éducation de ses enfants qu’il veut voir quitter l’étroit milieu saint-affricain.
Petit, sec, râblé, sportif – ce qu’il restera toute sa vie – Édouard, après une scolarité brillante au collège Saint-Gabriel à Saint-Affrique puis au collège Sainte-Geneviève à Paris (alors que son frère Clément prépare Polytechnique pour devenir un brillant ingénieur des Mines), entre à Saint-Cyr en 1869. Il achevait sa première année d’école quand la guerre franco-allemande éclata. Le ministre de la Guerre décréta la promotion anticipée des élèves de première année ; le sous-lieutenant de Castelnau fut affecté à un régiment qui périt dans la bataille de Sedan et qu’il ne put rejoindre.
Après l’abdication de Napoléon III, le gouvernement de la Défense nationale créa de nouvelles armées pour résister aux Prussiens qui envahissaient la France. Le lieutenant de Castelnau combattit dans l’Armée de la Loire pendant le dur hiver 1870-1871. Promu capitaine en raison de son dynamisme et de son courage, il prit une part active à la bataille du Mans, dernier combat avant l’armistice de janvier 1871. La Commission de révision des grades ne pouvait conserver le grade de capitaine à un officier de vingt ans mais compte tenu de sa conduite au feu, elle lui attribua le grade de lieutenant avec ancienneté. Affecté à un régiment d’infanterie à Laon, il fut nommé capitaine en 1876, entra à l’École de Guerre en 1878 et en sortit breveté en 1880. Affecté au 39e régiment d’infanterie de Toulouse, il va rester dix ans à Toulouse, alternant les commandements de troupes et les fonctions d’état-major au 17e corps d’armée.
Ce long séjour s’explique par des considérations pratiques ; à l’époque, les soldes des officiers étaient faibles et ne permettaient pas d’entretenir sa famille dans des conditions convenables ; or, Édouard de Castelnau épouse à Toulouse, une parente de sa mère : Marie Françoise Barthe de Mangdebourg qui hérite de propriétés foncières à Montastruc-la-Conseillère, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Le jeune officier, incité à démissionner par sa famille, put donc continuer sa carrière tout en surveillant la gestion des propriétés de sa femme qui lui donna douze enfants.
Devenu spécialiste de la mobilisation, le chef de bataillon de Castelnau est affecté en 1893 au 1er bureau de l’état-major de l’Armée à Paris. Ce bureau avait pour mission de préparer le passage de l’armée française de la posture de temps de paix à celle de la guerre contre un ennemi qui ne pouvait être que l’Allemagne. En effet, en temps de paix, l’armée était répartie sur tout le territoire : un régiment d’infanterie à Rodez, une division à Albi, un corps d’armée à Toulouse ; ces unités étaient pourvues d’officiers et sous-officiers d’active qui entraînaient les conscrits faisant leur service militaire, à l’époque de deux ans. Au moment de la déclaration de guerre, il fallait positionner toutes les unités face à la frontière allemande, ce qui était un problème logistique considérable puisqu’il fallait organiser le mouvement de près d’un million d’hommes avec leur matériel : problème de chemin de fer et de répartition des troupes. Chaque unité d’active devait donner naissance, dans sa caserne de départ, à une unité de réserve constituée après appel de nouvelles classes d’hommes de troupes et d’officiers.
On gardait un mauvais souvenir du début de la guerre de 1870 ; le rassemblement de l’armée impériale face à l’Est s’était produit dans le désordre. Après son temps de commandement, le lieutenant-colonel de Castelnau devint chef du premier bureau de l’état-major de l’Armée.
À l’arrivée du général André, en 1899, au ministère de la Guerre, il fut écarté du premier bureau, le ministre voulant épurer une « jésuitière » ; il faut reconnaître que l’état-major de l’Armée avait été pendant trop longtemps, par conformisme et étroitesse d’esprit, convaincu de la culpabilité de Dreyfus.
Nommé colonel en 1900, Édouard de Castelnau prend le commandement du 37e régiment d’infanterie à Nancy dont il fait une unité exceptionnelle grâce à des exercices fréquents, des marches prolongées, colonel en tête. Castelnau est attentif à la vie du soldat, fait installer l’électricité dans les casernes – c’est une première – et veille à l’hygiène et à la nourriture des troupes.
À l’issue de son temps de commandement, Castelnau pense qu’il n’obtiendra pas les étoiles de général ; le ministre de la Guerre – le général André qui restera cinq ans à ce poste – poursuit une politique de discrimination à l’égard des officiers ayant des convictions religieuses affirmées, ce que révèle en 1904 le scandale de l’affaire des fiches ; le cabinet du Ministre se faisait renseigner par les loges maçonniques sur les opinions religieuses et politiques des officiers. Castelnau y est cité comme officier à ne pas promouvoir « car catholique pratiquant ». Ces fiches révélaient que les opinions politiques des officiers formaient le critère exclusif des promotions accordées mais aussi des carrières brisées ou placées sur une voie de garage. Plus de cent officiers généraux devront être « limogés » pour insuffisances au début de la guerre de 1914.
Arrive 1905 et le coup de Tanger ; on découvre que l’armée française n’est pas prête pour affronter le Reich de plus en plus arrogant et vindicatif. Le successeur du général André nomme, en 1906, Castelnau général de brigade commandant la 7e brigade à Soissons. Devenu général de division, en 1909, il commande la 13e division à Chaumont.
Il a l’occasion de faire une conférence à l’École de Guerre, que dirige Foch, dans laquelle il s’oppose à la doctrine de l’engagement immédiat et de l’offensive à outrance prônée par le colonel Grandmaison. Il estime que les unités de réserve ne peuvent être immédiatement lancées dans la bataille avant d’avoir été entraînées et d’avoir une cohésion suffisante. De son côté, Pétain enseigne que le « feu tue » et que l’artillerie est nécessaire mais qu’elle se déplace lentement. Ce faisant, Castelnau s’oppose au généralissime désigné, le général Michel, partisan de l’offensive toutes forces réunies ; ce qui suppose d’envahir la Belgique neutre pour s’affronter en plaine avec les armées allemandes.
Ces divergences d’apparence technique – utilisation des réserves – cachent des fractures d’essence politique. En effet, quelques années avant 1914, alors que l’Allemagne est menaçante (coup de Tanger en 1905, puis d’Agadir en 1911), la France et ses faibles gouvernements, découvrent qu’il faut se préparer à la guerre contre un adversaire dont la population (60 millions d’habitants) est supérieure de 50 % à la nôtre (40 millions). Or, tout le monde – politiques et militaires – estime que l’infanterie est la reine des batailles et que la guerre ne peut résulter que du choc de deux armées dont l’une détruira l’autre ; la guerre ne peut être que courte, non seulement à cause des pertes en vies humaines (140 000 unités en 1870 avaient paru considérable) mais également, en raison de l’épuisement des stocks de munitions, l’accroissement des fabrications demandant du temps ; c’est la conception de la guerre napoléonienne avec des campagnes de quelques mois ; la conception de l’offensive à tout prix que l’on enseigne à l’École de Guerre.
La valeur de l’offensive avait pris un caractère tout à fait abstrait – elle allait se transformer en mystique, écrira le général de Gaulle. Sur le plan tactique, cela se traduisait par la croyance générale – sauf exceptions, Pétain, Castelnau – en la prédominance de la manœuvre sur le feu. Il en résulta le règlement du 18 octobre 1913 sur la conduite des grandes unités qui s’exprimait ainsi : « La conduite de la guerre est dominée par la nécessité de donner aux opérations une impulsion vigoureusement offensive. La bataille une fois engagée doit être poussée à fond, sans arrière-pensée jusqu’à l’extrême limite des forces. » […] Castelnau comme Foch est partisan de la manœuvre, c’est-à-dire du mouvement des grandes unités avec toujours le souci de la sécurité : une unité, attaquée sur son flanc ou à la jointure avec son voisin, est en situation de faiblesse.
[…] Castelnau, en juillet 1914, déclarait au cours d’une manœuvre de la 11e DI : « La retraite peut parfois être une manœuvre qui permet de se ressaisir et de regrouper ses forces en vue d’une nouvelle bataille. Elle ne doit jamais être une fuite. Dans toute action défensive, il y a une ligne qu’il n’est pas permis de dépasser. Derrière le gouffre où sombre notre honneur, cette limite d’extrême résistance, c’est l’endroit où on se fait tuer. On peut mourir n’importe où. On ne se fait tuer que là. Le choix de cette position est d’importance capitale car elle constitue la clé de chaque bataille. » À cette doctrine équilibrée, s’oppose celle de l’offensive de masse « en pantalon garance ».
Cette mystique de l’offensive – les Allemands y croyaient également mais donnaient plus d’importance au feu donc à l’artillerie lourde – entraînait, pour la France, la limitation de tout ce qui pouvait ralentir le mouvement des troupes et notamment l’artillerie, limitée à un matériel de campagne de bonne qualité certes – le 75 – mais d’une portée inférieure à celle des canons allemands.
La France, à partir des années 1890, avait manifesté une inventivité technique importante : invention du cinéma, de l’aviation, de la télégraphie sans fil, de l’automobile, mais l’intérêt porté par l’état-major à ces inventions fut faible – Castelnau était le seul à croire dans l’aviation comme outil d’observation du champ de bataille – si bien que l’armée de 1914 comptait principalement sur ses chevaux, ses ballons captifs et ses pigeons voyageurs pour gagner les batailles futures.
Castelnau avait conscience de cette insuffisance au point que, devenu collaborateur de Joffre, il fit une intervention percutante au cours du Conseil supérieur de la Guerre du 3 mars 1913, en présence du président de la République Poincaré, dans laquelle il dénonçait les insuffisances du matériel et des approvisionnements : « L’armée française est une armée de pouilleux. » Stupeur générale devant cette sortie si peu protocolaire. Il fut décidé que l’état-major présenterait une demande de crédits pour l’artillerie lourde, l’aviation, le matériel automobile, les munitions, les uniformes de guerre moins visibles. Ces crédits furent votés, en juillet 1914, trop tard.
Enfin, la doctrine de l’offensive de masse impliquait de gros bataillons bien entraînés donc une armée d’active encadrant des conscrits issus d’un service militaire de plusieurs années.
Les partis politiques étaient divisés sur ces questions ; les partis de droite suivaient l’état-major ; la gauche – radicaux et socialistes – se méfiait de l’armée suspectée d’influencer les conscrits et voulait un service militaire court, des réserves sans entraînement. Au nom de l’armée, c’est la « nation en armes », Jaurès préconisait une armée de milice qui par sa masse – tous les Français mâles – suffirait à décourager toute attaque.
Enfin, dernier aspect de la doctrine stratégique de l’offensive en vue de détruire l’armée adverse, elle supposait un champ de bataille relativement plat c’est-à-dire que le généralissime envisageait une entrée des troupes françaises en Belgique dès le début des hostilités.
Or, le gouvernement ne peut envisager une entrée des troupes françaises en Belgique alors que l’Angleterre a fait savoir qu’elle ne s’engagera aux côtés de la France que si la neutralité belge était sauvegardée.
Devant ce conflit de doctrines, le gouvernement, en 1911, retire sa lettre de commandement au général Michel, généralissime désigné ; il le remplace par un général « républicain », Joffre, qui avait fait carrière aux colonies et n’avait pas commandé d’armée.
Joffre y met une condition : avoir Castelnau comme chef d’état-major, qui deviendrait en cas de guerre son major général ; cette désignation – que Castelnau ne réclamait pas : il se fit même désirer – se justifiait parce qu’il avait exercé des commandements importants et qu’il était un spécialiste reconnu de la mobilisation. Fureur de la gauche qui dénonce le « capucin botté ». Solution de compromis : le général Dubail devient chef d’état-major général responsable en cas de guerre des services de l’intérieur (fabrication d’armement) et le général de Castelnau est nommé Premier sous-chef d’état-major général chargé en temps de guerre des fonctions de major général des armées en campagne.
En outre, le gouvernement demande au Parlement de porter la durée du service militaire à 3 ans, revenant sur la loi de 1905 qui l’avait fixé à deux ans. La disproportion des moyens humains était devenue trop importante : 700 000 hommes d’active en Allemagne qui devaient être portés à 850 000, 500 000 hommes en France pour les effectifs de l’armée d’active dont une partie devait demeurer dans les colonies.
Déposé en mars 1913, le projet de loi suscite une intense opposition des socialistes : Jaurès, partisan d’un service de 18 mois, lui oppose son système de milice. Le gouvernement Briand est renversé sur une autre question – la loi électorale – et est remplacé par un gouvernement Barthou qui obtient, après des débats longs et houleux, en juillet, le vote de la loi grâce à l’appui de Clemenceau au Sénat. Mais faute de pouvoir faire voter la création d’un impôt sur le revenu, le financement de l’effort de Défense nationale est reporté sur l’emprunt et on oublie de prévoir des crédits pour financer la constitution de réserves entraînées.
Pendant ce temps, Castelnau, toujours attaqué par la presse de gauche, prépare auprès de Joffre la mobilisation : c’est le fameux plan XVII.
Pourquoi XVII ? Parce que depuis 1890, l’état-major a élaboré 16 plans de concentration des unités de l’armée française aux frontières résultant de la défaite de 1870. L’exercice est particulièrement compliqué parce qu’il dépend de données que l’état-major ne maîtrise pas alors que la frontière de 1871 est sans obstacle géographique sérieux au Nord et comporte des « trouées » importantes à l’Est, au Nord des Vosges, trouées de Charmes, de Stenay, et au Sud de ce massif (trouée de Belfort) sans parler des risques de traversée de la Suisse.
Que va faire l’armée allemande alors que du fait de l’alliance de la France avec la Russie, elle doit faire face à deux théâtres d’opérations ?
Faut-il mobiliser rapidement en cas de guerre sans savoir où placer les unités ou prendre son temps sachant que pour des raisons d’effectifs, la France ne peut pas aligner une ligne continue de troupes de Belfort à Dunkerque ?
Faut-il mobiliser sans savoir ce que va faire l’armée allemande sur le front Ouest : invasion de la Belgique ou non ?
Le gouvernement et l’état-major vont répondre à ces questions de la manière suivante :
– L’Allemagne attaquera la France avant la Russie car tout le monde sait, depuis la campagne de 1812, que la Russie est immense et que la destruction de son armée demande du temps ;
– Il faut mobiliser rapidement pour que les troupes qui sont organiquement à la frontière soient immédiatement épaulées par des troupes d’active, les réserves étant destinées à compléter les troupes d’active en cas de pertes.
– Il faut faire l’hypothèse que l’Allemagne ne pénétrera pas en Belgique car elle sait que dans ce cas, l’Angleterre viendra soutenir militairement la France sur son territoire ; elle l’a fait savoir publiquement. Cette hypothèse implique que la frontière franco-belge est dégarnie en troupes d’active.
Le plan XVII comporte donc l’alignement de cinq armées françaises le long de la frontière franco-allemande
– la Ire armée (général Dubail) à cheval sur les Vosges, de Belfort à Épinal face à l’Alsace,
– la 2e armée (général de Castelnau) de Lunéville à Toul par Nancy, face à la Lorraine allemande,
– la 3e armée (général Ruffey) sur la Meuse et jusqu’à Verdun, face au Nord Est,
– la 4e armée (général de Langle de Carry) en réserve derrière les trois premières à Commercy, assurant ainsi la souplesse du dispositif,
– la 5e armée (général Lanrezac) de Verdun à Mézières.
L’armée britannique doit se placer face à la Belgique à la gauche de l’armée française (région de Maubeuge). Un groupe de divisions territoriales est placé dans la région de Lille. L’armée britannique doit se placer face à la Belgique à la gauche de l’armée française (région de Maubeuge). Un groupe de divisions territoriales est placé dans la région de Lille.
Le plan XVII était un programme de mobilisation et de transports, élaboré par Castelnau avec beaucoup de minutie mais nullement un plan d’opérations que le général en chef désigné entendait, à juste titre, se réserver au moment de la déclaration de guerre. Ce plan fonctionne, en août 1914, avec précision et rapidité : 1,3 million d’hommes d’active et de réserve se trouveront positionnés à l’emplacement qui leur était assigné.
Castelnau devient, en mars 1914, membre du Conseil supérieur de la Guerre ; il est désigné pour commander la 2e Armée qu’il rejoint à Neufchâteau. Il ne devient pas comme prévu, major général du commandant en chef Joffre, qu’il quitte parce qu’il n’a pas les moyens de s’opposer à une équipe de jeunes officiers imbus de la doctrine de l’offensive à outrance (général Berthelot, commandant Gamelin…).
Le général de Castelnau et la guerre de 1914
Il n’est pas aisé d’isoler la participation d’un chef militaire à la guerre de 1914-1918 pour un certain nombre de motifs :
a. Cette guerre est mondiale. Elle voit s’affronter deux coalitions – le Reich allemand, l’Empire austro-hongrois, l’Empire ottoman – contre les Alliés à savoir la France, la Grande-Bretagne et son Commonwealth, la Belgique, la Russie et in fine, l’Italie. Ceci implique un certain nombre de théâtres d’opérations qui se commandent les uns les autres car les troupes qui sont dans un secteur ne sont pas dans l’autre ; or les gouvernements ne donnent pas, pour des raisons politiques, la même importance aux théâtres d’opérations dans l’utilisation de ressources humaines nécessairement limitées. Et la coordination entre eux se fait mal. Pour alléger le front de l’Ouest, les Alliés suscitent des fronts en Orient (Castelnau fera une mission à Gallipoli, visitera le front russe).
b. Les gouvernements de la IIIe République qui n’ont jamais dirigé une guerre sont divisés malgré l’Union Sacrée constatée en 1914 ; le Président de la République, Poincaré, a peu de pouvoirs même s’il s’implique beaucoup dans la politique des gouvernements successifs. Il faudra attendre la fin de 1917 pour que Clemenceau, assurant une quasi-dictature, prenne d’une main ferme la conduite de la guerre.
c. Divisés, les hommes politiques s’immiscent dans la conduite des opérations en soutenant certains généraux et en en critiquant d’autres. Ce sont eux qui imposeront Nivelle, en 1916, en remplacement de Joffre alors que Foch auquel certains pensaient, était en disgrâce.
d. Le gouvernement comporte un ministre de la Guerre ; si c’est un personnage falot, il se contente d’essayer de résoudre les problèmes de la mobilisation industrielle (Millerand) et couvre le général en chef ; si c’est une forte personnalité comme Clemenceau, il cumule la présidence du Conseil et le ministère la Guerre et le généralissime lui est subordonné. Mais si c’est un général que les politiques ont nommé comme ministre de la Guerre et s’il est doté d’une personnalité certaine – Gallieni, Lyautey – c’est le conflit garanti avec le généralissime.
e. La guerre sur le front principal a comporté deux phases d’inégale longueur : la bataille des frontières suivie de la victoire de la Marne et de la course à la mer (six mois), la guerre des tranchées du Nord des Vosges à la mer du Nord (trois ans et demi) avec son cortège de souffrances quotidiennes et de lent épuisement physique et moral du combattant et le risque que le renoncement ne gagne les esprits et le pays tout entier.
f. Dans la phase de la guerre des tranchées, les chefs militaires ont des conceptions différentes ; pour les uns, il faut à tout prix percer le front en écrasant les tranchées ennemies sous les feux de l’artillerie afin de se donner une capacité de manœuvre ; pour les autres, cette façon de faire, apparaît de plus en plus coûteuse en vies humaines, l’ennemi faisant venir des réserves pour combler la brèche ; d’autres chefs soutiennent qu’il faut adopter une position défensive en profondeur et attendre l’attaque ennemie avec le risque que, si elle réussit, Paris ne se trouve sous les canons allemands (voir la grosse Bertha à Pâques 1918). D’autres enfin, constatant que le soldat s’épuise dans des tentatives de percées désordonnées estiment qu’il faut attendre les tanks – arme nouvelle – et les Américains, nouveaux alliés, et que la charge à la baïonnette, en faveur au début du conflit, est totalement dépassée. Les généraux ne manquent pas de développer leurs arguments auprès des parlementaires qui les visitent, déclenchant des campagnes plus ou moins relayées par la presse, malgré la censure, en faveur de l’un ou de l’autre.
g. Le courage, l’endurance de millions de combattants ont plus fait pour l’issue du conflit que la science militaire des généraux dont les « politiques » finissent par douter à mesure que la guerre s’éternise : crise du haut commandement en 1915, puis en 1917 et 1918.
h. Enfin, il faut ajouter qu’après la victoire, tous les grands chefs militaires dont la popularité était immense ont écrit ou fait écrire – à l’exception de Castelnau – des mémoires et, à cette occasion, ont eu tendance à magnifier leur rôle et à dénigrer leurs collègues. […]
La bataille des frontières
Cette bataille est un échec pour la France même si elle a permis la victoire de la Marne. Il convient donc de l’analyser tout en sachant qu’on ne reconstruit pas l’action des hommes a posteriori faute de connaître toutes les motivations des décisions successives, mais Castelnau jouera dans cette affaire un rôle majeur souvent méconnu voire critiqué. […] Joffre avait prévu une attaque en Alsace de nature symbolique et deux offensives, l’une en Lorraine, l’autre dans les Ardennes, stratégie simple sans nuances qui porte la guerre en territoire allemand. Elle a un inconvénient c’est qu’elle ignore la possibilité d’un envahissement de la Belgique avec un mouvement tournant de grande envergure de la droite de l’armée allemande, hypothèse jugée comme impossible car impliquant une trop grande accumulation d’effectifs.
Or, c’est justement la stratégie du généralissime allemand Moltke, qui reprend le plan Schlieffen, du nom d’un de ses prédécesseurs comme chef d’état-major impérial : c’est une manœuvre qui certes fait fi de la neutralité belge, mais permet de déployer l’armée allemande dans un vaste mouvement circulaire dans les plaines franco-belges du Nord donc sans obstacles sérieux, d’encercler Paris ; le gros des armées françaises concentrées dans l’Est serait pris en tenaille, grâce à une offensive de l’aile gauche allemande s’infiltrant dans la trouée de Charmes sur la Moselle.
Ce plan exige pour réussir que l’aile droite de l’armée allemande soit numériquement plus forte que l’aile gauche – ce qui est possible parce que les Allemands font intervenir leurs réserves immédiatement – ce que les Français ne croyaient pas possible – et d’autre part que l’armée russe, longue à mobiliser, ne se manifeste pas trop rapidement.
Ce plan va échouer pour quatre raisons :
– D’abord, les Russes attaquent en Prusse Orientale et non dans le Sud ce qui oblige Moltke à envoyer deux corps d’armée de l’aile droite vers l’Est ;
– Ensuite, parce que les généraux allemands n’appliquent pas le plan dans sa totalité, c’est-à-dire qu’ils vont contourner Paris vers l’Est au lieu de pénétrer et d’occuper la ville ;
– Parce que les troupes françaises reculant en bon ordre après les défaites de la bataille des frontières, se bloquent sur une ligne de résistance – la Marne – et permettent à Gallieni et à l’armée de Paris d’attaquer les envahisseurs sur leur flanc droit et de les faire reculer ;
– Enfin, parce que l’aile droite de l’armée française (1re et 2e armées) s’arc-boute sur une ligne allant de Verdun – Nancy jusqu’au Nord des Vosges, empêchant les armées allemandes d’attaquer sur leurs flancs les armées qui prendront l’offensive sur la Marne.
Conformément à la doctrine de l’offensive, Joffre, le 8 août 1914, ordonne à la 2e armée de marcher sur Sarrebruck, en se couvrant face au camp retranché de Metz et en protégeant Nancy ; à sa droite la 1e armée attaquera aussi vers Sarrebruck, l’offensive sur l’Alsace étant réduite à une démonstration annexe.
Mais Joffre apprend que les Allemands ont envahi la Belgique ; il ne sait pas quelle est l’importance de cette invasion en quantité de troupes ; il réagit en enlevant à Castelnau deux corps d’armée pour les positionner dans le Nord et en invitant la 5e armée à rentrer en Belgique, tandis que l’armée de réserve bouche « le trou » laissé par la 5e armée. Le 20 août, la 2e armée avance en direction de ses objectifs mais se heurte à une vive résistance sur un terrain que les Allemands avaient préparé en temps de paix en cas d’attaques françaises. C’est la bataille de Morhange pour la 2e armée : la défaite de Charleroi pour la 5e armée.
Pourquoi ces échecs ? En dehors du fait que le terrain ne s’y prête pas, truffé d’obstacles fortifiés et armés, il apparaît que la charge à la baïonnette se heurte à la puissance de feu des mitrailleuses allemandes alors que les Français en avaient beaucoup moins. Et de plus, les Allemands ont une artillerie lourde qui écrase les assaillants alors que le 75 français, faute de portée, ne parvient pas à la faire taire.
Enfin certaines unités, déconcertées par les pertes nombreuses, mal commandées, reculent plus ou moins dans le désordre alors que le corps bavarois qui leur fait face déclenche une contre-attaque.
De plus, Joffre, découvrant, l’ampleur de la manœuvre allemande se persuade que si l’aile droite allemande est aussi importante en effectifs, c’est que l’aile gauche est plus faible – erreur, car les Allemands ont mobilisé leurs unités de réserve aussi bien entraînées que celles d’active. Joffre persiste donc dans son intention offensive en Lorraine en pensant que l’aile gauche allemande n’opposera pas de résistance trop forte à la poussée française : d’axe principal de la percée française, l’offensive de Lorraine se transforme en bataille retardatrice pour éviter une percée de l’aile gauche allemande.
Castelnau, après la bataille de Morhange où le XXe corps de Foch s’est heurté à des forces bien enracinées sur le terrain pendant que les corps d’armée voisins piétinent, réussit à dégager les trois corps de son armée pour les ramener sur la position du Grand Couronné en avant de Nancy, évitant la prise de la ville ; dès le 25 août, de concert avec Dubail de la 1e armée, il contre-attaque le corps bavarois qui s’est infiltré entre eux : c’est la bataille de la trouée de Charmes qui oblige les Bavarois à reculer et les empêche de tourner le dispositif monté par Joffre pour la bataille de la Marne.
Mais peut-on parler de défaite à propos de Morhange alors que c’est Foch qui a conduit le 20e corps, corps d’élite, à l’attaque et qu’il retraitera en bon ordre – les 15e et 16e corps à sa droite ayant des difficultés – pour, sur ordre de Castelnau, venir se positionner devant Nancy. En fait, l’espoir immense suscité par cette offensive donnera à ce que l’on peut appeler un échec, la couleur d’une défaite. Il n’est pas sûr que Castelnau n’y perdît pas là son bâton de maréchal d’autant plus que Foch venait de lui être enlevé par Joffre pour prendre le commandement d’une armée en voie de constitution dans le cadre de la course à la mer et restant sur le sentiment que l’offensive de Lorraine avait été conduite avec trop de prudence.
Foch dans ses Mémoires, écrits en 1920, aura un point de vue équilibré : « Après nous avoir arrêtés à Morhange sans nous avoir battus et encore moins désorganisés, le commandement allemand, escomptant un succès qui n’était que négatif s’est lancé dans l’offensive, a osé entreprendre la marche à la Moselle vers le Sud, malgré la résistance de Nancy à l’Ouest et celle des Vosges : il a dû se replier avant d’avoir atteint la Moselle à Charmes. »
Enfin, la doctrine de l’offensive en rangs serrés commence à être contestée, non seulement comme elle l’avait été avant 1914 par Castelnau et Pétain, mais parce qu’on découvre l’immensité des pertes : l’armée de terre française perd en cinq mois, en 1914, 360 000 hommes : c’est le chiffre le plus élevé de toutes les années de guerre : 320 000 en 1915, 270 000 en 1916, 145 000 en 1917 et 250 000 en 1918.
On a beaucoup critiqué Joffre pour sa stratégie initiale mais son calme et sa maîtrise pendant les premiers mois de la guerre ont conduit à la victoire de la Marne qui ne fut pas l’écrasement des troupes adverses mais la stabilisation du front. Comme l’a dit Joffre : « Je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne mais je sais bien qui l’aurait perdue. »
Le général de Gaulle écrira dans la France et son Armée, en 1938 : « Ce fut la fortune de la France que Joffre ayant mal engagé l’épée ne perdît point l’équilibre. Il avait cru d’abord aux doctrines d’école, assez pour adopter le plan qui en procédait. Mais discernant que le recours n’était qu’en lui-même, il s’affranchit des théories et dresse contre l’événement sa puissante personnalité. »
Mais il est certain que, à côté des généraux qui s’y sont illustrés – Franchey d’Esperey, Foch, de Langle de Carry, Gallieni et Maunoury, Castelnau a pris sa part de la victoire – un Morhange inversé – en évitant que les armées allemandes n’attaquent de flanc les unités engagées sur la Marne. Joffre lui en sera toujours reconnaissant, notamment dans ses Mémoires. Dans le cadre de la course à la mer, Castelnau et son armée glisse sur l’aile gauche des armées françaises et livrent de durs combats à Roye et en avant d’Arras.
La guerre des tranchées
En janvier 1915, Joffre articule le front Nord-Est en trois groupes d’armées : le groupe Nord (Foch), le groupe Centre (Castelnau) et le groupe Est (Dubail). Deux offensives sont lancées en Artois au printemps (Foch) et en Champagne à l’automne (Castelnau) : elles se terminent par des pertes importantes et des gains de terrain minimes.
La situation de Joffre malgré son prestige de vainqueur de la Marne est ébranlée : il avait promis la victoire et la fin de la guerre et on ne voit rien venir.
Début 1916, le gouvernement décide que Joffre deviendra général en chef de toutes les armées françaises (y compris le front d’Orient) avec pour adjoint, Castelnau, chargé du front Nord-Est. Mais Joffre ne veut pas perdre ses attributions et utilise Castelnau pour des missions lointaines (inspection de Salonique où le général Sarrail demande des renforts).
En février 1916, l’armée allemande lance une offensive sur Verdun, place forte située sur un méandre de la Meuse surplombée par les hauts de Meuse comportant les forts de Vaux et de Douaumont, secteur resté calme pendant l’année 1915.
Devant cette avancée, les troupes françaises reculent sous une avalanche d’obus d’artillerie lourde. Le général de Langle de Carry commandant le groupe d’armées du Centre, est pessimiste pour la sauvegarde de Verdun dont les Allemands ne sont plus qu’à dix km. Il propose à Joffre d’abandonner la rive droite de la Meuse. Joffre – qui ne croit pas à une offensive sérieuse – envoie Castelnau sur place avec pleins pouvoirs : celui-ci donne l’ordre de résister sur la rive droite de la Meuse devant Verdun et place toutes les troupes du secteur sous le commandement de Pétain, commandant la 2e Armée où il avait succédé à Castelnau.
Ces décisions prises sur place, alors que le commandement local est dépassé, en quelques heures, le 24 février, formeront le cadre qui, pendant cinq mois, permettra à Verdun de ne pas être enlevé. Castelnau a joué là un rôle décisif que la postérité ne reconnaîtra pas.
Le défenseur de Verdun c’est en effet aux yeux de tous, Pétain qui a compris qu’il s’agit essentiellement d’un problème d’artillerie lourde contre l’artillerie allemande et de ravitaillement en hommes et en munitions et c’est la Voie Sacrée. De plus, au lieu de maintenir sur place les mêmes unités, il fait venir des divisions qui sont au repos pour affronter l’enfer de Verdun. La moitié de l’armée française passera par Verdun. En juillet 1916, les Allemands arrêtent leur effort qui visait à saigner l’armée française.
Mais la bataille se déplace sur la Somme. Si Verdun a été voulue par les Allemands, la Somme est désirée par le nouveau commandant en chef des armées anglaises, le général Haig. Celui-ci a déclenché en plein accord avec Joffre, en juillet 1916, avec la participation des troupes françaises du groupe d’armées du Centre de Foch, une puissante offensive avec appui massif d’artillerie : fin 1916, la percée n’a pas lieu et les pertes sont très lourdes.
En décembre 1916, le président du Conseil Briand, soumis aux critiques incessantes des parlementaires qui trouvent que la guerre n’en finit pas, qu’il faut trouver d’autres solutions (la négociation ?) finit par :
– nommer Joffre conseiller d’un comité de guerre restreint, commandant en chef des armées françaises,
– imposer Nivelle qui s’est illustré à Verdun, comme artilleur, comme Commandant du groupe des armées du Nord-Est,
– confirmer Sarrail, également critiqué – mais il est général républicain – comme commandant de l’armée de l’Orient,
– nommer le général Lyautey ministre de la Guerre, solution boiteuse : le ministre doit être en prise avec les commandants d’armée. On nomme donc Joffre, maréchal de France, conseiller du gouvernement sans responsabilités opérationnelles.
La nomination de Nivelle a surpris : on s’attendait à un commandant de groupe d’armées : Foch, Pétain, Franchey d’Esperey. Castelnau est exclu pour des raisons politiques ; du reste, on l’a envoyé en Russie pour voir ce qui se passe sur le front russe. Mais Foch a été relevé de son commandement du groupe d’armées Nord – il paie l’échec de la Somme – et il est chargé d’une mission sur la frontière suisse (sans troupes) : que faire si l’Allemagne viole la neutralité suisse ? Quand Castelnau revient, il rapporte une impression fâcheuse sur la situation en Russie : le tsar est faible, l’agitation intérieure permanente, l’armée est mal commandée. Lyautey voulait prendre Castelnau comme adjoint : opposition des ministres radicaux ; Castelnau est donc nommé commandant du groupe d’armées Est. Lyautey démissionne.
Nivelle lance son offensive en liaison avec les Anglais et c’est, en mars 1917, l’échec sanglant du Chemin des Dames. Nivelle est remplacé par Pétain comme Commandant en chef des armées françaises. Il va s’attaquer aux problèmes des troubles dans l’armée. Comme Castelnau, il pense qu’il faut tenir en attendant « les tanks et les Américains » et cesser les offensives inutiles.
La fin de la guerre
En mars 1918, les Allemands qui viennent de transférer à l’Ouest les divisions qui se battaient contre les Russes – à partir du traité de Brest-Litovsk – déclenchent une offensive brutale à la jointure des armées française et anglaise dans la Somme : ils progressent et la collaboration entre Haig et Pétain est difficile.
Comme il s’agit de coordonner les forces de deux pays indépendants, de faire avancer des réserves là où c’est nécessaire et pas ailleurs, le problème de l’unité de commandement s’impose aux politiques, Foch, d’abord chargé d’une mission de coordination, se voit investi des pouvoirs d’un commandant en chef des armées alliées. La situation rétablie sur la Somme, voilà qu’en mai, Ludendorff lance ses troupes sur le Chemin des Dames. Pétain recule, Soissons est occupé, Paris menacé.
Castelnau et son groupe d’armées de l’Est est dans une zone relativement calme où les divisions se succèdent pour se refaire et où les troupes américaines se forment ; à la demande de Pétain, il ne maintient qu’un simple cordon de troupes pour fournir à ses voisins des divisions en renfort. Mais c’est un million d’hommes que les Allemands ont récupéré du front russe et les Américains n’ont en France que 300 000 soldats. Foch n’a plus de réserves pour défendre Paris menacé. Mais, grâce à son énergie et au déplacement des maigres moyens qui lui restent, Foch réussit à contenir les Allemands et en juillet 1918, il peut lancer une contre-attaque et c’est, début août, la seconde bataille de la Marne ; puis les Britanniques avancent et contraignent les armées allemandes à évacuer l’Ouest de la Belgique.
Foch fait préparer par Castelnau une offensive en direction du Rhin car il pense que si la France veut récupérer l’Alsace-Lorraine, il faut y être présent avant la fin des hostilités, que l’on commence à entrevoir. Cette offensive approuvée par Foch dans ses modalités le 20 octobre n’est pas déclenchée en raison de l’armistice du 11 novembre 1918. Pétain et Castelnau, appelés à donner leur avis sur les conditions de l’armistice se sont opposés à Foch sur la question de savoir s’il fallait accepter la demande d’armistice présentée par une Allemagne menacée d’une révolution interne. Les deux généraux français ne pouvaient pas concevoir que les armées alliées stoppent leur progression alors qu’une partie du territoire français était encore occupée et que l’armée allemande n’avait pas été défaite sur son territoire : « nous devons cela à nos 1,5 million de morts » déclare Pétain.
Castelnau écrivait à un de ses fils « Nous tenions une victoire éclatante qui eut mis à genoux – et pour longtemps – la puissance militaire allemande. Elle n’eut pas résisté à cette percée dont le résultat immédiat nous conduisait sur les rives du Rhin. Nos chefs en ont décidé autrement. Ce geste épargne des vies humaines : souhaitons qu’il n’engendre pas une fâcheuse répercussion pour l’avenir. »
Ayant mesuré l’erreur commise par les Alliés en accordant l’armistice, Pétain ne l’oubliera pas en 1940. Il sera persuadé que les Allemands en accordant l’armistice à la France commettront à l’égard des Alliés la même faute que ceux-ci avaient commise à leur égard en 1918. Les Alliés ne l’oublieront pas en imposant la capitulation, sans conditions, de 1945. Mais en 1918, il y avait des arguments forts pour l’armistice : lassitude de l’opinion française, incertitude sur la valeur des troupes allemandes encore en ligne, volonté de ne pas ajouter quelques centaines de milliers de morts au million et demi de tués, position des États-Unis…
L’affaire du bâton de Maréchal
Le gouvernement avait ressuscité la dignité de maréchal de France en faveur de Joffre, pour dissimuler une éviction. En novembre 1918, le gouvernement nomme maréchal de France, Foch généralissime des Armées alliées et Pétain, commandant en chef des armées françaises. On s’attendait à trois nouveaux bâtons : Castelnau, Franchey d’Esperey, Fayolle. Le projet filtra dans la presse ; la décision fut rapportée du fait de l’opposition du parti radical et du Grand Orient de France.
Castelnau écrivait : « Tout cela ne saurait m’atteindre. J’ai commencé ma carrière sur les champs de bataille de l’année terrible comme commandant de compagnie et je suis actuellement le seul officier, ayant combattu pendant les heures douloureuses de 1870, qui soit au front. Je termine ma carrière comme commandant de groupe d’armées en Alsace dans le triomphe de mon pays, triomphe auquel ont contribué six de mes fils (dont trois sont morts). Notre maison a largement servi la France dans le présent comme elle l’a fait dans le passé. Nous n’avons rien à nous reprocher. »
Mais l’affaire du bâton eut une suite. La Chambre bleue horizon, élue en 1919, approuva par une loi spéciale l’attribution du bâton à Lyautey, Franchey d’Esperey et Fayolle et à titre posthume, à Gallieni. On fut surpris que Castelnau n’y figurât pas. Quelques députés déposèrent une proposition de loi tendant à porter à 8 le nombre de maréchaux en vue de permettre cette nomination. Le gouvernement Briand ne la soutint pas et la proposition de loi fut écartée de quelques voix. Castelnau n’a pas eu le bâton et il le méritait autant que Fayolle ou Franchey d’Esperey, mais c’est, avec Pétain, l’un des chefs de la Grande Guerre qui a le plus connu et compris les souffrances des troupes sous ses ordres. Ce fut un chef humain au plein sens du terme et c’est un titre de gloire qui en vaut d’autres.
Castelnau député de l’Aveyron
Le frère aîné du général, Léonce, magistrat, qui avait été révoqué en 1880 à la suite de la loi sur les congrégations religieuses, était devenu avocat à Nîmes et même bâtonnier de l’Ordre. Il fut élu député de l’Aveyron – circonscription de Saint-Affrique – en mai 1902 sous l’étiquette conservateur ; réélu en mars 1906 comme républicain libéral, il décéda en cours de mandat en 1909. Aux élections de 1910, c’est un radical qui lui succéda mais, en 1914, Joseph de Castelnau, cousin de Léonce, qui avait été son secrétaire est élu député de Saint-Affrique ; en 1919, il laisse son siège au Général qui est élu confortablement.
Castelnau devient président de la Commission de l’armée et soutient les efforts du gouvernement pour réorganiser l’armée après le sanglant conflit : service militaire de 18 mois, développement de l’aviation militaire, politique de fermeté vis-à-vis de l’Allemagne, occupation de la Ruhr en 1923.
Mais Castelnau a joué un rôle important mais discret dans une autre affaire, qui avait perturbé gravement la société et les milieux politiques français avant la Grande Guerre : le problème des relations entre l’Église et l’État.
On oublie trop souvent qu’à la veille de la guerre de 1914, la France n’avait pas cicatrisé de trois crises majeures : la nature du régime, les persécutions contre les catholiques et l’affaire Dreyfus.
En 1910, la IIIe République ne date que d’une quarantaine d’années après la chute de Napoléon III en 1870 ; elle n’a été institutionnalisée qu’en 1875. Si les partisans de l’Empereur se sont peu à peu étiolés au fil des élections, les royalistes constituent une force, certes en déclin mais toujours présente (voir l’essor de l’Action française à partir de 1904). Les défenseurs de la République – radicaux et socialistes – veulent asseoir le régime et considèrent que l’Église est leur ennemie.
Pour lutter contre elle, la République institue la gratuité de l’enseignement (1887) puis sa laïcité : les jésuites sont interdits d’enseignement (1880) et les autres congrégations d’hommes non autorisées explicitement sont dissoutes : d’où des déchirements dans le corps social parce que de nombreux fonctionnaires civils et militaires ne veulent plus servir un gouvernement persécuteur de l’Église.
Les relations entre l’Église et l’État sont régies par le Concordat de 1801, complété par les Articles Organiques imposés par Napoléon Ier à l’Église de France, renforçant à la fois son caractère gallican – autonomie par rapport à Rome – et sa dépendance vis-à-vis de l’État (rémunération du clergé payée par l’État, autorisation du gouvernement pour la nomination des évêques avant qu’ils ne reçoivent l’investiture du pape).
La situation concordataire apparut comme incompatible avec la position anticléricale des républicains ; le gouvernement Combes rompit les relations diplomatiques avec le Vatican et fit voter par le Parlement la loi du 1er juillet 1901 sur les associations : loi de liberté certes, mais également loi dirigée contre les congrégations religieuses – les ordres masculins et féminins – qui sont soumises à autorisation spéciale de l’État et sont dissoutes si elles n’obtiennent pas cette autorisation.
La loi du 8 décembre 1905 organisa la séparation de l’Église et de l’État ; la République garantit la liberté de conscience et le libre exercice du culte sous réserve de l’ordre public. Sans entrer dans le détail de cette loi, il faut pointer un des points d’achoppement majeur du dispositif destiné à remplacer le Concordat. La République ne salarie ni ne subventionne aucun culte – affirme la loi de 1905 – ce qui signifie d’une part, que les prêtres ne sont plus salariés de l’État (1 évêque = 1 général de division) et d’autre part, que les édifices servant à l’exercice du culte deviennent propriétés d’associations dites cultuelles – conformes à la loi de 1901 – devant avoir « exclusivement pour objet l’exercice d’un culte c’est-à-dire de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte ».
L’Église catholique ne pouvait accepter la constitution d’associations qui ne reconnaissaient pas son organisation interne – les prêtres ne sont pas salariés des évêques – et conféraient aux laïcs un pouvoir important dans l’administration et la surveillance du culte, à la manière des protestants. De plus, la sécurité juridique du système était sujette à caution : quid en cas de conflit entre deux associations dans la même paroisse se disputant le même édifice ?
Le pape Pie X, par l’encyclique Gravissimi officii munere du 10 août 1907 condamnait les associations cultuelles qui ne furent donc pas constituées, sauf cas particulier. Un an après la loi du 10 août 1905, faute d’existence de ces associations, le patrimoine immobilier affecté au culte était attribué en propriété aux collectivités locales (loi du 13 avril 1908) chargées de leur entretien et de leur mise à la disposition gratuite des fidèles du culte catholique, protestants et juifs ayant constitué leurs associations cultuelles.
Pendant la guerre, les catholiques avaient fait leur devoir comme les autres, prêtres en tête, présents dans les tranchées avec leur classe d’âge ; les religieux expulsés en 1880 avaient rallié les armées. Après la guerre de 1914, l’état d’esprit était à l’apaisement et la Chambre bleue horizon souhaitait régler le problème des relations de l’Église avec l’État de façon définitive et juridiquement solide.
Briand – celui qui avait joué un rôle modérateur dans le vote de la loi de 1905 et son application – devenu chef du gouvernement, nomme, en mai 1921, un ambassadeur extraordinaire au Vatican avec mission de trouver un statut légal pour l’Église de France. Le pape Benoît XV qui venait de canoniser Jeanne d’Arc, s’impliqua personnellement dans la négociation ; il accepta que le gouvernement puisse faire connaître d’éventuelles objections à la nomination d’un évêque par le pape avant que celle-ci ne devienne définitive ; le gouvernement ne formulait plus d’interdiction à l’égard des congrégations qui s’étaient recréées en France après 1918. Restaient les associations cultuelles.
Benoît XV proposa que les associations chargées du culte, visées par la loi de 1905, soient diocésaines et présidées par l’évêque du lieu. Le gouvernement désireux de ne pas modifier la loi de 1905, invoqua la jurisprudence du Conseil d’État : celui-ci s’était, dans les conflits nés de la création plus ou moins « sauvage » d’associations cultuelles par des clercs ou des laïcs, toujours prononcé en faveur des associations présidées par une personne en communion avec l’évêque du lieu. Il n’était donc pas nécessaire d’écrire quoi que ce soit sur le sujet et il suffisait que le pape lève l’opposition formulée par son prédécesseur en 1907.
Quelques évêques français consultés par le Vatican, sentant la fragilité d’un tel accord tacite, suggèrent au nouveau pape Pie XI, qui venait d’être élu, de conditionner son accord à une approbation législative. Poincaré qui avait succédé à Briand comme chef du gouvernement ne voulut pas réveiller les querelles religieuses. Connaissant bien le général de Castelnau pour l’avoir maintes fois rencontré pendant la guerre, lorsque lui-même était président de la République, il le chargea d’une mission délicate : faire comprendre au pape que son exigence d’approbation parlementaire risquait de tout faire capoter.
Castelnau se rendit à Rome en octobre 1923, rencontra le pape et lui montra que la jurisprudence du Conseil d’État offrait plus de garanties, notamment de continuité, qu’un vote parlementaire.
Sollicité de donner son avis sur la légalité d’un statut type, le Conseil d’État en assemblée plénière donna en décembre 1923, un avis favorable. Pie XI approuva le dispositif par l’encyclique Maximam gravissimamque du 19 janvier 1924 ; elle comportait en annexe le statut type. C’est cet accord implicite qui sert actuellement de base au fonctionnement des associations cultuelles au profit desquelles l’Église a institué le denier du culte. Cet accord a été appliqué avec bienveillance par l’État : dispense des droits d’enregistrement, faculté de recevoir des dons et legs, avantages fiscaux pour les donateurs du denier du culte. C’est Castelnau qui convainquit le pape de s’engager dans cette voie ; cela devrait faire réfléchir tous ceux qui veulent modifier la loi de 1905. Il y a dans les accords de 1923-1924 beaucoup de paroles verbales non écrites !
Castelnau fut battu aux élections de 1924 après une campagne d’une rare bassesse.
Castelnau et la Fédération nationale catholique
Les élections de 1924 ont vu la victoire du Cartel des gauches succédant au Bloc national de la Chambre bleu horizon : socialistes et radicaux en sont les composantes mais les socialistes refusent de participer au gouvernement Herriot, désigné après l’éviction du président de la République, Millerand, qui a trop pris partie pour la droite dans la campagne électorale.
Herriot, qui sait que la situation économique est difficile parce que l’Allemagne ne paye pas et que la droite a usé et abusé de l’emprunt, croit souder sa majorité en annonçant dans son discours de politique générale qu’il revenait à une stricte application de la loi de 1905 : interdiction des établissements scolaires encore tenus par des congrégations, application de la loi de 1905 aux départements recouvrés d’Alsace-Lorraine qui vivaient encore sous le régime du Concordat de 1801, fermeture de l’ambassade de France auprès du Vatican.
Cette annonce suscite immédiatement une grande émotion, en Alsace, chez les religieux anciens combattants et dans le milieu « anciens combattants », en général, qui ne comprend pas que l’on puisse vouloir revenir sur « l’union comme au front ».
Le monde catholique est également en effervescence devant un retour à l’atmosphère du vote de la loi de 1905 ; on commençait à en voir les effets bienfaisants en matière de liberté de l’Église vis-à-vis de l’État. À l’annonce des mesures anticléricales, des manifestations massives ont lieu en Alsace-Lorraine mais également dans d’autres régions de France ; des associations paroissiales puis diocésaines se créent en vue d’organiser une opposition ferme aux projets du gouvernement Herriot.
L’épiscopat est inquiet d’autant plus qu’il constate que certains mouvements – l’Action française, les Croix-de-feu du colonel de Larocque – ne font pas mystère de leur intention de capter les voix catholiques aux élections.
En effet, l’électorat catholique est libre ; le pape Léon XIII dans son encyclique Inter Sollicitudines de 1892 a nettement indiqué que la religion chrétienne admettait plusieurs formes de régime politique y compris la démocratie ; le pape a eu de la peine à faire passer le message à l’épiscopat français plutôt royaliste de cœur : toast de Mgr Lavigerie à Alger, action de Mgr Bourret, évêque de Rodez, que le pape fera cardinal : c’est ce qu’on appelle le Ralliement. Il s’ensuit que les catholiques de France ne voient plus d’intérêt à voter pour un parti monarchiste et éparpillent leurs voix entre les différents partis notamment de la droite modérée et républicaine.
Rentrés dans le moule républicain, les catholiques n’avaient pas créé de parti catholique et l’Action libérale populaire d’Albert de Mun, au début du siècle, n’a pas eu beaucoup d’audience. L’annonce, en 1924, du retour à une laïcité agressive par Herriot, est apparue anachronique : d’où l’émotion soulevée.
Devant la multiplication des associations, l’Église suscite rapidement une Fédération nationale catholique chargée de coiffer toutes ces initiatives et demande au général de Castelnau de la présider. La FNC atteint le million d’adhérents. Cette montée en puissance est pour beaucoup dans le recul de Herriot qui renonce à ses projets ; il est emporté, en avril 1925, par les résultats désastreux de sa politique financière.
La majorité revient au Centre droit aux élections de 1928 et de 1932. Que va devenir la Fédération nationale catholique et son impétueux président qui multiplie déplacements et articles dans les journaux ? L’Église ne veut pas d’un parti catholique et Castelnau qui méprise les partis n’en veut pas non plus ; il interdit aux dirigeants de la Fédération et des associations membres de se présenter aux élections. Lorsque Pie XI, en 1926, condamne l’Action française, Castelnau fait appliquer avec fermeté la directive pontificale. […] La FNC se veut un groupe de pression qui défend les valeurs chrétiennes tout en étant en dehors du système des partis. Position ambiguë qui traduit le caractère hétéroclite de ses dirigeants ; par certains côtés, la FNC apparaît comme très à droite – défense de l’école libre, lutte contre l’immoralité, rejet du communisme et de la franc-maçonnerie – mais elle se distingue de l’extrême droite dont elle réprouve l’antisémitisme et les méthodes musclées. Elle incarne également une droite réformiste conciliant le catholicisme de tradition et l’aspiration à la modernité : elle porte intérêt au cinéma et à la radio. Elle contribue à faire voter la loi de 1928 sur les assurances sociales et suscite la création de mutuelles et de caisses d’allocations familiales.
Son rôle néanmoins baisse après 1930 ; le pape suscite la création de l’Action catholique qui a une mission d’évangélisation par milieu social (jeunes, étudiants, ouvriers) ; la JEC, la JOC naissent ou se développent à ce moment. Le pape a confié à un autre Rouergat le soin de développer cette grande idée de son pontificat : le cardinal Verdier, archevêque de Paris.
La cohabitation avec la FNC n’est pas facile, notamment avec la partie la plus à gauche de ces mouvements d’action catholique (Mgr Lienart, évêque de Lille, l’hebdomadaire dominicain Sept) qui professent un pacifisme innocent alors que l’Allemagne réarme et vient de confier son destin à Hitler. Castelnau écrit dans L’Echo de Paris, de nombreux articles où il ne cesse de dénoncer des gouvernements qui sacrifient la sécurité du pays sur le plan militaire comme sur le plan de la politique étrangère ; celle-ci nous lie à la Pologne et à la Tchécoslovaquie sans que nous ayons les moyens militaires de leur venir en aide.
La défaite de 1940 met à l’épreuve le patriotisme de la FNC qui s’est toujours voulue viscéralement hostile au nazisme : dès l’armistice, Castelnau est hostile à la politique de collaboration et démissionne de la présidence de la FNC en 1941.
Castelnau : veilleur de la Libération
Castelnau a quitté Paris en juin 1940 et s’est installé dans son château de Laserre ; veuf, il a élevé comme son fils, son petit-fils Urbain de la Croix dont le père inspecteur des finances était décédé en 1918 de la grippe espagnole. La censure interdit les articles qu’il adresse à quelques journaux et on connaît son point de vue par l’abondante correspondance qu’il entretient avec ses enfants et ses amis.
Castelnau a critiqué l’armistice parce que la guerre est mondiale et que le gouvernement aurait dû aller continuer la lutte en Afrique du Nord.
En ce qui concerne les causes de la défaite qui suscitent une littérature abondante de recherche de responsabilités, Castelnau a une position relativement isolée ; certes, c’est la faute des gouvernements successifs mais l’origine de la défaite, c’est l’incompétence des chefs militaires qui n’auraient pas dû aventurer nos troupes en Belgique et n’ont pu disposer de réserves pour colmater la brèche de Sedan.
Cette thèse sur les causes de la défaite et le caractère mondial de la guerre sont peu répandues et il n’y a que le général de Gaulle et l’historien Marc Bloch dans son livre L’étrange défaite qui soient sur cette longueur d’onde. Le point de vue de Castelnau va à l’encontre des sentiments d’une certaine droite qui y voit le châtiment du relâchement des mœurs et des esprits favorisé par la faiblesse des derniers gouvernements de la IIIe République. Cette droite se ralliera largement aux thèses de la Révolution nationale.
De Montastruc-la-Conseillère où il vit retiré mais en liaison avec la Résistance locale qui viendra prendre livraison d’un dépôt d’armes qu’une unité de l’armée d’armistice avait caché dans la cave du château, Castelnau suit les péripéties de la guerre et ne désespère pas de la victoire. On ne peut pas dire qu’il soit un gaulliste fervent, estimant fâcheux que le Général fasse de la politique, mais il encourage deux de ses petits-fils à franchir les Pyrénées pour rejoindre l’Afrique du Nord.
Castelnau décède dans son lit, le 18 mars 1944 (il avait 91 ans), trois mois avant le débarquement allié en Normandie. Un an après, son petit-fils Urbain était tué au franchissement du Rhin par l’armée de de Lattre.
Ses obsèques ont eu lieu le 20 mars 1944 en grande simplicité et en présence de Mgr Saliège, archevêque de Toulouse et Mgr Challol, évêque de Rodez. Castelnau repose dans le cimetière de Montastruc-la-Conseillère : son caveau porte la seule inscription « Famille de Curières de Castelnau ».