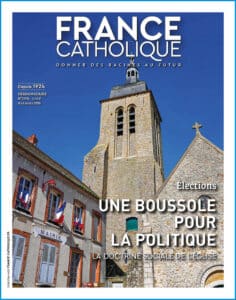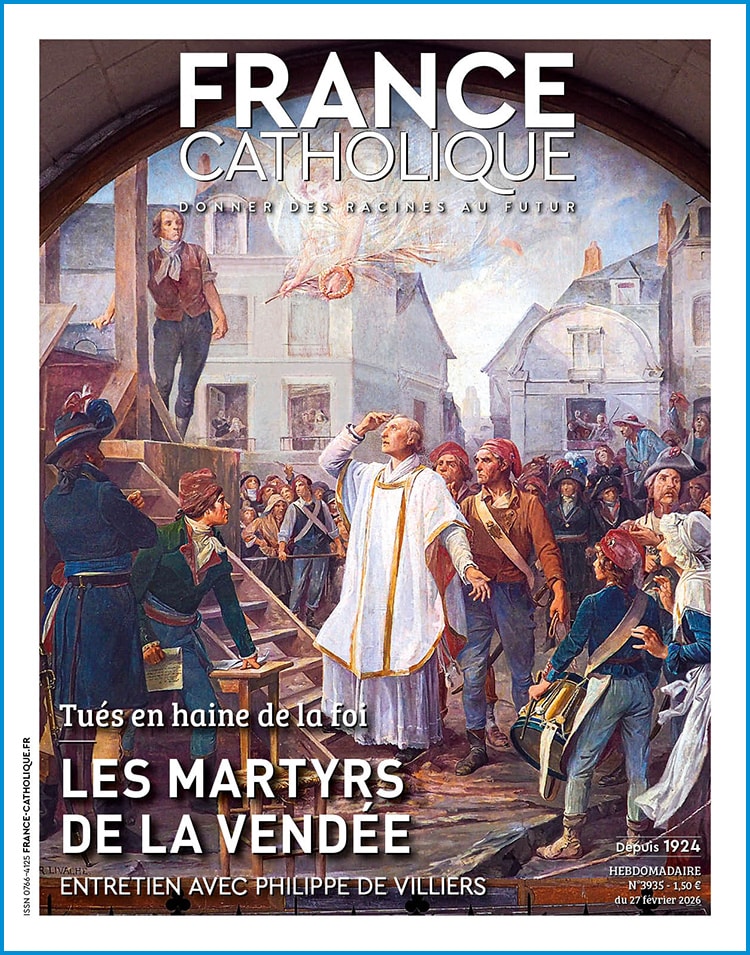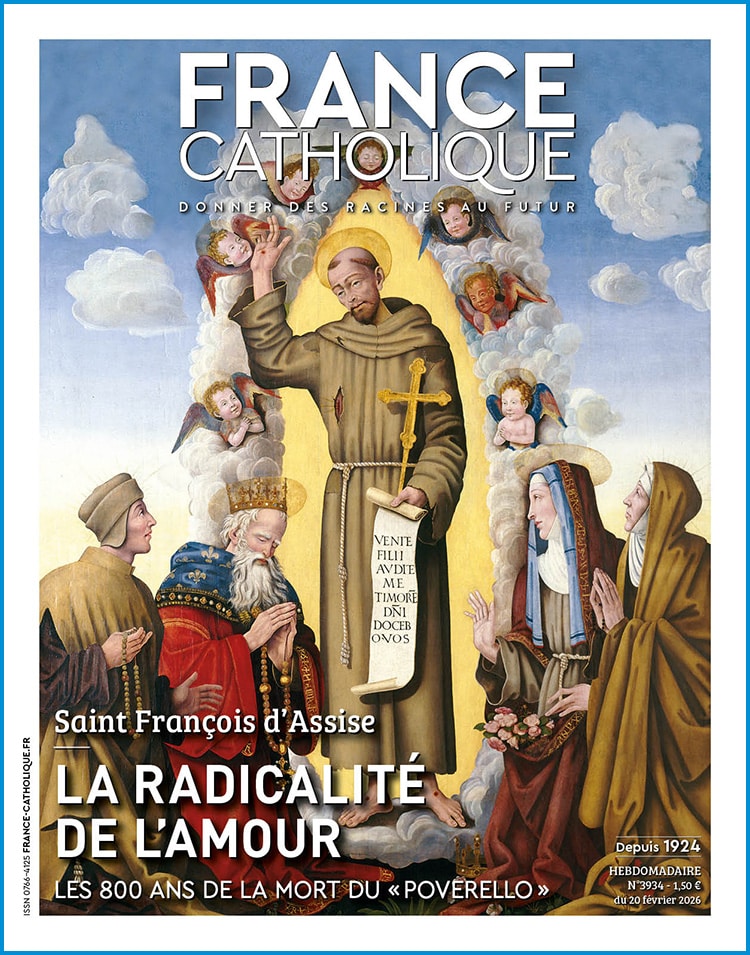Entre autres interrogations que nous pose la grande figure de Pasteur, il y a celle de l’attitude religieuse.
Pasteur était croyant. Plus proprement, il était chrétien. Et sa foi, loin d’être – du moins dans son œuvre et ses propos – comme celle par exemple de son contemporain Newman, du type raisonneur 1, peut être définie comme la foi du charbonnier. Il croyait parce qu’il avait la foi, et il avait la foi parce qu’il croyait. Dans ce domaine comme dans sa morale, il n’eut que deux maîtres : son père, le pauvre tanneur de Dole, et sa mère.
Le pauvre tanneur de Dole
« Ô mon père, ô ma mère, ô mes chers disparus ! » 2
Sa célèbre invocation à ses parents, que tous nous avons apprise à l’école du temps que l’on ne se préoccupait pas encore de notre éducation sexuelle, n’est pas un effet oratoire. Elle exprime une vérité sublime. À savoir que, pour être un maître de vie, un être humain n’a besoin ni de science ni de philosophie, car il y a plus de science et de philosophie dans un acte d’amour vécu sans faiblesse, de l’enfance à la mort, au fond d’une échoppe, que dans toute la « rumeur de livres » dont parlait Platon.
Pasteur croyait parce qu’il pensait avec raison, avec toute sa géniale raison de savant peut-être inégalé, que le pauvre tanneur Jean-Joseph Pasteur en savait plus sur l’essence des choses que Berthelot et Renan.
Les crétins que cette idée fait sourire devraient lire et méditer les lettres échangées entre le jeune Pasteur étudiant à Paris et son père. L’étudiant révère ses maîtres, mais son vrai maître, même alors, c’est le pauvre tanneur. Il y a là sûrement quelque complexe de castration ou quelque répression mal surmontée : je ne doute pas que le dernier de nos petits maîtres nous le démontrerait avec brio. Cela dit, je suis porté à penser que le monde se porterait mieux s’il y avait un peu plus de châtrés comme Pasteur et un peu moins de crétins verbeux tout satisfaits de nous prêcher le meurtre du père en exhibant leur sexe.
Pasteur croyait. Et il croyait, horreur ! parce que son père et sa mère avaient cru. Pensée esclave ! Manque d’esprit critique ! Écoutons pourtant l’« esclave » quand il nous explique sa démarche intellectuelle. « Méfiez-vous surtout d’une chose : la précipitation dans le désir de conclure. Soyez à vous-même un adversaire vigilant et tenace ; songez toujours à vous prendre en faute. » Être à soi-même un adversaire, songer toujours à se prendre en faute, la voilà bien, la castration ! Il se trouve seulement que c’est la seule voie vers la vérité. Que c’est en procédant de cette façon que Pasteur a pénétré plus loin que quiconque au cœur des lois de la nature, éclairant, nous rappelle un de ses biographes, « la structure moléculaire des corps, l’origine de la vie, le cycle éternel de la vie et de la mort », anticipant par ses idées sur la symétrie quelques-unes des plus profondes intuitions du siècle suivant (le nôtre), annonçant même qu’un jour les physiciens étudieraient la vie pour comprendre la physique, ce que nous voyons en effet maintenant.
Cette méfiance de soi-même, cette perpétuelle autocritique est bien la seule voie vers la vérité. Elle est le dernier secret de la méthode scientifique qui enseigne de n’accepter aucune idole, fût-elle chère, aucune séduction, de ne s’incliner que devant les faits : de considérer d’abord toute évidence purement intellectuelle comme un possible déguisement de l’amour-propre et de la superstition 3.
Il faut bien admettre que cette éthique de la pensée est à l’exact opposé de celle que l’on tente maintenant de nous imposer.
Ce dont on veut en effet maintenant nous convaincre, c’est que la plus haute activité de l’esprit, c’est l’expression : il faut apprendre à s’exprimer, et l’école doit d’abord développer chez l’enfant le goût et le talent de s’exprimer. Exprimer quoi ? C’est ce dont on ne se soucie pas. L’expression est à elle-même son propre but, car toute subjectivité est sacrée, et enseigner à la subjectivité de se conformer d’abord au réel avant de s’exprimer, c’est exercer une répression.
D’où la méfiance que l’on oppose maintenant à la science, comme s’il pouvait y avoir science hors de la vérité ; comme si donc la vérité pouvait être funeste. Combien de fois avons-nous lu et entendu ce sophisme qui, de la défaillance des savants, conclut à la nocivité de la science ? Mais le savant qui se trompe s’expose par là même à la réfutation scientifique, à la critique, que Pasteur pose comme règle première. Seule la science peut montrer que la science se trompe, puisque son but unique est de mettre les faits au jour et que hors de là elle n’est rien.
Il est vrai – on l’a dit et je l’ai écrit ici même 4
– que la science ne peut prétendre nous délivrer la vérité, entendons par là l’accès à la suprême réalité. Il n’y a de science que des phénomènes, et nous sommes destinés à laisser là un jour le monde des phénomènes. Tout ce à quoi elle vise, c’est à nous apprendre que, quand on fait ceci, il se passe cela. Le monde de la liberté, qui est celui où se réalise notre être, lui échappe donc.
Mais là aussi la leçon de Pasteur est claire. Car c’est ainsi sans doute que la fidélité à l’enseignement du pauvre tanneur put trouver sa place dans la pensée d’un si profond génie. Dans le monde intérieur de la liberté, le tanneur peut être supérieur à quiconque. On peut croire le fils glorieux quand il proclame sa dette au père obscur. Le génie intellectuel du premier témoigne chez le second d’un autre génie, celui du cœur, et peut-être bien que, comme le disait Napoléon, qui après tout s’y connaissait lui aussi un peu, c’est le second qui enfante le premier.
Exorciser l’horloger
L’étrange est qu’on ne reconnaisse plus cela, alors que les rapports de la science et du cœur semblent n’avoir changé que pour nous éclairer. L’univers étudié par Pasteur et ses contemporains pouvait paraître aveugle, sourd, dénué de toute signification. L’image qu’en donnaient les livres d’un Berthelot, d’un Darwin, d’un Haeckel, d’un Le Bon était celle d’un chaos de causes en éternel effondrement, comme une avalanche dont on ne discerne ni la source, ni le but, ni même la trajectoire, et où l’esprit, ainsi que le disait Poincaré, se découvre comme une brève étincelle entre deux éternités de ténèbres.
Le XIXe siècle est celui de l’entropie, idée impitoyable et effrayante. Le nôtre est celui de la néguentropie : l’effondrement universel des choses que mesure l’entropie se découvre maintenant avoir un sens. Selon l’expression de Monod, il réalise un projet. 5
Le mystère de ce projet révélé par chaque progrès de la biologie, c’est qu’il tend vers l’esprit, conformément à la célèbre prière indienne citée un jour par Paul VI : « Conduis-moi du non-être à l’être, des ténèbres à la lumière et du temps à l’éternité. »
Ce qui n’était qu’une prière dans la bouche du sage indien inconnu est devenu un spectacle : la science le voit désormais toujours plus clairement à mesure que se dévoilent les mécanismes de l’univers. Les poussières et les gaz sidéraux enfantent les étoiles, qui font les planètes, qui font la vie, qui fait la pensée, tout cela inexorablement. Si ce n’est pas une horloge tout entière agencée en vue d’enfanter l’homme et Dieu sait quoi (c’est le cas de le dire) au-delà de l’homme, qu’est-ce que c’est ? Monod croit exorciser l’horloger en donnant un nom grec (téléonomie) au mécanisme de l’horloge. Mais Kastler répond (a) que la réduction aux causes n’est pas une attitude scientifique.
Ne serait-ce pas par hasard le vertige devant l’horloge qui inspire la crainte de la science ? Et le refus de savoir ne serait-il pas la crainte de comprendre ?
Aimé MICHEL
(a) Christian Chabanis : Dieu existe-t-il ? (Fayard, p. 22).
Les Notes de (1) à (5) sont de Jean-Pierre Rospars
(*) Chronique n° 144 parue dans F.C.-E. – N° 1382 – 8 juin 1973. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, chap. 22 « Science et religion. Métaphysique », pp. 561-563.
Pour aller plus loin :
- Paul Henry Newman (1801-1890) était l’aîné de Pasteur (1822-1895). Newman a été béatifié à Birmingham le 19 septembre 2010 par le pape Benoît XVI. La plupart de ses œuvres ont été rééditées à cette occasion, notamment son autobiographie, Apologia pro vita sua (traduction L. Michelin-Delimoges revue et corrigée par Michel Durand et Paul Veyriras, présenté et annoté par Maurice Nédoncelle, liminaire de Jean Honoré ; Ad Solem, Paris, 2010) dans laquelle il répond aux accusations de Charles Kingsley qui mettait en doute l’honnêteté de son passage de l’anglicanisme au catholicisme.
- « Oh ! mon père et ma mère ! Oh ! mes chers disparus qui avez si modestement vécu dans cette petite maison, c’est à vous que je dois tout ! Tes enthousiasmes, ma vaillante mère, tu les as fait passer en moi. Si j’ai toujours associé la grandeur de la science à la grandeur de la patrie, c’est que j’étais imprégné des sentiments que tu m’avais inspirés. Et toi mon cher père, dont la vie fut aussi rude que ton rude métier, tu m’as montré ce que peut faire la patience dans les longs efforts. C’est à toi que je dois la ténacité dans le travail quotidien. Non seulement tu avais les qualités persévérantes qui font les vies utiles, mais tu avais aussi l’admiration des grands hommes et des grandes choses. Regarder en haut, apprendre au-delà, chercher à s’élever toujours, voilà ce que tu m’as enseigné. Je te vois encore, après ta journée de labeur, lisant le soir quelque récit de bataille d’un de ces livres d’histoire contemporaine qui te rappelaient l’époque glorieuse dont tu avais été témoin. En m’apprenant à lire, tu avais le souci de m’apprendre la grandeur de la France. Soyez bénis l’un et l’autre, mes chers parents, pour ce que vous avez été et laissez-moi vous reporter l’hommage fait aujourd’hui à cette maison … » (In Œuvres de Louis Pasteur, VII, 360-361). Pasteur prononça cette allocution le 14 juillet 1883 à Dôle devant une foule nombreuse lors de l’inauguration de la plaque commémorative, toujours visible sur la façade de sa maison natale, aujourd’hui transformée en musée : « Ici est né Louis Pasteur, le 27 décembre 1822 ». Son père, Jean-Joseph (1791-1865), avait été recruté par tirage au sort dans l’armée impériale. En 1814, à la chute de Napoléon il avait repris son métier de tanneur. Il avait épousé Jeanne-Etienne Roqui (1793-1848) en 1816 (voir http://php.pasteur.net/modules.php?name=News&file=print&sid=231).
La foi de Pasteur apparaît clairement dans la biographie que lui a consacrée son petit neveu, Maurice Vallery-Radot (Pasteur, Perrin, Paris, 1994). Un article de Hervé-Marie Catta (http://www.1000questions.net/fr/sf/sf_18_1.html) en résume les traits essentiels. « Pasteur, s’il ne fut pas toujours pratiquant, a réellement été un croyant. Croyant à l’Évangile et au Dieu de l’Évangile, croyant à la vie éternelle et à notre réunion dans le Ciel avec nos êtres chers endormis dans la miséricorde de Dieu. Croyant et témoin de Dieu face aux hommes célèbres de son époque tant dans les lettres que dans les sciences. (…) Au collège, il prie deux fois par jour (lettre à ses parents) (…). À la pointe la plus intime de la foi de Pasteur, il y a sa foi dans le Ciel de Dieu. Atteint au plus profond par la mort de certains de ses enfants, sa peine ne le conduit pas à la révolte et à la négation de Dieu. Au contraire, il trouve son appui dans l’espérance du Ciel : après le décès de sa petite Jeanne, en 1859, il écrit à un proche qu’elle “vient d’aller au Ciel pour prier pour nous.” C’est sur ce fond intime que s’inscrit le reste. Si sa femme et sa fille ont une relation à Dieu vivante, à travers la messe, les sacrements, la prière personnelle, Louis Pasteur estime que son travail vaut la prière, et il est possible que le manque de pratique et de prière ait donné à certaines périodes une sécheresse à sa foi. (…) C’est l’histoire rocambolesque des chrétiens d’Arbois, persécutés par la mairie, à qui il se joint au sortir de la messe sous l’arrosage des pompes à eaux de la municipalité anticléricale. (…) ». En 1882, en pleine ère scientiste, il est accueilli à l’Académie française. « Il venait d’être élu au fauteuil laissé par la mort de Littré, athée militant durant une grande partie de sa vie. Dans son discours, Pasteur devait faire l’éloge de son prédécesseur. Quand à Renan, autre athée célèbre, il aurait à faire le discours d’accueil du savant chrétien. Pasteur parla : “Au-delà de cette voûte étoilée, qu’y a-t-il ? De nouveaux cieux étoilés. Soit ! Et au-delà ?… Quand cette notion (de l’infini) s’empare de l’entendement, il n’y a qu’à se prosterner… On se sent prêt d’être saisi par la sublime folie de Pascal.” Un témoin, Legouvé, plus tard membre de l’Institut devait déclarer dans un discours pour l’inhumation de Pasteur : “Ces paroles firent courir dans toute l’assemblée un frisson d’enthousiasme et de foi…” (…) Renan se vengea dit-on en ironisant délicatement sur la foi du savant. » A la fin de sa vie, « le vieil homme paralysé se faisait lire l’Évangile. »
- Aimé Michel définit ainsi ce mot dans Superstition de notre temps (La clarté, chapitre 19, p. 499) : « J’appelle superstition la croyance qu’on sait quand on ne sait pas. Qu’on sait en matière de science s’entend, non de foi, qui est un acte intérieur, intérieurement vérifiable. »
- Il en a parlé notamment dans les chroniques n° 86, Dans l’abîme du temps d’avril 1972 et n° 93, Mythes et mythologues de mai 1972 (toutes deux reproduite dans La clarté, chapitres 18, p. 477, et 19, p. 489). Dans la première il écrit « La grande découverte de Popper, qu’il fit vers sa vingtième année à Vienne en 1921, c’est qu’une théorie vérifiée n’est nullement démontrée. (…) La science moderne se replie sur les faits expérimentaux et sur eux seuls, quand elle admet que ses méthodes n’atteignent pas la vérité mais seulement une prévision plus ou moins probable des mesures fournies par l’expérience (…) ».
- La notion de « projet » est longuement discutée dans le livre très influent de Jacques Monod Le hasard et la nécessité (Seuil, Paris, 1970) auquel Aimé Michel fait ici allusion. Cette notion peut prêter à malentendu. En effet, elle tient chez Monod une place essentielle mais contradictoire qui exige une résolution. Voyons ces trois points auxquels sont consacrés une bonne partie du premier chapitre de son livre.
Elle est essentielle selon lui parce qu’elle est nécessaire pour définir les êtres vivants et les distinguer des autres objets naturels (les rochers, les cristaux) ; nécessaire sans être suffisante car elle ne permet pas de distinguer les être vivants eux-mêmes des artefacts qu’ils produisent (les exemples d’artefacts pris par Monod sont les rayons et cellules de la ruche et les produits de l’industrie humaine). Comparant « les structures et les performances de l’œil d’un vertébré avec celles d’un appareil photographique » et reconnaissant leurs profondes analogies, il écrit : « les mêmes composantes ne peuvent avoir été disposés, dans les deux objets, qu’en vue d’en obtenir des performances semblables. » Il poursuit : « Je n’ai cité cet exemple, classique parmi bien d’autres, d’adaptation fonctionnelle chez les êtres vivants, que pour souligner combien il serait arbitraire et stérile de vouloir nier que l’organe naturel, l’œil, ne représente l’aboutissement d’un “projet” (celui de capter des images) alors qu’il faudrait bien reconnaître cette origine à l’appareil photographique. Ce serait d’autant plus absurde qu’en dernière analyse, le projet qui “explique” l’appareil ne peut être que le même auquel l’œil doit sa structure. Tout artefact est un produit de l’activité d’un être vivant qui exprime ainsi, et de façon particulièrement évidente, l’une des propriétés fondamentales qui caractérisent tous les êtres vivants sans exception : celle d’être des objets doués d’un projet qu’à la fois ils représentent dans leurs structures et accomplissent par leurs performances (telles que, par exemple, la création d’artefacts). » Il termine : « Plutôt que de refuser cette notion (ainsi que certains biologistes ont tenté de la faire), il est au contraire indispensable de la reconnaître comme essentielle à la définition même des êtres vivants. Nous dirons que ceux-ci se distinguent de toutes les autres structures de tous les systèmes présents dans l’univers, par cette propriété que nous appellerons la téléonomie. » (p. 22). Il en généralise ensuite l’application : « Toutes les adaptations fonctionnelles des êtres vivants comme aussi tous les artefacts façonnés par eux accomplissent des projets particuliers qu’il est possible de considérer comme des aspects ou des fragments d’un projet primitif unique, qui est la conservation et la multiplication de l’espèce. » (p. 26). Jacques Monod s’écarte donc d’une tendance lourde de l’enseignement de la biologie qui interdit toute formulation en termes de projet sous peine de zéro pointé et exige qu’on remplace « L’œil est fait pour voir » par « L’œil permet de voir ».
Mais, poursuit Monod, la notion de projet aboutit à une contradiction : « C’est l’existence même de ce projet, à la fois accompli et poursuivi par l’appareil téléonomique qui constitue le miracle. Miracle ? Non, la véritable question se trouve à un niveau autre, et plus profond, que celui des lois physiques ; c’est de notre entendement, de l’intuition du phénomène qu’il s’agit. Il n’y a pas en vérité de paradoxe ou de miracle, mais une flagrante contradiction épistémologique. La pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l’objectivité de la Nature. C’est-à-dire le refus systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance “vraieˮ toute interprétation des phénomènes donnée en termes de causes finales, c’est-à-dire de “projetˮ. (…) Postulat pur, à jamais indémontrable, car il est évidemment impossible d’imaginer une expérience qui pourrait prouver la non-existence d’un projet, d’un but poursuivi, où que ce soit dans la nature. (…) L’objectivité cependant nous oblige à reconnaître le caractère téléonomique des êtres vivants, à admettre que dans leurs structures et performances, ils réalisent et poursuivent un projet. Il y a donc là, au moins en apparence, une contradiction épistémologique profonde» (pp. 32-33).
Monod résout ce paradoxe, semble-t-il, par le recours aux lois de la physique : « Il n’y a (…) aucun paradoxe physique dans la reproduction invariante de ces structures : le prix thermodynamique de l’invariance est payé, au plus juste, grâce à la perfection de l’appareil téléonomique qui, avare de calories, atteint dans sa tâche infiniment complexe un rendement rarement égalé par les machines humaines. Cet appareil est entièrement logique, merveilleusement rationnel, parfaitement adapté à son projet : conserver et reproduire la norme structurale. Et cela, non pas en transgressant, mais en exploitant les lois physiques au bénéfice exclusif de son idiosyncrasie personnelle. » (p. 32).
L’articulation de la pensée de Monod dans ce chapitre n’est pas d’une parfaite limpidité et tranche avec la clarté de sa présentation par ailleurs des fondements de la biologie moléculaire, son domaine de spécialité. Aimé Michel tente de clarifier cette articulation dans sa critique du livre de Monod Un biologiste imprudent en physique (chronique n° 33 de mai 1971 parue ici le 25.1.2010). Il doit pour cela recourir aux autres chapitres du livre pour en dégager la cohérence d’ensemble. Après avoir présenté succinctement les trois points ci-dessus il poursuit : « En d’autres termes, le problème posé par la stupéfiante finalité de la vie n’est pas un problème réel. Il n’existe que dans la relation de notre pensée au monde, vivant ou non. La vie toute entière s’explique peu à peu sans aucune référence à sa finalité à mesure que notre connaissance objective progresse. Tous les êtres vivants, avec leurs organes et leurs comportements, sont le produit d’une évolution dont “on peut dire aujourd’hui que les mécanismes élémentaires sont non seulement compris en principe, mais identifiés avec précision” (p. 156). Ces mécanismes élémentaires sont ceux de la chimie (donc de la physique quantique) agissant au hasard. En jouant éternellement avec les lois de la physique, le hasard crée des structures. Les lois de la physique multiplient ces structures en les diversifiant au hasard, et la nécessité les sélectionne conformément au schéma néo-darwinien. “Pour l’essentiel, le problème est résolu, et l’évolution ne figure plus aux frontières de la connaissance” (p. 156). ». Bien entendu Aimé Michel ne partage pas les certitudes de Jacques Monod. D’une part, elles ne sont à ses yeux que « de séduisantes théories fondées sur les provisoires lacunes de nos connaissances ». D’autre part, elles se heurtent à de multiples « faits bien solides, même s’ils restent inexpliqués » qui montrent le contraire. Michel aussi en appelle aux lois de la physique mais pour saper la conception mécaniste que Monod en a au niveau quantique et leur laisser une place au niveau de la macroévolution là où Monod ne voit que contingence.