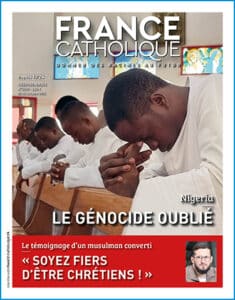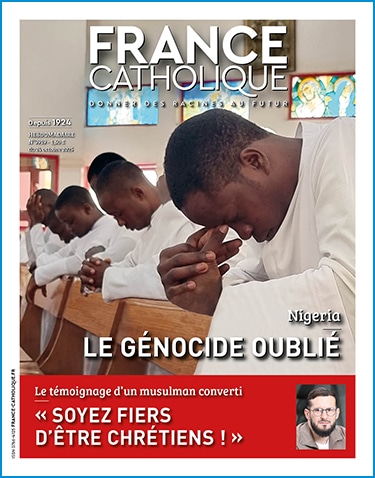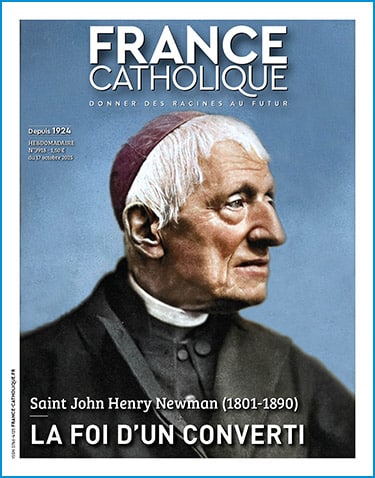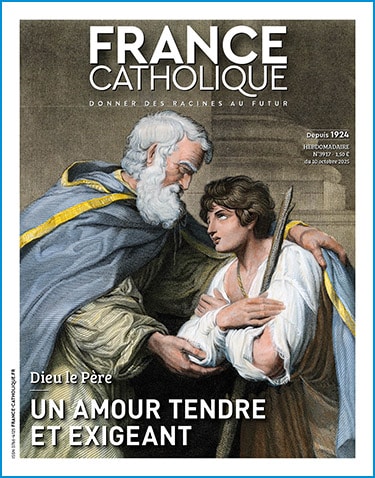Comment un pays devient-il riche, c’est-à-dire désormais libre, actif, puissant ?
Un des premiers Français à avoir répondu correctement à cette question fut, sans doute, M. Michel Debré, lorsqu’il eut l’idée de la scolarité obligatoire jusqu’à seize ans. Si les résultats de cette loi s’avèrent maintenant quelque peu désastreux, ce n’est certes pas l’idée qu’il faut rejeter, elle est irréfutable. C’est l’idée de la valeur ajoutée : toute valeur ajoutée se résout en un savoir-faire, en un savoir tout court.
Par exemple, j’ai un jardin, et dans ce jardin un arbre. Je fais couper l’arbre et je le vends. Combien cet arbre va-t-il me rapporter ?
Si je le vends tel quel, je ne pourrai même pas payer le bûcheron.
Si je sais manier la scie et la hache, je peux le vendre en bûches. C’est déjà mieux.
Mais si je sais en tirer du papier, de l’alcool, des matières plastiques, si en m’associant avec quelques voisins détenteurs de ferrailles variées et aussi habiles que moi à les travailler, j’arrive à transformer entièrement mon arbre en postes à transistors, mon arbre vaudra une fortune1.
Ou bien prenons le processus à l’envers. Voici un magnétophone ultrasophistiqué que j’ai payé les yeux de la tête. Réduit à ses matériaux bruts, qu’en est-il de lui ? C’est simple : brûlez-le. Il n’en restera que quelques dizaines de grammes de métal, de la fumée et un peu de cendre – ce qu’il était avant le travail qui en a fait un magnétophone.
J’imagine les réflexions de M. Debré méditant sa loi. « Donnons aux Français un surcroît de savoir, mettons-les sur les rails d’une instruction supérieure, et la France rivalisera avec les plus puissants grâce à l’énorme valeur ajoutée intellectuelle de son travail. »
En fait, comme on sait, cela n’a pas très bien tourné. Ou du moins, cela n’a pas bien tourné pour tout le monde : une proportion excessive d’enfants, pas forcément plus sots que les autres, ne peuvent travailler s’ils ne voient pas de leurs yeux à quoi sert ce qu’on leur enseigne. Comment un enfant de quatorze ans peut-il voir par exemple l’usage d’un vecteur ? C’est un casse-tête que nous autres Français nous obstinons à croire de caractère pédagogique. Que d’efforts dans les livres scolaires, dans les cours, pour « faire concret » ! Mais ce qu’un enfant ne voit que dans les livres ne sera jamais concret, réel, vivant. Si bien que, je le crains, nos systèmes pédagogiques donnent un avantage aux enfants qui n’ont pas besoin de la référence au réel, au vivant et sont les moins utiles peut-être à la société2.
Bon, dira-t-on, mais tout cela, c’est la force des choses. Il n’existe aucun moyen simple de mettre de la vie dans un vecteur. Pourquoi l’enseignement par le livre, qui suffisait jadis, ne suffirait-il plus aujourd’hui ? Les « exemples vivants » que l’on servait alors, robinets se disputant avec une baignoire, trains filant à des vitesses ridiculement constantes, ne les avalait-on pas bon gré mal gré ?
Peut-être. Seulement, la « force des choses » n’est plus la même maintenant. Pourquoi ? Parce que l’acquisition d’un savoir-faire de haut niveau, pour qu’un pays ne se laisse pas distancer et finalement dominer, doit être accessible à une proportion croissante de la population. C’est-à-dire non plus seulement à ceux qui ont l’intelligence des livres, mais aussi et peut-être surtout à ceux qui ont l’intelligence des choses. Dans le système éducatif actuel, seuls les enfants supérieurement doués ou ayant l’intelligence des livres peuvent suivre le pas. Dans ce qu’on appelle peu humainement le « déchet », une richesse intellectuelle est désastreusement perdue. Il est incompréhensible que le Français, réputé à juste titre pour son génie du bricolage, ne soit pas chez lui dans cette fin de siècle, qu’il n’y nage pas comme un poisson dans l’eau.
Voilà quelques semaines, une délégation de savants chinois arrivait en Angleterre pour examiner un ordinateur monté par deux inventeurs de l’Université de Cambridge.
Plutôt singulier ordinateur ! Entre autres choses, il a résolu le fameux casse-tête du télégraphe chinois (comment transformer en points et traits une dizaine de milliers d’idéogrammes indécomposables) ; il a résolu l’autre casse-tête, plus connu, du dictionnaire (où chercher un idéogramme dans le dictionnaire, puisqu’il n’y a pas d’alphabet, donc pas d’ordre alphabétique (a). Surtout, pour ne citer que le plus important, ces deux Anglais ont découvert le « truc » qui va permettre aux informaticiens chinois de communiquer directement dans leur langue avec l’ordinateur. Imagine-t-on l’importance de ce progrès pour un pays de 700 millions d’habitants décidé à se moderniser, et qui ne pouvait jusqu’ici utiliser l’informatique qu’à travers une langue étrangère ?3
Pourtant ce sont les deux inventeurs anglais qui m’intéressent.
Robert Sloss, du département de chinois de l’Université de Cambridge, d’abord. Comment se trouve-t-il savoir entre autre choses le chinois, l’informatique, et (à ce que je lis dans le Herald Tribune du 27 janvier dernier), l’art du fer à souder ?
Pour la raison suivante, que je livre à la méditation des universitaires qui me lisent. Sloss a d’abord étudié la physique, puis a changé d’idée : réflexion faite, il s’est fait avocat ; mais, tout bien pesé, il a appris le chinois. Et avec ce curriculum, à faire ici dresser les cheveux sur la tête, il est maintenant une importante personnalité de l’Université de Cambridge.
Mais son compère, Peter Nancarrow, lui, au moins, a de sérieuses références. Très sérieuses : il a servi comme officier dans la Royal Air Force et, comme Sloss, ayant un peu réfléchi à son cas, le voilà maintenant lui aussi une importante personnalité de l’Université de Cambridge… au Département de chinois.
Dernière précision qui suscite mon admiration : ces deux vagabonds de l’intelligence ont bricolé le premier modèle de leur invention chinoise sur une table de cuisine avec un Meccano, quelques bouts de plastique, du fil de fer et une bande de linoléum, prélevée sur le sol de ladite cuisine.
Alors, je me dis : si ce n’est pas là le triomphe du vieux savoir-faire français, qu’est-ce donc ? Pourquoi faut-il que cela se soit passé à Cambridge ?
Il me semble indiscutable que les Français ne retrouveront tout leur génie créatif que quand l’exploit des deux Anglais sera de nouveau possible chez nous ; quand on nous aura débarrassé de l’insupportable carcasse bureaucratique où s’épuise le moindre de nos gestes : bref, quand on nous aura restitué plus que la liberté politique, la seule presque qui nous reste.
Mais qui, on ? On, c’est nous. Là, je donne ma langue au chat. Comment nous libérer de nous-mêmes ?4 Certainement pas par une révolution : nous en avons déjà fait trois, cela suffit, si l’on en juge aux résultats.
Espérons que les prochaines élections5, par-delà les étiquettes qui ne sont qu’« attrape-nigauds » feront entrer à l’Assemblée des hommes neufs, exprimant la réalité de notre pays. Si c’est le cas, les étiquettes seront bientôt laissées au vestiaire, et l’on commencera à parler de choses sérieuses.
Aimé MICHEL
(a) Je sais : il y a ce que les sinisants appellent les « clés ». Mais il faut, pour s’en servir, une mémoire d’éléphant.
Chronique n° 304 parue dans F.C. – N ° 1627 – 17 février 1978. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, Aldane, Cointrin, 2008 (www.aldane.com), pp. 337-339
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 21 juillet 2014
Pour aller plus loin :
- Aimé Michel résume ainsi en quelques phrases les fondements de la réussite économique. En ces temps où l’économie de la France régresse, ces sains principes sont souvent oubliés ou perdus dans le brouhaha de discours contradictoires. Pourtant de nombreux indicateurs traduisent nettement cette régression, notamment la diminution du PIB par habitant, le déficit du commerce extérieur et la désindustrialisation (la France a perdu 750 000 emplois industriels en 10 ans). Comme un pays ne peut pas durablement consommer plus qu’il ne produit, le bien-être collectif en est menacé ; les conditions de vie de la population française se dégradent insidieusement ; le chômage de masse s’installe ; la société devient plus fragile et plus inégalitaire. Les économistes ont bien analysé cette situation et tous ou presque s’accordent sur les causes de ce déclin comme le montrent par exemple les livres de Patrick Artus et Marie-Paule Virard (La France sans ses usines, Fayard, 2011), Pierre-Noël Giraud et Thierry Weil (L’industrie française décroche-t-elle ? La documentation française, 2013), ou Jean-Louis Beffa (La France doit agir, Seuil, 2013). Voici 5 constats sur lesquels ils s’accordent :
– La productivité de l’industrie n’a pas suffisamment augmenté faute d’investissements en automatique et robotique. Ainsi, selon le rapport Gallois, il y a seulement 34 500 robots industriels en France, d’une moyenne d’âge élevée, contre 62 000 en Italie et 150 000 en Allemagne !
– Les produits français répondent mal à la demande mondiale car ils sont positionnés en milieu gamme ce qui les soumet à la concurrence étrangère. La montée en gamme de ces derniers menace les positions françaises. Les entreprises françaises sont obligées de revoir les prix de leur produit à la baisse.
– Les prélèvements obligatoires sur les entreprises sont trop élevés : supérieurs de 6 points de PIB en France par rapport à l’Allemagne.
– Les salaires sont également trop élevés. Ce fait est davantage sujet à polémique que les précédents mais une étude de l’INSEE publiée en juin dernier le montre clairement : « si depuis 2008 la progression des salaires a ralenti, elle a ralenti beaucoup moins vite que la productivité ». Depuis 2011, la croissance des salaires réels et celle de la productivité suivent des courbes parallèles mais l’écart apparu en 2009-2010 demeure.
– Pris en tenaille entre la baisse des prix et la hausse des coûts, les marges des entreprises sont écrasées. Faute de marge suffisante les investissements sont sacrifiés alors qu’ils sont indispensables pour accroître la productivité et mettre au point des produits innovants.
Un cercle vicieux s’est ainsi instauré dont les effets sont aujourd’hui manifestes et qu’il va falloir rompre. Les réformes, trop longtemps différées, n’auront d’effet que si elles améliorent directement ou indirectement les verrous précédents.
- Là aussi, Aimé Michel rappelle des choses élémentaires mais qui ont le plus grand mal à être intégré par le système éducatif. Or, tout comme son système économique, le système éducatif de la France décroche, notamment dans les milieux défavorisés, comme l’ont montré les enquêtes PISA, signant ainsi un gâchis humain préoccupant, voir la note 5 de la chronique n° 292, Le rite d’initiation – L’Éducation nationale atteint-elle ses objectifs éducatifs et sociaux ? (09.09.2013).
Le problème ne se limite d’ailleurs pas à la formation initiale. Les études de l’OCDE montre un grave déficit de qualification de la main-d’œuvre française en raison d’une formation permanente insuffisante (la France est dans les derniers rangs du classement) et mal adaptée car excessive dans les grands groupes et insuffisante pour les chômeurs. En raison de ce défaut de qualification l’exécution de tâches complexes de manière autonome est rendue plus difficile, avec d’inévitables conséquences sur la qualité de production, la maintenance et le réglage des appareils, les initiatives pour améliorer l’organisation du travail et les processus de production. Comment s’étonner que l’on en vienne à considérer que la main d’œuvre est trop chère eu égard à ses qualifications ?
Depuis plus de 40 ans on discute en France de l’apprentissage en alternance qui associe les avantages de la formation générale en classe à la pratique en entreprise. Tout le monde est prêt à en reconnaître les mérites. Alors pourquoi en discute-t-on encore sinon parce que les choses n’avancent pas comme elles le devraient ? Pourquoi continue-t-on à déplorer notre retard par rapport à l’Allemagne ou à la Suisse (qui ignore complètement le chômage de masse) ? Ne cherchons pas des responsables ici ou là qui ne seraient que des boucs émissaires ; car le responsable est une mentalité, un ensemble d’idées fausses mais bien enracinées au fond des consciences dans notre pays. C’est un des sujets sur lesquels la société française manifeste le plus clairement ses blocages et ses méfiances, méfiance des enseignants de l’Education nationale qui soupçonnent les entreprises de n’être intéressées que par des savoir-faire étriqués et méfiance des entreprises qui soupçonnent les enseignants de privilégier les savoirs à mesure inverse de leur utilité ! Certes les vieux schémas de la lutte des classes qui alimentaient ces méfiances sont un peu passés de mode et le dialogue entre enseignants et employeurs ont un peu progressé mais on est encore très loin du compte et la France continue d’accuser un fort retard en ce domaine. Où sont les commissions réunissant les uns et les autres, comme cela se fait depuis longtemps ailleurs pour discuter des compétences dont le pays a besoin, développer ensemble les filières d’avenir et orienter les élève en toute connaissance de cause ? Comment l’école pourrait-elle être contre l’entreprise ou l’entreprise contre l’école ? C’est ce qu’ont compris les pays qui, aujourd’hui, montrent la voie pour demeurer « riche, c’est-à-dire désormais libre, actif, puissant ».
- Selon l’article de Wikipédia consacré à ce sujet il existe plusieurs méthodes pour saisir les caractère chinois (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Saisie_du_chinois_sur_ordinateur). Ces méthodes diffèrent selon les pays. En Chine continentale les claviers utilisés sont des claviers ordinaires QWERTY qui diffèrent peu des nôtres (AZERTY). On trouve sur le web plusieurs références aux travaux de Robert Sloss et Peter Nancarrow. Leur méthode a été utilisée pour l’indexation des ouvrages en chinois dans des bibliothèques mais il ne semble pas que son emploi se soit généralisé.
- Cette question est toujours de la plus brûlante actualité, ce qui montre encore une fois la pérennité des attitudes et des mentalités. Commentant les réformes à entreprendre au plus vite pour remettre le pays sur ses rails et assurer son avenir, Jean-Louis Beffa, président d’honneur de la Compagnie de Saint-Gobain, écrit : « Les difficultés actuelles demandent plus que des ajustements marginaux. La réforme française sera en effet un travail de longue haleine car elle n’entre pas en phase avec ce qui constitue l’ADN français. Le consensus, la priorité du producteur, l’effort partagé, l’attachement à l’entreprise et la vision à long terme n’y ont qu’une faible place. » (op. cit., p. 179-180, c’est moi qui souligne). C’est une mentalité séculaire qu’il faut faire évoluer en secouant le poids d’évidences trompeuses. (Sur la permanence des attitudes profondes, souvent inconscientes, héritées du passé, voir la note 4 de la chronique n° 270, C’est la « chute finale » ? – Comment Emmanuel Todd démontra que l’URSS était un pays sous-développé, mise en ligne le 11.11.2013).
- Les élections législatives de 1978 ont eu lieu les 12 et 19 mars alors que Valéry Giscard d’Estaing est président de la république. Les électeurs ont le choix entre la droite (RPR-UDF) et la gauche (PS, MRG, PC parties alliés jusqu’en septembre 1977 autour d’un « programme commun de gouvernement »). Au second tour la gauche obtient 48,57% des suffrages et la droite 51,06 %. La majorité sortante est ainsi confortée et le gouvernement du premier ministre Raymond Barre est reconduit. Ce gouvernement Barre (le 3e) gouvernera jusqu’à l’élection présidentielle de mai 1981 qui conduira François Mitterrand à la présidence de la république.