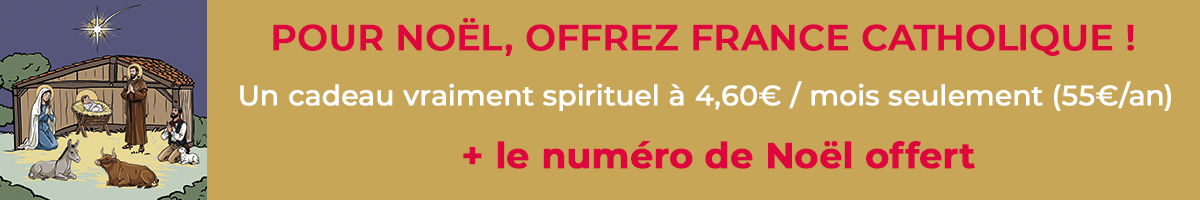Au moment où se fait la rentrée scolaire, un brouillard d’inquiétude et de perplexité descend une fois de plus sur les familles, qui voient leurs enfants s’enfoncer avec un succès inégal dans l’incompréhensible maquis des programmes.
Les auteurs des innombrables réformes se sont à qui mieux mieux pressé les méninges pour suppléer aux handicaps sociaux. En français, cela veut dire que nos écoles s’efforcent de créer des conditions telles que les enfants et étudiants provenant des milieux pauvres aient les mêmes chances de succès que les autres. A plus longue échéance, il s’agit d’obtenir que toute la nation, et non plus seulement ses minorités de culture supérieure, ait la possibilité de créer ses cadres.
Noble et louable dessein, car c’est un fait que, pour une grande part, les futurs cadres de la nation française se recrutent parmi les enfants des cadres. Il y a en France une sorte d’autoreproduction des cadres – que l’on appelle « classes dirigeantes » quand on politise le phénomène. Les statistiques le montrent. L’expérience personnelle le confirme. Dans toute ma vie professionnelle, en trente ans, je n’ai rencontré à mon niveau qu’un fils de paysan (deux en me comptant moi-même). Encore son père était-il riche1.
Rares sont ceux qui ont une connaissance vécue du gâchis résultant de cette autoreproduction. En restreignant le choix des futures élites à un pourcentage étroit de la population, la France, intellectuellement, devient un petit pays, équivalent à la Suisse ou à la Suède. Pourquoi la compétition internationale nous parait-elle si dure ? C’est que les pays où les mœurs se sont vraiment démocratisés ne gaspillent pas comme nous, combien dirai-je ? peut-être 60 ou 80 % de son capital intellectuel et moral en les excluant du réservoir où sont puisés les futurs animateurs de la nation.
Tout cela est vrai et reconnu. Comme il est vrai et reconnu que le fait, je ne dis pas de naître, mais d’être élevé dans une classe sociale hautement éduquée, se traduit statistiquement chez l’enfant par un quotient intellectuel supérieur. Les enfants des classes pauvres « performent » statistiquement moins bien que leurs petits copains des classes riches. Il y a certes une part héréditaire (encore mal définie) dans les dons2. Mais cela est observable dans toutes les classes sociales. Un rapprochement éclaire un peu ce fait obscur mais réel : il y a des familles physiquement robustes dans toutes les classes sociales, avec des performances supérieures transmises de génération à génération ; cependant ces potentialités physiques ne se révèlent que par l’exercice et le sport (correspondant à l’éducation).
Il y avait donc un but très louable, très profitable à tous dans l’ambition des faiseurs de réformes qui se sont succédé depuis dix ans à la tête de l’Education nationale.
Cependant, il apparaît qu’ils s’y sont très mal pris, et cela parce qu’il ne suffit pas d’être un « intellectuel de gauche » (comme sont la plupart de nos hauts fonctionnaires) pour comprendre le peuple.
Non seulement cela ne suffit pas, mais je penche à croire que c’est trompeur et dangereux. Pourquoi ? Parce que l’idéologue fait confiance à son idéologie, qui lui donne l’illusion de comprendre a priori sans aller voir ce qu’il en est réellement.
Il est plus facile de lire une analyse idéologique sur « la classe ouvrière » que de partager la vraie vie de celle-ci. Les « nouveaux philosophes » s’en sont bien aperçus en 68, quand ils ont constaté (non sans stupeur, une stupeur qui maintenant livre sa méditation) qu’un mur opaque sépare étudiants et ouvriers. L’expression « classe ouvrière » elle-même, inventée dans un monde concret totalement différent du nôtre, ne désigne plus du tout l’ensemble des plus défavorisés.
Les réformes que nos enfants doivent subir sont donc un défi de l’idéologie à la réalité. Nos idéologues aux mains fines ont « leurs pauvres », qu’ils connaissent bien pour en avoir lu la description chez un doctrinaire barbu vieux d’un siècle, qui n’avait jamais travaillé de ses mains, qui se voulait prophète, et qui s’est trompé de A à Z3.
Je lis par exemple (a) que dans les programmes actuels, « les élèves de onzième étudient le cardinal de la réunion de deux ensembles disjoints à deux et trois éléments respectivement, avant d’apprendre que 2 + 3 = 5. ». Les pauvres petits ! De même j’ai vu qu’en seconde C on tourne pendant des mois dans le maquis de la logique avant d’expliquer l’équation du second degré.
Les auteurs des réformes ont souvent affirmé que la nouveauté des programmes, en déconcertant les parents formés à l’éducation ancienne, mettait tout le monde sur la même ligne de départ.
C’est vrai dans la mesure où les parents ne font pas l’effort de se recycler. De plus, le recyclage mathématique d’un ingénieur ayant étudié il y a vingt ans est-il aussi difficile que celui d’un maçon n’ayant jamais étudié, à capacités intellectuelles égales ? Voilà des questions que les réformateurs ont traitées bien légèrement. Je voudrais qu’avant de poser de tels postulats, ils eussent eux-mêmes tenté de se recycler dans le métier de maçon. Mais cela ne s’est jamais vu.
D’autre part, est-il certain que l’intelligence logique et abstraite précède l’intelligence concrète ? Qu’il soit plus facile de commencer par le cardinal de la réunion, etc. (voir plus haut) que par 3 + 2 ? Par la logique que par l’équation du second degré ?
Et non ! C’est le contraire qui est certain. Lisez Piaget, lisez les études psychologiques statistiques suivies pendant des années avec résultats scolaires à l’appui. Je ne sais dans quelle cervelle malade est née l’idée qu’il faut apprendre la théorie des sons avant de chanter, la sémantique avant de parler. Car c’est cela que l’on impose à ces jeune gens.
J’ai souvent, en bavardant, soulagé l’angoisse d’un élève de seconde C perdu dans les abstractions apparemment délirantes de la logique en lui expliquant d’emblée la fonction quadratique. Cela prend un quart d’heure. Après quoi la logique prend son sens, car on a des exemples concrets où l’appliquer. Mais ne voit-on pas que cela prouve le caractère plus que jamais « élitiste » de la nouvelle école ?4
Bien entendu, je ne suis pas fou au point de vouloir vraiment mettre ici en question ce qui existe, attendu que c’est une vraie culture, aberrante certes, mais qui s’est installée dans des dizaines et dizaines de milliers de cerveaux, souvent fanatisés. Il faut, hélas, attendre que cela leur passe.
Il faut surtout être très compréhensif à l’égard de nos enfants. On les entend répéter à la TV, à la radio, en famille, et chaque fois qu’ils en ont l’occasion, que « c’est dingue, que ça n’a aucun rapport avec la vie ». Ils veulent dire qu’ils sont accablés d’abstractions. Et c’est vrai ! Les jeunes Français reçoivent l’instruction (on ne saurait appeler cela éducation) la plus abstraite du monde. C’est leur rite d’initiation, très pénible, qui a souvent pour effets de les persuader que l’étude est une brimade, et de les en détourner5. Il faut comprendre leur inquiétude, leur expliquer qu’ils apprennent du moins à apprendre et à franchir des obstacles. Ils ont confiance en nous : un récent sondage l’a prouvé (b). Cela au moins leur reste, et à nous.
Aimé MICHEL
(a) Chambadal : les Ensembles (Bordas). Excellent résumé, clair, concis, supposant connues quelques définitions qu’on trouve dans les dictionnaires.
(b) 85 % des jeunes Français s’entendent bien avec leurs parents.
Chronique n° 292 parue dans France Catholique-Ecclesia – N° 1609 – 14 octobre 1977
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 9 septembre 2013
Pour aller plus loin :
- Cette forte « autoreproduction des cadres » vaut surtout pour les générations nées avant la seconde guerre mondiale (Aimé Michel est né en 1919). La situation s’est très fortement améliorée pendant les Trente Glorieuses pour se stabiliser ensuite. Un rapport du Centre d’analyse stratégique (CAS) de juillet 2009, fondé sur des enquêtes de l’INSEE, montre qu’en 2003, chez les 30-59 ans, 39% des enfants avaient une position sociale meilleure que celle de leurs parents et 22% moins bonne, contre respectivement 38% et 19% en 1983. Bien que les promotions restent deux fois plus fréquentes que les déclassements, on observe au cours de ces vingt années une dégradation de la situation (d’un point en montée et de deux points en descente). Les commentateurs ont résumé ces observations par une image alarmiste : « l’ascenseur social est en panne ».
Cependant, Marie Duru-Bellat, chercheur à l’Observatoire sociologique du changement et enseignante à Sciences Po, observe : « Dans une société moderne où de plus en plus de jeunes font des études, il faut s’attendre à ce que ça bouge dans les deux sens, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui montent, et que par conséquence il y ait aussi des descentes sociales. Quand les diplômes sont rares, et que la structure du marché de l’emploi se transforme par le haut, il y a plus de gens qui vont monter. Mais si – comme c’est le cas actuellement – la structure de l’emploi ne bouge pas beaucoup, qu’il n’y a pas d’augmentation du de postes de cadre, alors qu’il y a de plus en plus de diplômés, tout le monde ne peut pas monter. » (http://www.atlantico.fr/decryptage/diplomes-parapluies-troues-contre-crise-radiographie-panne-ascenseur-social-francais-marie-duru-bellat-alexandre-delaigue-769315.html).
De fait, l’élévation du niveau éducatif a été considérable au cours des cinquante dernières années : la proportion des jeunes sortant du système scolaire sans aucun diplôme, les vrais exclus, a régulièrement diminuée de 35% (1965) à 11% (1990) puis 6% (2005). La pyramide éducative s’est presque inversée durant cette période : les Français ayant eu une formation courte (certificat d’études ou moins), intermédiaire ou longue (bac ou plus) étaient respectivement 58%, 29% et 13% en 1965 contre 12%, 38% et 49% en 2000. Hervé le Bras et Emmanuel Todd, qui donnent ces chiffres, y voient la cause principale du pessimisme actuel : « A l’époque industrielle, la majorité alphabétisée de la société regardait vers le haut les éduqués supérieurs et contestait leurs privilèges. A l’époque postindustrielle, une majorité d’éduqués supérieurs et moyens regarde vers le bas ceux qui sont restés bloqués au stade de l’instruction primaire, pour les oublier dans le cas des premiers ou pour craindre de leur ressembler dans celui des seconds. A la contestation succède l’indifférence ou la peur. (…) L’arrêt du progrès éducatif entre 1995 et 2005 a conforté dans la population la représentation subconsciente d’une société stratifiée. (…) L’immobilité suggère l’horizon d’une société stratifiée de manière stable. Dans cette représentation réside une part importante du pessimisme culturel latent qui domine, non seulement chez les élites, mais aussi dans la population. » (Le mystère français, Seuil, Paris, 2013, p. 14).
Passons de cette vue diachronique en France au tableau synchronique des comparaisons internationales. Une récente étude de l’OCDE (2013) intitulée Une affaire de famille : la mobilité sociale intergénérationnelle dans les pays de l’OCDE, conclut que « La mobilité intergénérationnelle des revenus, des salaires et de l’éducation, est relativement faible en France, dans les pays d’Europe méridionale, au Royaume-Uni et aux États-Unis. En revanche, elle tend à être plus élevée en Australie, au Canada et dans les pays nordiques. »
Un article de Miles Corak de 2012 (http://www.excellentfuture.ca/sites/default/files/Inequality%20from%20generation%20to%20generation.pdf), fondé sur des données plus récentes que celles utilisées par l’OCDE, estime « l’élasticité intergénérationnelle des revenus » ; elle indique dans quelle mesure les niveaux de rémunération des fils reflètent ceux de leurs pères (elle varie de 0, si le revenu des enfants n’est pas du tout déterminé par celui des parents, à 1, s’il l’est entièrement) : plus sa valeur est élevée, plus forte est la transmission des niveaux de revenus entre générations, et donc plus réduite la mobilité des revenus. Cet indice est supérieur à 0,5 au Pérou (0,67, valeur maximum des 22 pays étudiés), en Chine, au Brésil et au Royaume-Uni ; il est égal à 0,47 aux Etats-Unis ; 0,41 en France (au centre en 11e position) ; et inférieur à 0,2 au Canada, en Finlande, Norvège et Danemark (0,15, valeur minimum).
Fait intéressant, cet indice est fortement corrélé au coefficient de Gini qui indique l’inégalité des revenus (il varie de 0, si tous les revenus sont égaux, à 1, si une seule personne perçoit l’ensemble du revenu du pays). Autrement dit plus un pays est inégalitaire et plus la mobilité entre générations est faible. Le coefficient de Gini a chuté en France entre 1963 et 2007 pour atteindre 0,32 vers 2010 contre 0,25 dans les pays scandinaves et 0,55 en Amérique du Sud.
- Sur ce point controversée de la part héréditaire des dons voir la chronique n° 162, La moulinette qui nous menace – La planification de l’homme sous prétexte de sciences humaines est une escroquerie (10.06.2013) et les autres chroniques citées en note 2.
- Aimé Michel est souvent revenu sur ce « défi de l’idéologie à la réalité » et sur la nécessité de surmonter ses préjugés pour avoir prise sur le réel. Il écrit par exemple : « [T]ous les systèmes inventés par les pédagogues pour faire réussir quand même ceux qui échouent ont eux-mêmes échoué, et dans les meilleurs des cas (ceux où lesdits systèmes ont produit un effet quelconque), ils ont aggravé les différences entre cracks et cancres. » (Chronique n° 228, Le Q.I. d’Ivan Denissovitch – La réussite d’une vie ne se mesure pas à la hauteur atteinte sur le perchoir social, 03.09.2012). Ou encore : « Je suis convaincu que l’URSS ne serait pas cette aberration sinistre et bancale qui angoisse même les communistes si Lénine et Staline avaient d’abord été horlogers, mécaniciens, maçons » (Chronique n° 230, Le travail manuel – D’où diable nous vient ce préjugé qu’il n’est d’étude que livresque ? 10.09.2012).
Ces rappels demeurent d’actualité. Ils soulignent la réelle difficulté de mettre en œuvre la méthode scientifique expérimentale, en tout domaine mais plus particulièrement dans ceux où l’opinion est reine.
- On peut donner des exemples de cet élitisme involontaire dans d’autres disciplines que les mathématiques. Ainsi l’enseignement de la littérature française et de l’histoire qui était resté strictement chronologique jusque-là dans le secondaire est soudain devenu thématique. En littérature, au lieu d’étudier les meilleurs auteurs d’un siècle donné on enseigne aujourd’hui des genres littéraires en mêlant les auteurs de siècles divers et sans distinguer auteurs mineurs et majeurs. De même en histoire, la succession régulière des siècles avec les années de collège et de lycée organisait naturellement la pensée des élèves. De toute évidence l’erreur commise est la même que celle dénoncée par Aimé Michel en mathématiques : on force l’élève à réfléchir sur des abstractions avant d’avoir acquis les connaissances élémentaires qui seules peuvent servir de fondation solide pour accueillir et organiser des connaissances plus élaborées.
Pour beaucoup d’élèves il en résulte une compréhension nébuleuse sans chronologie où se confondent l’important et l’accessoire. Comme me le racontait des amis enseignants cela aboutit à des questions surprenantes comme : « On parle souvent en même temps de Bonaparte et de Napoléon, pourquoi cela ? ». Ou bien, lors d’une explication de texte mentionnant les stoïciens en classe de terminale, à la question « Qui étaient les stoïciens ? », le professeur obtient cette réponse : « Ah oui, madame, je sais, ce sont les résistants durant la guerre ». Que peuvent signifier dans ces conditions des thèmes comme « Mémoires plurielles de la guerre d’Algérie » qui relèvent si évidemment de l’enseignement universitaire ? Dès lors, faute d’avoir acquis un socle de connaissances suffisant et un sain esprit critique, certains des thèmes traités (par exemple la traite des esclaves ou le colonialisme) sont susceptibles de déclencher non une réflexion mais des réflexes sommaires, de susciter des émotions et d’accentuer le communautarisme.
- Plusieurs des constatations d’Aimé Michel dans ce diagnostic lucide sont confirmées par les enquêtes réalisées ces 25 dernières années. Ces enquêtes montrent que l’« instruction » en France n’a atteint ni ses objectifs sociaux ni ses objectifs éducatifs.
Si on en croit les comparaisons internationales la France régresse par rapport aux pays comparables. En ce qui concerne la capacité de lecture des enfants, en 1991, la France figurait dans le groupe de tête, juste derrière la Finlande, les Etats-Unis et la Suède pour les élèves de 9-10 ans, et en seconde position, derrière la Finlande pour ceux de 14-15 ans. En 2001, dans une autre enquête, la France obtenait un rang moyen parmi les pays européens mais en 2006, dans la même enquête elle passait significativement en dessous de cette moyenne (voir l’article de Claude Sauvageot et Nadine Dalsheimer publié dans la revue Education & formations en novembre 2008, http://www.education.gouv.fr/cid59105/comparaisons-internationales.html#La_situation éducative de la France comparée à celle d’autres pays de l’Union).
À partir de 2000, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) met en œuvre tous les trois ans auprès des jeunes de 15 ans, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). Le suivi porte sur les compétences effectivement acquises en compréhension de l’écrit, en mathématique et en science. En 2000 et 2003 la France se trouvait un peu au-dessus de la moyenne internationale mais en 2006 et 2009 elle tombe dans la moyenne. De 2000 à 2006, les meilleurs résultats et de loin sont fournis par la Finlande ; et parmi les pays européens, le Portugal, l’Espagne et la Grèce sont les plus mal classés. Depuis 2009, la région de Shanghai participe au programme PISA et ses résultats sont meilleurs que ceux de la Finlande sur les trois volets (http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/46624382.pdf) ! Les résultats de l’étude 2012 seront dévoilés le 3 décembre 2013. Selon les premières indiscrétions la France pourrait perdre entre deux et quatre places au classement (www.lexpress.fr/education/education-la-france-pourrait-perdre-des-places-aux-prochains-tests-pisa_1252981.html ; http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20121002.OBS4215/l-enquete-que-les-ecoles-francaises-ne-veulent-pas-voir.html).
Les moyennes sont une chose, certes intéressante, mais moins que la variabilité des résultats obtenus, c’est-à-dire la différence d’acquis entre les meilleurs élèves et les moins bons. Contre toute attente, en dépit de tous les discours et déclarations d’intention dont on nous abreuve depuis plusieurs décennies, la France apparaît comme l’un des pays les plus inéquitables. Dans une allocution prononcée en mars 2013, lors d’un colloque international de l’OCDE sur la formation des enseignants, Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE résume ainsi la situation : « Aujourd’hui, la France, comme de nombreux pays de l’OCDE avant elle, se lance dans une réforme profonde et ambitieuse de son système d’éducation. Cette réforme est cruciale. Les comparaisons internationales de l’OCDE montrent qu’il y a, en moyenne, en France plus de bon élèves que dans les autres pays de l’OCDE. Mais il y a aussi davantage d’élèves en difficulté. La France est en effet confrontée à une recrudescence de l’échec scolaire, il est passé, en 10 ans, de 15 % à 20 %. De plus, les inégalités sociales contribuent plus qu’ailleurs aux écarts de performance des élèves et les enfants de familles défavorisés sont trois fois plus exposées au risque d’échec scolaire. Chaque année, 150 000 jeunes sortent de l’école sans diplôme et se trouvent en situation d’extrême précarité sur le marché du travail. » (http://www.oecd.org/fr/edu/enseigner-un-metier-qui-sapprend.htm).
Christian Forestier qui a dirigé le Haut Conseil de l’évaluation de l’école (aujourd’hui Haut Conseil de l’éducation) estime que sur la période 2000-2005 : « Tout se passe comme si le système éducatif français obtenait des résultats excellents avec la moitié de ses élèves et très faibles avec l’autre moitié. Pour les uns, un des meilleurs systèmes au monde, pour les autres, un des plus mauvais des pays développés. » (C. Forestier, C. Thélot et J.-C. Émin, Que vaut l’enseignement en France ?, Stock, 2007). Même si cette excellence doit être relativisée (8,5% des élèves français atteignent le niveau 5, sur les 6 définis dans PISA, contre 15% en Finlande et au Canada ; 7,6% en moyenne dans l’OCDE), ce sont plutôt les mauvais résultats des enfants les moins favorisés socialement qui tirent vers le bas la moyenne française, ce qui nous renvoie à la question de « l’ascenseur social ».
Bien que ces piètres résultats semblent peu pris en compte dans les ministères, les journalistes s’en sont faits l’écho et les experts en ont débattus (voir par exemple le résumé des discussions à la conférence internationale de l’institut Aspen, http://www.aspenfrance.org/comment-redresser-la-position-de.html). Nombre de mesures ont été discutées pour y remédier qui portent sur le salaire des enseignants, l’autonomie des établissements, les horaires et autres points d’organisation. Toutefois, les défauts relevés ici par Aimé Michel (abstraction, élitisme) ont été rarement discutés ou de manière indirecte, par leurs symptômes (faible taux de bien-être à l’école, taux élevé d’anxiété, en particulier en mathématiques). Et quand ils l’ont été ce fut sur un mode défensif. Ainsi l’Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public (APMEP) a-t-elle vanté l’« accès à l’abstraction, à la symbolisation, à la rigueur » de l’enseignement français des mathématiques, fort différent de l’enseignement concret pratiqué en Finlande et, pour elle, « rien ne prouve que l’accent mis sur les mathématiques du “réel” soit corrélatif d’avancement dans le développement de compétences spécifiques dans le domaine mathématique » (http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article342). Certes, mais ne peut-on rechercher un meilleur équilibre ?
Pour en savoir plus le lecteur intéressé pourra consulter le « Que sais-je ? » de Georges Felouzis et Samuel Charmillot, Les Enquêtes PISA (PUF, Paris, 2012, 128 pp.).