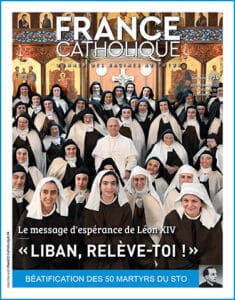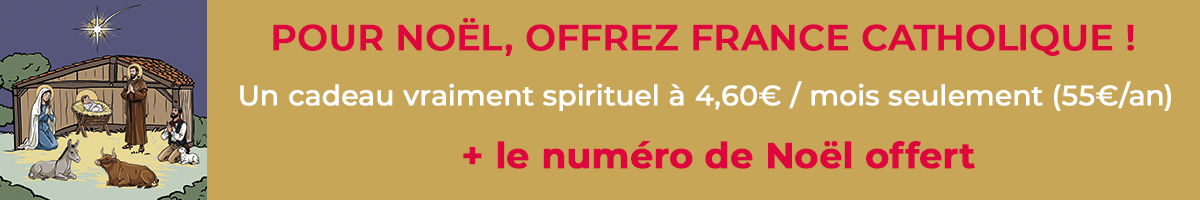Tandis que les engins américains et russes filent dans l’espace en direction de la planète Mars, dociles aux calculs des techniciens et aux ordres reçus de la Terre par-delà les millions de kilomètres, l’éternelle question nous remonte à l’esprit : qu’est-ce que l’homme, capable de tels exploits ?
Quelles sont les bornes de sa pensée, celles de sa puissance ?
Quand Kepler découvrit les lois des trajectoires exactement suivies près de quatre siècles plus tard par nos Mariner, il était malheureux, malade, pauvre, accablé de soucis familiaux. Il ne disposait d’aucun autre instrument de recherche que son génie, son immense patience, sa volonté acharnée de comprendre les mesures accumulées par son maître, Tycho Brahé. Alignant les opérations par milliers pendant les longues nuits glacées de l’hiver tchèque, surmontant les souffrances de son corps et de son âme, il obtint ce qu’il cherchait, d’où Newton, quelques décennies plus tard, devait tirer les lois de la mécanique céleste. 1
Le petit Dieu malade
Jusqu’où nos descendants, éclairés par l’inextinguible petite lampe des nuits de Prague, conduiront-ils l’aventure de notre espèce ? Le « petit dieu malade », ainsi que Grassé appelle l’homme moderne 2 , n’a-t-il pas lieu de céder un peu à son orgueil ? Et cependant, écoutons ce que disait lord Adrian, directeur de Trinity College 3, lors d’un Congrès sur Le cerveau et la conscience organisé par l’Académie pontificale des sciences : « Il n’a jamais paru utile de sortir du cadre des sciences naturelles pour décrire l’action des organes des sens et les signaux qu’ils envoient au cerveau. » Mais maintenant, nous pouvons aller plus loin et dire que l’on n’a nul besoin d’invoquer des facteurs non physiques pour rendre compte des activités extérieures du cerveau lui-même 4.
Désormais, on pourrait fabriquer un homme mécanique capable de faire tout ou presque tout ce que nous faisons nous-mêmes. Il faudrait, certes, que quelqu’un en donne le plan et le construise, mais il pourrait être construit de telle façon qu’il se comporte aussi intelligemment que nous-mêmes. La « machine universelle de Turing » peut s’attaquer à n’importe quel problème. En fait, poursuit le biologiste anglais, une machinerie capable de réaliser bien plus que n’en rêvait Condillac en imaginant sa statue 5 est maintenant chose possible. Notre actuelle statue de Condillac pourrait nous faire part de ses idées, répondre à nos questions, exprimer de la colère ou de la joie, reconnaître ses amis, acquérir des habitudes et résoudre des problèmes. Elle pourrait même être capable d’exprimer une vie intérieure, des espoirs et des craintes. Seulement, remarque lord Adrian, « nous ne la croirions pas ».
Aussi fantastique que cela paraisse, l’intelligence, par quoi nous dominons pourtant les animaux, n’est donc en aucune façon la preuve de notre spiritualité, dans ce domaine, puisqu’une machine peut faire aussi bien, et même mieux que nous (peut-être cependant sous une réserve dont je parlerai plus loin). Lors du Congrès où lord Adrian s’exprimait ainsi, le psychologue américain, H. L. Teuber, du Massachusetts Institute of Technology, souligna qu’en tout état de cause, une « machine de Turing » imitant l’intelligence humaine ne pourrait donner l’illusion complète de cette imitation qu’au prix d’un mensonge, puisqu’elle devrait s’affirmer consciente d’elle-même, ce que nous saurions pertinemment être faux. Elle mentirait, mais nous ne pourrions jamais le démontrer ! C’est le fameux « paradoxe de Turing ».
La question fondamentale
À ce point de la discussion, le célèbre biologiste australien sir John Eccles, posa la question fondamentale en ces termes: « En tant que neurophysiologiste, je voudrais bien que l’on me dise pourquoi, diable, nous sommes doués de conscience ? Car, en principe, nous pouvons expliquer tout notre fonctionnement en termes d’activité des circuits neuroniques, et par conséquent, la conscience semble absolument superflue. Bien entendu, je n’en crois rien, mais en même temps, je dois convenir que je ne vois aucune réponse logique à cette question. Si l’on essaie de comprendre pourquoi il faut que l’homme soit doué de conscience, il est certain que l’on ne peut nullement avancer comme argument que la conscience est nécessaire à des activités telles que l’argumentation logique et le raisonnement, ou même pour les activités de création et d’invention. »
Peu de temps après les discussions de ce Congrès, un biologiste français, le professeur Paul Neyrac, de Lille, examinait à son tour le problème en profondeur (a). Lui aussi arrivait à la conclusion que, réduit à son activité abstraite, mathématique, « le cerveau peut être ramené à sa structure logique, essentielle, sous la forme du réseau neural… La machine déterministe, de même, s’exprime dans toute sa généralité par l’automate fini, ou mieux encore, par la machine de Turing. »
Cependant, Nayrac rappelait fort à propos un théorème du mathématicien austro-américain Kurt Gödel montrant que la logique ne peut se ramener à une pure arithmétique. Il en concluait à « la supériorité de la pensée logique humaine à toute machine déterministe aujourd’hui concevable ». Cette conclusion semble constituer le point actuellement le plus avancé de la réflexion des biologistes sur la question de savoir si l’intelligence est, oui ou non, une machine. Elle mérite d’être discutée, car une machine n’est pas forcément déterministe. Les Américains ont poussé très loin l’étude de programmation de machines à comportements aléatoires, c’est-à-dire imprévisibles. De telles machines peuvent se déclarer libres, et le prouver exactement autant qu’homme le peut ! Elles peuvent simuler des démarches intuitives, et même irrationnelles. Alors ?
Quoi qu’il en soit, aucune des réalisations techniques qui, apparemment, pourraient légitimer notre orgueil, n’échappe à la logique des machines. La question de sir John Eccles reste donc sans réponse : si nous ne sommes que des machines, notre conscience est un mystère impénétrable. Pour aller jusqu’à la planète Mars, nous n’avons nul besoin de souffrir, ni d’aimer, ni de connaître l’espoir et la joie. Cependant, nous souffrons, nous aimons, nous espérons. Il faut expliquer cela ou reconnaître, avec Pascal, que l’homme est le plus grand prodige de l’univers. L’homme ou, plus précisément, toute pensée consciente. Une machine pouvait faire les calculs de Kepler. Mais sans l’héroïsme de Kepler dans les longues nuits glacées de Prague, jamais ces calculs n’auraient été entrepris.
Aimé MICHEL
(*) Chronique n° 38 – F.C. – N° 1279 – 18 juin 1971. Reproduite dans La clarté Au cœur du labyrinthe, chap. 9 « Conscience », pp. 244-246.
(a) Paul Nayrac : la Relation cerveau-machine et la mathématique moderne. (Confrontations psychiatriques, n° 6, 1970).
Les Notes de 1 à 5 sont de Jean-Pierre Rospars
Rappel :
Entre 1970 et sa mort en 1992, Aimé Michel a donné à France Catholique plus de 500 chroniques. Réunies par le neurobiologiste Jean-Pierre Rospars, elles dessinent une image de la trajectoire d’un philosophe dont la pensée reste à découvrir. Paraît en même temps, une correspondance échangée entre 1978 et 1990 entre Aimé Michel et le sociologue de la parapsychologie Bertrand Méheust. On y voit qu’Aimé Michel a été beaucoup plus que le « prophète des ovnis » très à la mode fut un temps : sa vision du monde à contre-courant n’est ni un système, ni un prêt-à-penser, mais un questionnement dont la première vertu est de faire circuler de l’air dans l’espace confiné où nous enferme notre propre petitesse. Empli d’espérance sans ignorer la férocité du monde, Aimé Michel annonce certains des grands thèmes de réflexion d’aujourd’hui et préfigure ceux de demain.
Aimé Michel, La clarté au cœur du labyrinthe. Chroniques sur la science et la religion publiées dans France Catholique 1970-1992. Textes choisis, présentés et annotés par Jean-Pierre Rospars. Préface de Olivier Costa de Beauregard. Postface de Robert Masson. Éditions Aldane, 783 p., 35 € (franco de port).
Aimé Michel, L’apocalypse molle. Correspondance adressée à Bertrand Méheust de 1978 à 1990, précédée du Veilleur d’Ar Men par Bertrand Méheust. Préface de Jacques Vallée. Postfaces de Geneviève Beduneau et Marie-Thérèse de Brosses. Éditions Aldane, 376 p., 27 € (franco de port).
À payer par chèque à l’ordre des Éditions Aldane,
case postale 100, CH-1216 Cointrin, Suisse.
Fax +41 22 345 41 24, info@aldane.com.
Pour aller plus loin :
- « La racine du génie n’est pas dans l’intelligence mais dans la volonté » écrit Aimé Michel dans Les paradoxes du génie (chronique n° 66, La clarté au cœur du labyrinthe, chapitre 7, p. 206), résumant ainsi les recherches de Catherine Morris Cox. Le travail de Kepler illustre concrètement cette affirmation. On pourra s’en convaincre en lisant la quatrième partie (« La ligne de partage des eaux ») consacrée aux vies de Tycho Brahé (1546-1601) et Johannes Kepler (1571-1630) du remarquable livre d’Arthur Koestler, Les somnambules. Essai sur l’histoire des conceptions de l’univers (trad. par G. Fradier, Calmann-Lévy, Paris, 1960).
En 1596, Kepler âgé de 25 ans, étudiant à Gratz (aujourd’hui en Autriche), publie à Tübingen son premier livre Mysterium cosmographicum. Il entend y dévoiler le secret de la création en construisant un système du monde fondé sur les cinq solides pythagoriciens (le tétraèdre formé de 4 triangles équilatéraux, le cube, l’octaèdre à 8 triangles équilatéraux, le dodécaèdre à 12 pentagones et l’icosaèdre à 20 triangles équilatéraux), qui sont, comme on le sait depuis Euclide, les seuls solides réguliers à s’inscrire dans une sphère. Kepler croit comprendre pourquoi les planètes sont au nombre de six (c’était avant la découverte d’Uranus et de Neptune) et quel décret divin fixe les distances entre leurs orbites : « Dans l’orbite, ou sphère, de Saturne, Kepler inscrivait un cube ; et dans le cube une autres sphère ; celle de Jupiter. Puis venait le tétraèdre dans lequel s’inscrivait la sphère de Mars. Entre les sphères de Mars et de la Terre on insérait le dodécaèdre ; entre la Terre et Vénus l’icosaèdre, entre Vénus et Mercure l’octaèdre. » Bien que l’ordre les solides (6, 4, 12, 20, 8) ne soit pas celui du nombre croissant de leurs faces, Kepler s’enthousiasme : « Je n’étais plus las de mon travail ; je ne reculais devant aucun calcul, si difficile qu’il fût. Jour et nuit je fis mes calculs pour voir si la proposition que je venais de formuler s’accordait avec les orbites de Copernic ou bien si ma joie serait emportée par le vent… En quelques jours tout fut en place. Je vis les solides symétriques s’insérer l’un après l’autre avec tant de précision entre les orbites appropriées… que si un paysan demandait à quels crochets les cieux sont fixés pour ne pas tomber, il serait facile de lui répondre. » Il est ainsi le premier à proclamer la vérité du système héliocentrique de Copernic, pour des raisons à la fois mystiques et scientifiques. Dans les douze premiers chapitres de son livre il explique les pensées secrètes du Créateur, multiplie les raisonnements a priori, traite d’astrologie, de numérologie, du symbolisme du Zodiaque, de l’harmonie des sphères… Mais soudain, au chapitre 13, le ton change, devient empirique et moderne : « Ce que nous avons dit jusqu’ici ne servait qu’à soutenir notre thèse par des arguments de probabilité. Nous allons procéder maintenant à la détermination astronomique des orbites et aux considérations géométriques. Si celles-ci ne confirment point la thèse, nos efforts précédents auront sans aucun doute été vains. » Sage remarque mais qu’il ne suit pas jusqu’au bout car ses calculs découvrent bien des incohérences qu’il préfère attribuer aux données de Copernic plutôt qu’à son modèle ! Mais cet échappatoire ne le satisfait sans doute pas car, par la suite, il tente de construire un nouveau modèle d’univers fondé sur les harmonies musicales de la gamme de Pythagore, mais là encore ses calculs se heurtent à des difficultés insurmontables.
Cette fois il se rend compte que ses données sur les planètes sont insuffisantes et qu’il lui faut des mesures exactes. Un seul homme les a, le Danois Tycho Brahé, qui les accumule depuis une vingtaine d’années dans son observatoire d’Uraniborg, mais il refuse de les publier avant d’avoir terminé sa propre théorie… Le 4 février 1600, les deux hommes se rencontrent au château de Benatek, près de Prague : Kepler, chassé de Gratz par les persécutions religieuses, et Tycho, exilé en raison de sa dureté à l’égard de ses manants. Tout les oppose, sauf leur irritabilité et leur passion de la découverte : le premier, 29 ans, d’origine modeste doit son instruction aux bourses d’étude fondés par les ducs de Wurtemberg, tandis que le second, 53 ans, est un grand seigneur qui n’a plus que dix-huit mois à vivre. En dépit de leurs relations houleuses, Tycho sait reconnaître le génie de Kepler et en faire son assistant… Il faudra huit ans à Kepler ans pour tirer parti des données de Tycho et publier en 1609 son second livre, l’Astronomie nouvelle, qui raconte la difficile genèse des deux premières lois planétaires.
L’histoire commence quelque peu comme la précédente, si ce n’est que sa nouvelle hypothèse (encore fausse) est à nos yeux de moderne plus respectable que celle des solides pythagoriciens emboîtés. Kepler y présente en effet une tentative de rendre compte de l’orbite de Mars à l’aide d’une orbite circulaire excentrique, c’est-à-dire dont le Soleil n’occupe pas le centre, située dans un plan fixe, différent du plan de l’orbite terrestre, et parcourue par la planète d’une vitesse non uniforme. (Ce dernier point était un pas remarquable dans la bonne direction, rompant avec la fascination du mouvement uniforme tenu pour « parfait » par ses prédécesseurs). « Il choisit dans le trésor de Tycho quatre positions de Mars observées aux bons moments, la planète en opposition avec le Soleil. Le problème géométrique à résoudre était donc de déterminer, à partir de ces quatre positions, le rayon de l’orbite, la direction de l’axe et la position des trois points centraux sur cet axe [le Soleil, le centre du cercle et un autre point appelé punctum equans]. Kepler ne pouvait aborder ce problème par une méthode mathématique rigoureuse, mais seulement par une série d’approximations, à poursuivre jusqu’à ce que toutes les pièces du jeu de construction se tiennent à peu près. Cela supposait un incroyable labeur dont on se fera une idée d’après les brouillons de Kepler que l’on a conservés et qui couvrent neuf cents pages de calculs finement tracés. » (p. 376) (calculs faux au demeurant car Delambre montra vers 1820 que Kepler commit des erreurs qui se compensaient). Kepler conclut : « Tu vois maintenant, lecteur diligent, que l’hypothèse fondée sur cette méthode non seulement répond aux quatre positions sur lesquelles elle était fondée, mais représente correctement aussi, à deux minutes [d’angle] près, toutes les autres observations… » (p. 377).
Le Kepler du Mysterium s’en serait sans doute tenu là mais non celui de l’Astronomie nouvelle : il avertit son lecteur « cette hypothèse qui s’accorde si bien avec les oppositions observées, est pourtant fausse » et il s’emploie à le démontrer. Il choisit deux autres observations remarquables de Tycho et montre qu’il y a jusqu’à huit minutes d’écart entre les positions de Mars attendues par sa théorie et les positions observées ! « Mais, écrit Kepler, la divine bonté nous a donné en Tycho un observateur si fidèle que nous devons reconnaître ce don divin et nous en servir ». Alors il capitule devant les « faits obstinés, irréductibles ». C’est un moment crucial de l’histoire de la pensée : « Autrefois, si un détail n’était pas conforme à l’hypothèse, on le corrigeait ou on l’oubliait. A présent cette vénérable indulgence n’était plus permise. » Comme l’écrit Whitehead « C’est l’union d’un intérêt passionné pour les petits détails avec une égale passion pour la généralisation abstraite qui constitues la nouveauté de notre société actuelle. » « Cette nouvelle attitude, ajoute Koestler, a fixé le climat de la pensée européenne au cours des trois derniers siècles ; elle a distingué l’Europe de toutes les autres civilisations passées et présentes, et lui a permis de transformer le milieu naturel comme une espèce nouvelle qui serait née soudain sur le globe. (…) Dans l’Astronomia Nova, une théorie bâtie sur des années de travail et de tourments, est immédiatement jetée par-dessus bord à cause d’un misérable écart de huit minutes qui la contredit. Au lieu de maudire cette pierre d’achoppement, Kepler en fait la pierre angulaire d’une nouvelle science. » (p. 379).
Poursuivant ses réflexions il découvre la Deuxième Loi (avant la première), loi selon laquelle la ligne qui joint la planète au Soleil balaye des aires égales en des temps égaux. « [P]ar trois méthodes fausses, défendues de façon encore plus fausse, il tomba sur la loi juste » (p. 385). Puis il tente une dernière fois d’attribuer une orbite circulaire à Mars et, au terme de deux ans d’effort, se voit obligé de conclure que l’« orbite n’est pas un cercle, mais une figure ovale ». C’est un déchirement car l’ovale n’a pas l’attrait rassurant et l’antique séduction du cercle ; c’est une forme arbitraire qu’il qualifie lui-même de « charretée de fumier ». Pendant l’année 1604, sans argent, alors qu’il souffre d’une « fièvre biliaire » et que sa femme malade accouche d’un fils, il s’acharne sur un ovale en forme d’œuf avant de s’attacher à l’« ellipse parfaite » déjà connue d’Archimède et d’Apollonios. Mais là encore « il se fourre dans un nouveau labyrinthe », selon ses propres termes, trouve la bonne solution sans la reconnaître, se trompe à nouveau dans ses calculs, avant de retrouver l’ellipse par une autre voie. C’est enfin la Première Loi : les orbites sont des ellipses dont le Soleil occupe l’un des foyers. (Autrement dit les planètes dans leur course se rapprochent et s’éloignent alternativement du Soleil ; la deuxième loi précise que leur vitesse change, qu’elles vont plus vite lorsqu’elles s’approchent du Soleil, plus lentement lorsqu’elles s’en éloignent).
En 1618, Kepler livre, dans son Harmonie du Monde, la troisième loi qui lie le temps mis par une planète pour accomplir une révolution à sa distance moyenne au Soleil. Il meurt en 1630, douze ans avant la naissance de Newton qui devait intégrer les trois lois dans une synthèse permettant seule de véritablement les comprendre. « Pour Kepler, elles ne voulaient pas dire grand-chose ; il ne voyait pas de raison logique pour que l’orbite fût une ellipse au lieu d’un œuf. Aussi fut-il plus fier de ses cinq solides parfaits que de ses Lois ; et ses contemporains y compris Galilée [et Descartes], furent également incapables de voir la signification de ces découvertes (…). » (p. 393). Pour Koestler, le succès de Kepler vient, notamment, de ce qu’il fut le premier à respecter la causalité physique. « Tant que la cosmologie suivit des règles purement géométriques, sans se préoccuper de causes physiques, on pouvait pallier les contradictions des théories ou des faits, en insérant un rouage de plus dans le système. Dans un univers régi par des forces réelles, physiques, cela n’était plus possible. La révolution qui libéra la pensée du carcan des vieux dogmes, forgea aussitôt une discipline rigoureuse. » (p. 380). (Voir également l’article Kepler dans le Dictionnaire amoureux du Ciel et des Etoiles de Trinh Xuan Thuan, Plon-Fayard, 2009).
- Pierre-Paul Grassé (1895-1985), né à Périgueux de parents commerçants, fait des études de médecine à Bordeaux. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, il achève ses études à Paris, notamment dans le laboratoire d’Etienne Rabaud. Il est chargé de conférence à l’Ecole nationale supérieure agronomique des Montpellier et y soutient sa thèse sur les protozoaires flagellés parasites (1926). Professeur de zoologie à l’université de Clermont-Ferrand (1929) puis maître de conférences à l’Université de Paris (1935), il fait plusieurs missions en Afrique et devient l’un des grands spécialistes du comportement des termites. Professeur à la Faculté des Sciences de l’Université de Paris, directeur du Laboratoire d’évolution des être organisés (1940), membre de l’Académie des Sciences (1948) qu’il présidera (1967), il joue un rôle majeur dans la zoologie française : il relance l’étude des vertébrés négligée entre les deux guerres, soutient les jeunes entomologistes de l’INRA et la création de la Station de recherches sur l’abeille et les insectes sociaux qui sera dirigée par son élève Rémy Chauvin. Il est, entre autres, le directeur et co-auteur d’un monumental Traité de Zoologie en 38 volumes (1952-1973), d’un Précis de biologie animale (1935-1966, avec Max Aron) et d’un Termitologia en trois volumes (1982-1984). Il écrit quatre ouvrages de réflexion pour le grand public, tous les trois chez Albin Michel : Toi ce petit dieu ! Essai sur l’histoire naturelle de l’homme, (1971) ; L’évolution du vivant – Matériaux pour une nouvelle théorie transformiste (1973) ; La Défaite de l’amour ou le Triomphe de Freud (1976) ; enfin L’homme en accusation – De la biologie à la politique (1980). Il est aussi l’auteur, sous le nom de Harald Stümpke, de La biologie des rhinogrades (Masson, 1962), soi-disant traduit de l’allemand, qui est un canular scientifique sur un inexistant nouvel ordre de mammifères ! Grassé se fait également connaître comme critique du darwinisme et défenseur de Lamarck. Pour lui, l’évolution ne se fait pas en réaction à des forces physiques externes aux être vivants mais sous l’effet d’une dynamique interne qui leur est propre.
- Lord Adrian (1889-1977), né à Londres, commence par des études classiques puis se tourne vers la médecine à Cambridge et à Londres. Médecin militaire pendant la guerre, il revient ensuite au laboratoire de physiologie de Cambridge. Il y poursuit les travaux de Keith Lucas, son maître décédé, sur les impulsions par tout ou rien, qu’on appelle aujourd’hui potentiels d’action, des nerfs et des muscles. C’est ainsi qu’en 1925 il découvre, grâce à l’électromètre capillaire de Lucas, qu’un neurone sensoriel du muscle de grenouille envoie au long de son axone des trains de potentiels d’action lorsqu’on le stimule (ici en étirant le muscle) et que la fréquence des potentiels d’action augmente lorsqu’augmente l’intensité de la stimulation. Il découvrait ainsi une propriété générale de codage de l’information par les neurones sensoriels de tous les organismes. Il généralise cette relation qui lie l’intensité à la fréquence et en 1928 il synthétise ses observations dans un ouvrage classique Les bases de la sensation. Il y écrit « La simplicité de cette relation est en même temps très naturelle et très étonnante. Cela signifie que notre esprit reçoit toute l’information qu’il peut obtenir à partir de messages provenant des récepteurs qui sont en contact avec lui, mais cela signifie aussi que le corrélatif mental est une copie très fidèle des évènements physiques au sein des nerfs sensoriels. » Oui, c’est difficile à concevoir, mais la riche perception du monde que nous avons, tout ce que nous voyons, entendons, sentons, provient intégralement de ces trains de potentiels d’action véhiculés en permanence à l’état de veille par nos neurones sensoriels. Il partagea le prix Nobel de physiologie et de médecine avec son compatriote Sir Charles Sherrington en 1932. Il fut président de la Royal Society de 1950 à 1955. Il est fait baron en 1955. (Voir l’article Adrian dans Le cerveau cet inconnu – Dictionnaire encyclopédique, sous la direction de Richard L. Gregory, coll. Bouquins, Robert Laffont, 1993).
- (4) Cette affirmation semblera sans doute difficile à admettre par la plupart des lecteurs, tant nous avons l’habitude d’attribuer une nature « spirituelle » (non physique) à tous les contenus de notre « esprit » (nos connaissances par exemple, voir la chronique n° 14, Matière et mémoire 1971, parue ici le 3 septembre 2009) en rapport direct avec ses activités extérieures (comme notre langage). On comprend mieux aujourd’hui, grâce aux progrès des neurosciences, la nature et l’importance des « calculs neuronaux » dans toutes les opérations mentales, même si on est encore loin de les comprendre dans le détail. Par contre la conscience elle-même est une profonde énigme. Les remarques de E.D. Adrian et J. Eccles restent donc totalement d’actualité.
- (5) Sur Condillac, voir note (d) dans la chronique n° 12 Les enfants-loups du Pakistan, publiée ici le 6 avril 2009.