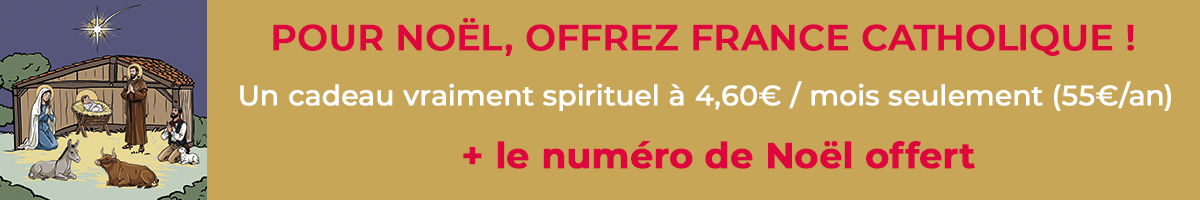DES LECTEURS, intrigués par quelques allusions que j’ai faites à la crise économique dans les pays de l’Est, me demandent des précisions 1 . L’un d’eux exprime son scepticisme : la crise économique n’est-elle pas un phénomène typiquement capitaliste, qui donc disparaît automatiquement en même temps que l’économie de marché ?
Je rappelle que je ne suis pas économiste et ne peux donc proposer aucune explication digne d’intérêt de ce qui se passe à l’Est. Les mécanismes profonds me dépassent (je suis d’ailleurs irrespectueusement convaincu que les auteurs de savants traités n’en savent pas davantage, cette opinion étant fondée sur : a) leurs contradictions ; b) leur incapacité à faire la moindre prédiction qui se vérifie. Et hors la prédiction vérifiée, il n’y a pas de science) 2.
Ce que je vais dire est donc uniquement fondé sur l’expérience quotidienne des gens, des pays de l’Est, soit que je les rencontre, soit que je lise leur témoignage.
Dans la situation économique des pays de l’Est, il faut faire une distinction. Il y a d’abord une crise permanente du système, qui s’aggrave d’année en année, et qui se caractérise par :
1. LA PÉNURIE ET LA PAGAILLE DU MARCHÉ OFFICIEL (non pas le marché au sens théorique et général − celui-là peut-être aussi, je n’en sais rien −, mais le marché quotidien de la ménagère et de sa famille) ;
2. L’ÉTABLISSEMENT D’UN CIRCUIT DE MARCHÉ PARALLÈLE bien fourni, échappant complètement au contrôle de la loi, prenant sa source dans le pillage généralisé de la « propriété socialiste » et aboutissant au marché noir ;
3. LA PART CROISSANTE DU TRAVAIL « NOIR » effectué soit hors des heures de travail officielles, avec du matériel chapardé, soit grâce à l’absentéisme (sévèrement puni par la loi, mais qui bénéficie de la complicité générale, car tout le monde en a besoin, même le mouchard) ;
4. LA PART CROISSANTE DU TRAVAIL IMPRODUCTIF, soit parce qu’il est moins fatigant, soit parce qu’il permet de n’avoir aucune responsabilité dangereuse, soit parce qu’il facilite le « pillage de la propriété socialiste ». Par exemple, la manutention, consistant à garder les richesses réellement produites et à les transporter d’un endroit à l’autre, occuperait, en URSS, trente fois plus de personnel que dans les pays occidentaux avancés ;
5. L’APATHIE CROISSANTE A L’EGARD DU « TRAVAIL SOCIALISTE », c’est-à-dire du travail professionnel régulier.
Sans essayer, comme je l’ai dit, d’aller au fond des choses, voyons pourquoi, au niveau du simple citoyen, les choses se passent ainsi et ne peuvent que s’aggraver d’année en année.
D’abord, pourquoi l’état normal du marché est-il la pénurie et la pagaille ? La réponse est que tout se tient. N’oublions pas que, dans ces pays, tout le monde est employé de l’Etat, c’est-à-dire fonctionnaire. S’il manque ici des chaussures, là des oranges, le responsable des chaussures et celui des oranges n’ont aucun intérêt à ce que cela s’arrange, au contraire, car cette situation favorise une lucrative activité de marché noir.
Le sujet de conversation favori des Russes est celui des arrivages : à tel magasin est arrivé un lot de pantalons, à tel autre un lot de produits japonais. Aussitôt, dans chaque famille, la vieille grand-mère à la retraite ou le travailleur en congé de maladie plus ou moins fictive s’en va faire la queue pour avoir ces produits au prix officiel, qui est avantageux. Pourquoi tel arrivage de pantalons a-t-il eu lieu à tel endroit ? Cela relève des mystères du Plan, qui sont aussi impénétrables que les desseins de la providence (en réalité, la distribution est régie par la paperasserie bureaucratique, et cette explication est bien suffisante).
Devant les lieux d’arrivage se produit donc ce phénomène caractéristique des pays socialistes, LA QUEUE 3 . Et vous n’avez ni vieille grand-mère spécialisée dans la queue ni congé de maladie ou autre au bon moment : c’est regrettable, mais pas tragique vous obtiendrez la même chose au prix fort du marché noir. Pour payer ce prix fort, l’ingéniosité du citoyen des pays de l’Est a eu le temps de trouver vingt procédés, depuis des dizaines d’années que cela dure.
Le procédé le plus répandu est le donnant-donnant, chacun se débrouillant pour avoir à échanger quelque chose d’introuvable préalablement chapardé sur les lieux du travail : c’est le « vol de la propriété socialiste » sans cesse dénoncé par les journaux, qui semble atteindre des proportions pharamineuses (on dit 20% ou plus dans certaines industries ou sur certains lieux de distribution) et portant sur tout objet pouvant échapper un moment au regard de la foule : robinet, ampoule électrique de w.-c., etc.
Le travail noir est encore bien plus répandu et constitue d’ailleurs tout simplement une condition de survie (de même que le chapardage) il faut toujours garder à l’esprit le fait que tout le monde est fonctionnaire et accomplit les normes d’un plan. Que se passe-t-il donc quand votre plomberie se déglingue ou que votre courant saute ? Toute intervention instantanée d’un artisan est exclue : il n’y a pas d’artisan. Alors, eh bien ! vous connaissez toujours quelqu’un qui sait où trouver la pièce défaillante et qui vous tirera d’affaire (au prix fort).
Ainsi, toute une activité économique illégale, parallèle, tend à se développer toujours davantage hors des calculs officiels, qui sont de plus en plus illusoires. Elle constitue une part essentielle de l’économie réelle et ne peut évidemment apparaître nulle part dans les plans.
Selon certains auteurs qui connaissent bien la vie quotidienne des pays socialistes, tout citoyen vit en moyenne, là-bas, deux fois au-dessus de ses moyens officiels. C’est-à-dire que l’Etat ne légifère plus que sur la moitié de la vie économique réelle au niveau de la consommation. Le reste est un maquis aux lois empiriques inconnues qu’aucun économiste ne saurait étudier sur place sans se faire sur-le-champ encabaner pour calomnie bourgeoise et dénigrement impérialiste.
On se demande d’abord comment cela peut se passer dans des pays où la dénonciation semble si bien organisée. Mais le mouchard n’est pas un pur esprit ! Lui aussi doit survivre, c’est-à- dire vivre deux fois au-dessus de ses moyens officiels. Il est donc « tenu », comme on dit, par ceux qui l’aident à survivre. Si tu me dénonces, je te dénonce aussi.
La question de savoir comment la crise mondiale vient se greffer sur tout cela devrait être examinée à un niveau plus profond que celui de la description anecdotique où je me suis tenu par défaut de compétence. Sans doute cette crise doit-elle rendre encore plus irréaliste et impuissant tout le système de la planification. En tout cas, l’aggravation de la crise permanente du système est ressentie dans la masse des gens avec assez d’acuité pour que les bruits les plus bizarres circulent en ce moment en URSS.
Par exemple que les militaires vont prendre le pouvoir et commencer le grand coup de balai ! Ce qui semble absurde, les militaires étant les fonctionnaires les plus dociles et les plus surveillés de l’État. Le plus vraisemblable est au contraire que tout peut s’aggraver sans qu’il se passe rien.
Pourquoi se passerait-il quelque chose ? Qui vraiment en URSS se soucie de la pagaille croissante ? La détente permet, par les échanges économiques avec l’Occident, de durer tant bien que mal sans catastrophe. N’est-ce pas la seule ambition de tous les gouvernements du monde depuis qu’il y a des gouvernements ?
La seule question de survie pour les régimes de l’Est est en définitive paradoxalement celle-ci : quelle aggravation de la situation économique occidentale sont-ils en mesure de supporter sans catastrophe ? Que se passerait-il, par exemple, si les Etats-Unis ne pouvaient leur livrer les 14 millions de quintaux de céréales actuellement négociés ? Personne, je crois, n’en sait rien.
Aimé MICHEL
(*) Chronique n° 217 parue dans France Catholique-Ecclesia − N° 1500 – 12 septembre 1975
Les notes ont été écrites par Jean-Pierre ROSPARS le 6 août 2012
Pour aller plus loin :
- Ces allusion à la crise économique dans les pays de l’Est se trouvent notamment dans la chronique n° 214, Le cheval fou (La « crise » de 1975 à nos jours) parue ici le 30.01.2012. Aimé Michel y écrit avec pertinence (en août 1975) : « les régimes communistes sont bien plus gravement menacés que nous si la crise dure et s’aggrave encore quelques années. C’est que leur économie construite de A à Z sur la planification centralisatrice n’a aucun moyen de faire face à des remous imprévisibles ni d’y échapper. (…) En Occident, la crise est douloureuse à la base, au niveau de la population. A l’Est, elle mine l’assise même du pouvoir, elle brise peu à peu ses ressorts. Le gouvernail et le moteur, pour prendre une autre image, cessent de répondre à la main du pilote. (…) Si l’épreuve dure, si elle empire, celui qui ne peut pas changer n’y résistera pas. ». Voir aussi la chronique n° 104, Software et politique, parue ici le 1er juin 2010.
- Aimé Michel a toujours conservé ce scepticisme à l’égard des économistes, il me le redira bien des années plus tard. Il est vrai que la prévision économique est une activité bien difficile. L’économiste Jean Fourastié est souvent revenu sur cette difficulté : « cela est banal de le dire, mais la banalité même des faits souligne leur caractère intime et dramatique, nous ne connaissons pas l’avenir de notre société, de notre personne même. Les évènements même les plus certains dans leur échéance, comme l’évolution des régimes politiques, le progrès des techniques de production, la transformation des activités économiques et du climat social, les évènements familiaux, la mort de chaque individu, restent inconnus dans leurs modalités et dans leurs dates d’échéance. » (Court terme – long terme dans Idées majeures, Gonthier, Paris, 1966, p. 185).
Pourtant, dès 1947, Jean Fourastié avait clairement identifié la cause prépondérante du progrès économique et de l’élévation du niveau de vie dans l’accroissement de la productivité du travail, et non, comme on le disait jusqu’alors, des seules richesses naturelles, de leur exploitation dans les pays pauvres, d’une meilleure justice sociale, de la force des revendications syndicales accompagnées de grèves…, toutes explications qui tendent à confondre les causes et les conséquences. Fort de cette compréhension, Fourastié pouvait annoncer, dès 1948 dans son cours professé au CNAM, et dès 1949 dans son livre classique Le grand espoir du XXe siècle, le progrès économique et social des années 1946-1975, ses moyens et ses modalités essentielles. En 1979, il publiait Les trente glorieuses, qui décrivaient « les mêmes évènements, mais après leur réalisation effective et leur enregistrement par l’histoire. » Ce livre répondait entre autre à cette question majeure : « comment cette évolution, ce “progrès” matériel, désiré depuis deux ou dix mille ans par l’humanité, est-il devenu possible en Occident et en France même ; comment a-t-il pu être réalisé en fait, d’abord lentement du début du XVIIe siècle au milieu du XXe, puis à la vitesse que nous montrent les statistiques des trente récentes années ? Comment ce vieux rêve d’affranchir les hommes de la faim et des épidémies, du travail servile et de la mort précoce – idée qui n’était qu’un rêve parce que tous les hommes, lorsqu’ils ne rêvaient pas, la savaient hors de portée pratique, hors de tout espoir de réalisation – comment ce rêve, donc, a-t-il pu, et en si peu d’années, devenir espoir, puis, histoire ? » (Les trente glorieuses ou la Révolution invisible de 1946 à 1975, Fayard,, Paris, pp. 189-190).
L’expression de Trente Glorieuses que Fourastié proposa pour décrire cette période de l’histoire de France est désormais passée dans la langue mais on oublie trop fréquemment que cette période avait été minutieusement annoncée, préparée, décrite avant sa réalisation, par un homme « qui voyait clair et loin » (Jean Monnet, Mémoires, Fayard, 1976, p. 328) et qui avait vu aussi les lourds nuages assombrissant l’avenir des hommes. Mais ceci est une autre histoire…
- L’historien Alain Besançon, qui fut communiste et membre du PCF de 1951 à 1956 et se l’est beaucoup reproché, a décrit avec beaucoup de force et de concision ce qu’était la vie en URSS dans les années 70, notamment dans son livre Anatomie d’un spectre. L’économie politique du socialisme réel (Calmann-Levy, Paris, 1981). Il confirme en tout point l’analyse d’Aimé Michel. En voici quelques extraits :
« La propriété, voire la simple possession, entoure le citoyen d’une enveloppe protectrice d’autant plus épaisse que les biens possédés sont nombreux abondants et variés. Il n’est pas dans l’intention de l’Etat soviétique de laisser cette enveloppe se consolider, ni d’autoriser les sujets à se constituer un matelas d’argent, d’épargne, de provisions. (…) Pour éduquer le sujet, il faut le dépouiller de ses enveloppes protectrices. Ainsi seulement peut-on lui appliquer ce qu’on appelle, depuis Lénine, le contrôle. Le contrôle politique est assuré par l’ubiquité du Parti et de ses organes, le contrôle social par l’encadrement soviétique de la vie, par l’éducation, la culture, la surveillance du langage. Le contrôle économique est assuré par la pénurie. Il faut que le sujet soit dans un état chronique de dépendance, qu’il se sente jour après jour dépendant. Dans l’appartement communautaire, la cuisine commune le met sous la dépendance de ses voisins. L’architecture soviétique fait beaucoup pour collectiviser l’habitation familiale. Mais le grand instrument du contrôle économique est la queue. La queue est un acte qui n’est pas dicté par la contrainte politique, mais par le simple jeu de la contrainte économique : elle est l’acte économique soviétique par excellence. (…) Elle occupe le sujet plusieurs heures par jour et lui fournit un type spontané de socialité. (…) » L’organisation de la pénurie est donc un chapitre particulier du principe désorganisateur ou destructeur inhérent à la construction du socialisme. Il n’est pas certain que cette pénurie ait des effets uniquement négatifs. On ne peut certes attendre de la queue qu’elle soit une école d’amour et de dévouement. Mais quand, parvenu au bout de la queue, le consommateur peut mettre enfin la main sur un morceau de viande, sur une chemise, sur un plein journal de pommes de terre gelées, il le ressent comme une récompense, et comme un don que lui fait l’État. Comme il y a peu de rapport entre le travail du salarié et le salaire qu’il reçoit, comme l’argent n’est pas un instrument de mesure, mais un signe de l’arbitraire étatique, et comme l’argent lui-même compte moins que la chance ou la patience pour mettre la main sur le bien convoité, celui-ci apparaît comme un don gratuit et une aumône généreuse. “Cette chemise, ces pommes de terre, fait entendre l’État, c’est moi qui te les donne.” (…) Le consommateur fait l’apprentissage de la dépendance en étant tenu des deux côtés à la fois, par ce qu’il a et par ce qu’il n’a pas, parce qu’il n’a rien et parce qu’il a quelque chose. » (pp. 80-83).