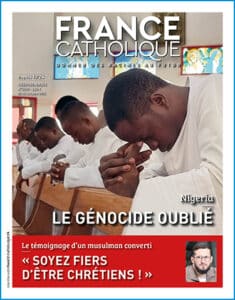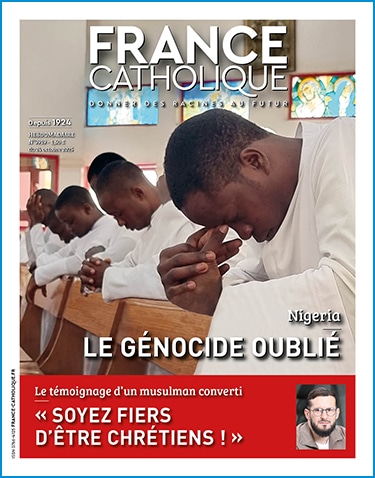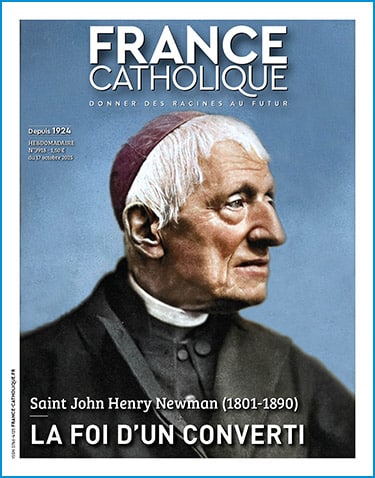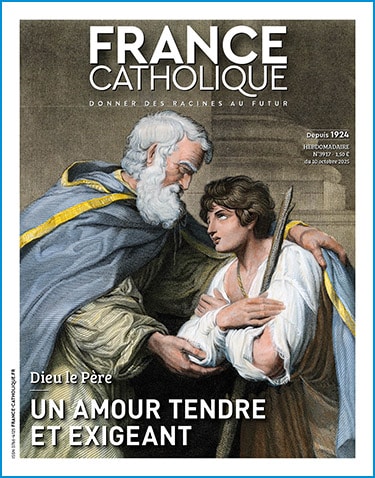UN BIOLOGISTE IMPRUDENT EN PHYSIQUE 1
Depuis le moment où Jacques Monod prononça son célèbre cours inaugural au Collège de France et surtout depuis la parution de son livre, il y a un domaine de plus où l’on a cessé de s’embêter : c’est celui de la « philosophie naturelle ».
Pendant des lustres, les philosophes s’étaient disputés sur les notions de finalité et de causalité en biologie. Les savants, peu soucieux de s’engager dans des querelles ne conduisant à aucun test expérimental, se montraient plus discrets. Mais la discrétion n’empêche pas les idées de derrière la tête et la plupart des biologistes avaient la leur. Les uns, déterministes et farouchement antifinalistes, se recrutaient dans le matérialisme de stricte obédience. D’autres admettaient que, de quelque façon inconnue, la vie souvent agit ou évolue comme si elle savait où elle va.
C’est alors que Monod proposa sa « téléonomie ».
Des mécanismes agissant au hasard
– Il est tout à fait vain, dit-il en substance, de nier qu’un organe naturel comme l’œil représente l’aboutissement d’un « projet » ; celui de capter les images, alors que ce « projet » est évident dans la réplique artificielle de l’œil, à savoir l’appareil photographique. Plutôt que de refuser cette notion, ainsi que certains biologistes ont tenté de le faire, il est au contraire indispensable de la reconnaître comme essentielle à la définition même des êtres vivants. Nous dirons donc que ceux-ci se distinguent de toutes les autres structures de tous les autres systèmes présents dans l’Univers par cette propriété, que nous appellerons téléonomie.
Jusque-là (et Monod est cité ici à peu près textuellement, cf. Le Hasard et la Nécessité, p. 22), on ne voit pas en quoi la téléonomie se distingue du finalisme pur et simple.
Cependant, cette distinction existe, même si elle est difficile à définir.
Elle est imposée par le principe d’objectivité, défini par Monod comme le « refus systématique (c’est lui qui souligne) de considérer comme pouvant conduire à une connaissance “vraieˮ toute interprétation des phénomènes donnée en termes de causes finales, c’est-à-dire de projet ». Et elle est justifiée, toujours aux yeux de Monod, par le fait que la vie ne viole jamais les lois causales de la physique.
Résumons :
1. Les phénomènes vivants sont manifestement structurés en vue d’un but, ils sont téléonomiques ;
2. La science n’a commencé à progresser que lorsque, et dans la mesure où, elle a systématiquement refusé toute explication autre que causale (principe d’objectivité) ;
3. Quoique téléonomiques, les phénomènes vivants se conforment toujours aux lois de la physique telles que les découvre la méthode objective, causale, exclusive de toute finalité.
La conclusion que Monod tire de ces trois constatations est donc la suivante : on peut sans aucun inconvénient constater le caractère téléonomique de la vie, puisqu’il ne sert à rien, puisqu’en dépit de lui l’explication causale suffit finalement toujours en biologie.
Ce caractère téléonomique est donc un mystère, un miracle ? « Non, répond-il. La véritable question se trouve à un niveau autre, et plus profond, que celui des lois physiques ; c’est de notre entendement, de l’intuition du phénomène qu’il s’agit. Il n’y a pas en vérité de paradoxe ou de miracle, mais une flagrante contradiction épistémologique. » (Le Hasard et la Nécessité, p. 32.)
Seul dans l’immensité indifférente
En d’autres termes, le problème posé par la stupéfiante finalité de la vie n’est pas un problème réel. Il n’existe que dans la relation de notre pensée au monde, vivant ou non. La vie toute entière s’explique peu à peu sans aucune référence à sa finalité à mesure que notre connaissance objective progresse. Tous les êtres vivants, avec leurs organes et leurs comportements, sont le produit d’une évolution dont « on peut dire aujourd’hui que les mécanismes élémentaires sont non seulement compris en principe, mais identifiés avec précision » (p. 156). Ces mécanismes élémentaires sont ceux de la chimie (donc de la physique quantique) agissant au hasard. En jouant éternellement avec les lois de la physique, le hasard crée des structures. Les lois de la physique multiplient ces structures en les diversifiant au hasard, et la nécessité les sélectionne conformément au schéma néo-darwinien. « Pour l’essentiel, le problème est résolu, et l’évolution ne figure plus aux frontières de la connaissance » (p. 156).
Qu’y a-t-il alors, à ces « frontières » ? Deux questions seulement : celle de l’origine de la vie et celle de l’émergence de l’homme, deux phénomènes dont Monod admet sans aucune gêne que la probabilité de leur apparition a pu être quasiment nulle. Mais qu’importe cette infinie improbabilité ? demande-t-il. « La probabilité a priori que se produise un événement particulier parmi tous les événements possibles dans l’univers est voisine de zéro. Cependant l’Univers existe : il faut donc bien que des événements particuliers s’y produisent, dont la probabilité (avant l’événement) était infime… l’Univers n’était pas gros de la vie, ni la biosphère de l’homme. Notre numéro est sorti au jeu de Monte-Carlo. Quoi d’étonnant à ce que, tel celui qui vient d’y gagner un milliard, nous éprouvions l’étrangeté de notre condition ? » (p. 161).
Et voici la conclusion, d’une stoïcienne grandeur : « L’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’univers d’où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. À lui de choisir entre le Royaume et les ténèbres. » 2
Oui, discuter au niveau scientifique
Un tel système se propose lui-même à deux niveaux de discussion : celui de la science, celui de la « philosophie naturelle ».
Mais, pensera sans doute plus d’un lecteur intimidé, comment discuter science avec ce prix Nobel ?
Quant à moi, je n’éprouve à cela nulle gêne, dès l’instant qu’il ne me faut, pour objecter, que savoir lire. Votre science, monsieur le professeur, m’inspire un immense respect, ainsi que votre caractère, votre fécondité intellectuelle, et pourquoi ne pas le dire aussi, cette façon si personnelle que vous avez de secouer les cocotiers, quitte à recevoir sur le nez, ce qui vous advint plus que de justice jusqu’à votre Nobel.
Mais pour ce qui est de savoir lire, mille excuses, vous n’avez fait depuis l’âge de sept ans aucun progrès, moi non plus, et nous sommes à égalité. Vous admettez du reste ce postulat, puisque vous écrivez des livres : sinon (si vous exigiez, pour être compris, que l’on fût aussi savant que vous) vous n’auriez, n’est-ce pas, que de rares occasions de vous exprimer, et vous devriez vous hâter de dénoncer comme un dangereux malentendu les quatre pages de garde que Paris-Match vous consacrait voici quelques mois.
Et si vous me rétorquez malicieusement que le résumé que j’ai fait de votre pensée montre que néanmoins, et en dépit de mes affirmations je ne sais réellement pas lire, je vous répondrai que ce n’est pas ma faute s’il n’existe, de votre thèse, aucun exposé tenant en trois pages dactylographiées. Einstein avait coutume de dire que l’intérêt d’une idée scientifique est en raison inverse du nombre de pages qu’elle exige pour l’exprimer, et qu’au-delà de quinze pages cela ne vaut probablement pas la peine d’être dit.
Mais admettons que mon résumé ne vaille rien. De toute façon il n’est là que pour donner une petite idée du livre et (je l’espère) l’envie de le lire. Ce n’est pas le résumé qui va être discuté, c’est le livre, auquel donc je renvoie.
Un premier fait frappe le lecteur ignorant et docile. C’est que, touchant la science même, vous tranchez au passage, en prenant parti dans un sens ou dans l’autre, une foule de querelles portant sur des points où les spécialistes sont partagés. Fait d’autant plus troublant pour le lecteur ignare que les querelles en question se développent souvent dans des spécialités qui ne sont pas la vôtre.
Page 41, vous réglez son compte au « vitalisme scientiste ». Trois physiciens en prennent pour leur grade : Niels Bohr, Elsasser, Polanyi (et à travers eux une foule d’autres que vous ne nommez pas). « Le moins que l’on puisse dire, écrivez-vous, c’est que l’argumentation de ces physiciens manque singulièrement de rigueur et de fermeté » C’est ma foi bien possible, et pour la fermeté je vous fais confiance. Mais la rigueur ? et en physique ? Étant ignare, je suis troublé de voir un biologiste donner des leçons aux physiciens sur des questions de physique. Car que disent ces physiciens ? Qu’ils ne trouvent pas, dans leur discipline, de quoi rendre compte des propriétés de la matière vivante. Vous leur rétorquez que vous, biologiste, connaissant mieux qu’eux lesdites propriétés, vous trouvez dans leur science tout ce qu’il faut pour vous satisfaire. Fermement retranché dans mon ignorance, je me dis quant à moi que vous avez peut-être raison, mais que pour en être sûr, j’aimerais bien entendre ces physiciens déclarer que vous avez mieux compris leur physique qu’ils n’ont, selon vous, compris votre biologie.
Et sur ce point, malheureusement, la docile lecture de votre livre ne fait que nourrir ma perplexité. Page 116, par exemple, vous dites ceci : « En physique moderne… l’un des postulats les plus fondamentaux est l’identité absolue de deux atomes se trouvant au même état quantique. » Vous en déduisez « la valeur de représentation absolue, non perfectible, accordée aux symétries atomiques et moléculaires en théorie quantique ». Et vous ajoutez : « Il semble donc qu’on ne puisse aujourd’hui restreindre le principe d’identité au statut de simple règle pour la conduite de l’esprit : il faut admettre qu’à l’échelle quantique au moins il exprime une réalité substantielle. » Voilà du Monod tout pur : excitant, stimulant… et aventuré. Vive l’imprudence, bien sûr, et soyez remercié de préférer toujours avancer imprudemment plutôt que de vous taire dans votre coin. Cela autorise et même commande la discussion, cette accoucheuse.
Passons donc, d’abord, sur le subtil glissement du « il semble » au « il faut admettre ». C’est conventionnellement, et parce que jusqu’ici on n’a pas eu besoin d’autre chose, que l’on décide de ne tenir compte, en chimie ordinaire (celle dont vous exposez la rationalité cybernétique), que de l’état de l’électron. Il semble, dans les limites de l’investigation chimique actuelle, que l’électron seul intervient en effet. Mais même en serait-il ainsi que :
1. Un électron est encore plein de mystères pour les physiciens ;
2. L’électron lui-même n’est que conventionnellement, et dans la mesure où l’on décide qu’il n’est pas utile d’y regarder de trop près, indépendant de l’état du noyau, cette bouteille à l’encre, ce casse-tête chinois. Et dans un cas particulier au moins l’électron doit suivre bon gré mal gré une évolution cataclysmique du noyau où le principe d’identité en prend, si l’on me passe cette vulgarité, pour son compte : c’est la radioactivité.
Le biologiste et la physique
Mais allons au-delà de ces détails. Voici un biologiste qui démonte sous nos yeux les mécanismes fondamentaux de la vie et qui aboutit (nous dit-il) à un « appareil entièrement logique, merveilleusement rationnel » (p. 32), ajoutant, nous l’avons vu, que « pour l’essentiel le problème est résolu ».
On nous permettra d’admirer sa sérénité, sachant comme il nous l’explique, que son système repose sur la physique, c’est-à-dire une énorme poudrière où tout un monde de conspirateurs se bouscule avec des torches plein les mains.
Voilà plus d’un demi-siècle que l’on cherche vainement comment coudre ensemble relativité et quanta, interactions faibles et fortes, dynamique des particules et macro-physique. Des milliers de grands esprits se sont usés à cette tâche, explorant en vain les directions les plus vraisemblables, puis, à mesure que celles-ci finissaient en échec, d’autres moins vraisemblables, et maintenant, en 1971, se risquant avec une audace croissante à des hypothèses auprès desquelles les divagations les plus échevelées de la science-fiction font figure de contes de bonne femme 3. En ce moment même, le Tout-Paris des physiciens s’interroge sur certaines expériences qui obligeraient à reconsidérer l’effet photo-électrique (ce même effet qui valut à Einstein son prix Nobel !) et qui effaceraient de la collection des « certitudes acquises » tout un troupeau de vaches sacrées de la physique. Comment un biologiste peut-il être si sûr de la simplicité des choses dont il parle, sachant qu’elles reposent sur une physique dont la formidable efficacité nous cache l’incohérence foncière ? Compte tenu de l’échec de toutes les tentatives faites jusqu’ici pour dominer cette incohérence, aucun physicien ne doute plus que le succès ne viendra qu’au prix d’un bouleversement fondamental (a).
Quand Jacques Monod (p. 156) nous dit que l’énigme de la vie est résolue pour l’essentiel et qu’il ne subsiste guère que deux problèmes
4, il nous rappelle quelque chose : la fameuse bévue de Lord Kelvin déclarant vers la fin de sa vie que « la physique lui paraissait un ensemble parfaitement harmonieux et, pour l’essentiel, achevé, et qu’il ne voyait à l’horizon que deux petits nuages noirs, le résultat négatif de l’expérience de Michelson et la « catastrophe ultra-violette » de la loi de Rayleigh-Jeans, c’est-à-dire le problème du corps noir. Comme on le sait, du premier de ces « petits nuages noirs » devait sortir la relativité et du deuxième, les quanta, c’est-à-dire les deux théories qui rasèrent au sol quelques années plus tard, l’« ensemble harmonieux » de Lord Kelvin.
Il n’y a pas deux petits nuages noirs, mais une vraie tempête à l’horizon de la physique actuelle. C’est sur cette tempête, monsieur, que vous êtes assis, et je vous souhaite bien du plaisir.
On objectera peut-être ici que, tempête ou pas, aucune révolution ne saurait mettre en danger un système qui ne demande à la physique que son principe d’objectivité, c’est-à-dire l’exclusion systématique, « austère » dit Monod, de tout recours à l’idée de fin, de but.
Mais c’est que, justement, les physiciens ne savent plus très bien où ils en sont avec ce fameux principe. Comme nous le disait l’un d’entre eux, Monod appuie son système sur une physique qu’ils ont depuis longtemps rejetée 5.
On pourrait multiplier les exemples. La démarche de Monod, quand il va au-delà de la vulgarisation, consiste à trancher hardiment parmi les innombrables incertitudes de la science contemporaine. Et certes, il faudra bien trancher un jour. Mais Monod anticipe par voie démonstrative sur le verdict de l’expérience, le seul que la science reconnaisse. Il anticipe systématiquement, dans un certain sens, toujours le même, celui au terme duquel il croit trouver ce qu’il cherche, à savoir une interprétation matérialiste de l’univers et de l’homme.
Je crois légitime d’appliquer à sa démarche la belle idée de téléonomie dont il a enrichi le vocabulaire philosophique : d’une part, certes, il démontre, mais d’autre part, sa démonstration « réalise un projet ». C’est du matérialisme téléonomique !
C’est pourquoi, dans le simple cadre de la science, on peut discuter indéfiniment les thèses de Monod, et à chacune de ses démonstrations opposer une démonstration contraire signée d’un nom aussi respectable que le sien. Au moment où paraissait en France le Hasard et la Nécessité, Sir John Eccles publiait à New York son propre essai de « philosophie naturelle », aboutissant à des conclusions contraires à peu près sur tout. Sir John Eccles, l’un des plus grands neurophysiologistes vivants, est, lui, spiritualiste, et trouve dans sa science d’éloquentes raisons de l’être (b).
Étant admis, donc, que Monod comme Eccles ont le droit de spéculer, faisons, nous aussi une hypothèse. Supposons que l’anticipation de Monod soit la bonne et que sa locomotive soit sur les bons rails. Accordons-lui tout ce qu’il nous demande, à savoir que finalement tout dans l’Univers, y compris l’origine de la vie, y compris l’homme et sa conscience, que tout enfin vienne un jour à être expliqué par le simple jeu du hasard et de la nécessité. Qu’est-ce donc que cela prouvera ?
Le petit machin originel
Imaginons cela, si nous pouvons. Au fondement, à la source de toutes choses, un élément infiniment simple, monade ou particule. Cet élément infiniment multiplié dans le temps et l’espace est livré aux lois aveugles de la nécessité et du hasard. Passons sur quelques difficultés philosophiques : jusqu’ici, il ne s’agit que d’une spéculation, disons une rêverie. Supposons qu’à la limite, nous puissions de la connaissance totale de cet élément simple, déduire l’univers et nous-mêmes, tels que nous nous vivons et percevons.
Sauf erreur, il ne restera plus à ce moment-là qu’un petit problème à résoudre : celui de savoir s’il y a lieu ou non d’admirer que le petit machin originel, monade ou particule, n’ait besoin de rien d’autre que des stupides lois du hasard et d’un peu de temps pour faire un Jacques Monod.
Le hasard et la nécessité m’ont sûrement fait congénitalement idiot, car plus j’examine l’hypothétique petit machin et plus je trouve miraculeuse sa stupéfiante fécondité.
Épistémologique tant que vous voudrez, mais cette téléonomie intégralement coextensive à la causalité, moi, monsieur le professeur, ça m’épate, sauf votre respect. Et voilà qu’en rêvant au triomphe final de votre idée, un mot de saint Augustin me revient en mémoire : « C’est l’ordre qui est miracle » et que je sens mes genoux fléchir. Oh ! ce n’est plus de la science, d’accord, puisqu’alors la science sera par hypothèse achevée. Mais sur quoi achevée ? Sur la définition du petit machin originel qui, ou bien aurait pu être n’importe quoi d’autre et ne jamais enfanter rien même au prix de l’éternité, ou bien était nécessairement tel qu’un jour Jacques Monod le découvre, et le définisse! Et dans les deux cas, sincèrement, et pardonnez-moi cette faiblesse, moi ça m’épate, et j’ai envie que quelqu’un m’explique.
Ces deux cas, d’ailleurs, les faits nous autorisent-ils à les envisager ainsi ? Laissons là pour conclure toute spéculation, toute anticipation sur nos futures découvertes et voyons simplement ce qui s’est passé sur la Terre.
La vie, produit d’un hasard « presque » infiniment improbable ? Je vous admire de croire à des improbabilités qui se réalisent progressivement, patiemment, avec une telle automaticité que l’on peut la définir par l’équation exponentielle de Cayeux-Meyer 6 .
Il est vrai que nous ne pouvons concevoir comment cela a commencé. Nous ne pouvons le concevoir maintenant, à l’aune de ce que nous savons. Mais je préfère douter de ma science, et même de la vôtre, plutôt que de ce que je vois.
Et ce que je vois, c’est que la vie est apparue sur notre planète dès qu’elle y fut possible. Pourquoi le gros lot eût-il été si pressé de sortir s’il n’avait été le produit d’une loi ? Du reste, il suffit de constater que la vie est apparue une fois pour être contraint de convenir qu’elle est possible et donc qu’un univers dont vous postulez l’éternité est bien, quoi que vous disiez, « gros de la vie ».
Quant à l’apparition de l’homme, ce serait un bien singulier hasard que celui-là, qui se produisit tant de fois en si peu de temps, puisque selon les paléontologistes, la plupart des débris d’hominidés fossiles actuellement connus n’appartiennent pas à notre phylum !
Quand le cavalier change de monture
Que voyons-nous donc en définitive ? D’un côté, de séduisantes théories fondées sur les provisoires lacunes de nos connaissances 7 et tendant à prouver que « l’homme est seul dans l’immensité indifférente de l’Univers d’où il a émergé par hasard ». Parce que nous ne comprenons encore ni comment la vie est apparue, ni comment l’homme en est sorti, on nous somme de croire à deux miracles baptisés improbabilités, et par conséquent à la vertigineuse absurdité de notre présence dans ce monde.
Et d’un autre côté des faits bien solides, même s’ils restent inexpliqués et tendent à nous convaincre du contraire, à savoir que la vie est apparue sur la Terre dès qu’elle put s’y développer, et que l’hominisation fut une vraie cohue des hominidés de toutes sortes se bousculant un peu partout sur Terre au cours des derniers millions d’années jusqu’au triomphe de l’Homo sapiens.
Faut-il de là, tirer une « philosophie naturelle » ?
Monod nous y invite et propose cette idée admirable et augustinienne que la finalité de la vie s’explique entièrement par le jeu des lois causales, le miracle par l’ordre. Mais pour aboutir à sa conclusion matérialiste, il doit désenfourcher en route sa monture, qui le conduirait à admettre la téléonomie, non plus seulement de la vie, mais de l’Univers tout entier, lui aussi attaché comme la vie, à la réalisation d’un projet. C’est que, pour être matérialiste, il faut un peu de causalité, mais pas trop !
Assez pour montrer que la vie est une mécanique, mais assez peu pour qu’on puisse croire cette mécanique aveugle. Assez pour pouvoir invoquer à point le hasard et la nécessité, mais assez peu pour pouvoir les congédier aussitôt qu’ils deviennent gênants (cf. p. 160, l’étrange probabilité « quasi » nulle).
Le livre de Monod marquera certainement une date importante dans l’histoire du matérialisme, dont il illustre les contradictions. Un autre grand biologiste avait déjà parcouru ce chemin il y a vingt ans : c’est J.-B.-S. Haldane 8. Lui aussi était matérialiste. Lui aussi ne croyait qu’au hasard et à la nécessité. Il suivit sa logique jusqu’au bout. Un jour, alors qu’il était au sommet de sa célébrité, il plia bagages et quitta l’Angleterre pour l’Inde, déclarant : « Je suis matérialiste, donc je crois à la vie éternelle », où même, selon d’autres : « Je suis matérialiste, donc je crois en Dieu ». Le chemin de Damas, cette fois, s’appelait route des Indes.
Jacques Monod trouvera-t-il son chemin de Damas ? Il faudrait qu’il suive lui aussi jusqu’au bout sa logique, qui conduit à montrer une finalité de l’univers dans sa totalité.
Mais il est plus facile de changer de logique en route, dès qu’elle devient gênante.
Aimé MICHEL
(a) Andrade e Silva et Lochak : Quanta, grains et champs, (Hachette 1969). Ce livre de deux jeunes physiciens de l’Institut Henri-Poincaré illustre le développement ci-dessus. Encore n’aborde-t-il aucun problème sub-quantique ; voir notamment page 14.
(b) John Eccles : Facing Reality (Springer Verlag, 1970).
9
— –
Les notes de (1) à (9) sont de Jean-Pierre Rospars
— –
Rappel :
Entre 1970 et sa mort en 1992, Aimé Michel a donné à France Catholique plus de 500 chroniques. Réunies par le neurobiologiste Jean-Pierre Rospars, elles dessinent une image de la trajectoire d’un philosophe dont la pensée reste à découvrir. Paraît en même temps, une correspondance échangée entre 1978 et 1990 entre Aimé Michel et le sociologue de la parapsychologie Bertrand Méheust. On y voit qu’Aimé Michel a été beaucoup plus que le « prophète des ovnis » très à la mode fut un temps : sa vision du monde à contre-courant n’est ni un système, ni un prêt-à-penser, mais un questionnement dont la première vertu est de faire circuler de l’air dans l’espace confiné où nous enferme notre propre petitesse. Empli d’espérance sans ignorer la férocité du monde, Aimé Michel annonce certains des grands thèmes de réflexion d’aujourd’hui et préfigure ceux de demain.
Aimé Michel, La clarté au cœur du labyrinthe. Chroniques sur la science et la religion publiées dans France Catholique 1970-1992. Textes choisis, présentés et annotés par Jean-Pierre Rospars. Préface de Olivier Costa de Beauregard. Postface de Robert Masson. Éditions Aldane, 783 p., 35 € (franco de port).
Aimé Michel, L’apocalypse molle. Correspondance adressée à Bertrand Méheust de 1978 à 1990, précédée du Veilleur d’Ar Men par Bertrand Méheust. Préface de Jacques Vallée. Postfaces de Geneviève Beduneau et Marie-Thérèse de Brosses. Éditions Aldane, 376 p., 27 € (franco de port).
À payer par chèque à l’ordre des Éditions Aldane,
case postale 100, CH-1216 Cointrin, Suisse.
Fax +41 22 345 41 24, info@aldane.com.
Pour aller plus loin :
- Chronique n° 33 parue initialement dans F.C. – N° 1273 – 7 mai 1971. Extraite du chapitre 4 « Evolution biologique » de La clarté au cœur du labyrinthe, pp. 116-123. Dans F.C. l’article est illustré de plusieurs photographies : Jacques Monod au tableau noir ; « Lord Rayleight (1842-1919). La “catastrophe ultravioletteˮ » ; « A. Michelson (1852-1931). Premier prix Nobel américain (1907) » ; « Niels Bohr (1885-1962). Qui manque de rigueur ? » ; « J.B.S. Haldane (1892-1964) à la pêche. Du matérialisme à la vie éternelle. » ; « Sir John Eccles en 1967. Des raisons d’être spiritualiste. ». Le dernier portait est dépourvu de légende. L’article d’Aimé Michel fait partie d’un dossier intitulé Jacques Monod ou les contradictions du matérialisme introduit par ces mots : « Le livre de Jacques Monod “Le Hasard et la Nécessité, essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderneˮ, fait resurgir le vieux matérialisme de Démocrite. Dans ce document, Aimé Michel conteste ces thèses du point de vue scientifique, et Claude Tresmontant du point de vue philosophique. » Je reviendrai la semaine prochaine sur la critique de Tresmontant.
- C’est la dernière phrase du livre, p. 195. Elle commence ainsi « L’ancienne alliance est rompue: l’homme sait enfin… ».
- La tendance ne s’est pas ralentie. Le lecteur qui en douterait peut consulter le livre de David Deutsch, professeur de physique à Oxford, promoteur de l’ordinateur quantique : L’étoffe de la réalité (Cassini, 2003 ; trad. de Françoise Balibar) ; avec les réserves que suscitent l’interprétation dite des Mondes multiples, à laquelle se rallie cet auteur, « plus fantastique que la difficulté qu’elle veut résoudre » (Aimé Michel, chronique n° 419 Une idée nouvelle : la providence…, in La clarté, p. 104). Pourtant le problème central de « coudre ensemble relativité et quanta » n’est toujours pas résolu (voir la chronique n° 13 La physique en panne, parue ici le 12 octobre 2009, en particulier la note b).
- Les deux problèmes considérés comme non résolus par Jacques Monod sont « (…) l’origine des premiers systèmes vivants d’une part, et d’autre part le fonctionnement du système le plus intensément téléonomique qui ait jamais émergé, je veux dire le système nerveux central de l’homme. » Ceci reste vrai aujourd’hui, quarante après que ces lignes aient été écrites.
- On pourra trouver confirmation de cette affirmation dans Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la science (Gallimard, 1979) dont le titre fait écho à la dernière phrase du livre de Monod (voir note 2). Les auteurs écrivent « (…) Lorsqu’il énonça cette conclusion, Monod donnait voix non seulement à une interprétation possible de certains résultats de la biologie moderne, mais aussi à celle d’un ensemble théorique bien plus vaste, que nous appellerons la science “classique”, et que cette science n’a cessé, au cours de trois siècles d’existence, de conclure que l’homme est un étranger dans le monde qu’elle décrit. (…) [U]ne science classique dont les réussites ont pu se donner comme tragiques et dont nous disons qu’elle n’est plus aujourd’hui notre science. » (p. 10). Ilya Prigogine a reçu le prix Nobel de chimie en 1977.
- Cette loi d’accélération, sur laquelle Aimé Michel revient souvent, est une propriété importante, mais le plus souvent passée sous silence, des processus évolutifs observés en biologie et dans le domaine culturel. Elle a été étudiée par André Cailleux (voir par exemple Géologie générale. Terre, Lune, planètes, Masson, Paris et Fides, Montréal, 1976, chap. 8 et 13), François Meyer (Problématique de l’Évolution, PUF, Paris, 1954. et La surchauffe de la croissance. Essai sur la dynamique de l’évolution, Fayard, 1974) et Max Pettersson (Complexity and Evolution, Cambridge University Press, 1996, chap. 10 et 11). Des idées semblables ont été proposées récemment par Jean Chaline, Laurent Nottale et Pierre Grou (L’arbre de la vie a-t-il une structure fractale ? C. R. Acad. Sci. Paris, série IIa, 328: 717-726, 1999, article discuté par Eric Buffetaut., id. 329 : 847-848 et réponse de Chaline et al., id. 329: 849-85). Voir aussi Jean Chaline : Les horloges du vivant : Un nouveau stade de la théorie de l’évolution, Hachette, Paris, 2000, ainsi que Jean Chaline, Laurent Nottale et Pierre Grou : Des fleurs pour Schrödinger, La relativité d’échelle et ses applications, Editions Ellipses, Paris, 2009.
- Aimé Michel retourne ici plaisamment l’argument du Dieu bouche-trou (« God of the gaps ») que les matérialistes opposent, souvent avec raison, à ceux qui pensent que l’action de Dieu s’exerce dans ces lacunes de nos connaissances. Sur cette médiocre conception de Dieu, voir La clarté, note 885, p. 701.
- J.B.S. (Jack) Haldane (1892-1964), issu d’une famille aristocratique écossaise, est un des fondateurs de la génétique des populations. Militant marxiste dans sa jeunesse, il est membre du Parti communiste de 1942 à 1950. Ses livres de vulgarisation (dont Daedalus or Science and the Future, 1923) et ses bons mots (Que peut-on inférer de l’esprit de Dieu d’après sa création ? Réponse : « Un amour immodéré des cafards ») le rendent célèbre. Il est ami d’Aldous Huxley et adversaire de C.S. Lewis. Ce dernier s’inspire de lui pour créer le personnage de Weston dans sa trilogie interplanétaire (voir dans La Clarté, la note 511 de la chronique La quarantaine des dieux, p.452, chapitre 17). Haldane critique la trilogie dans un article sarcastique. Lewis répond que ce n’est pas la science et les savants qu’il attaque mais le scientisme et l’idée que le but suprême de notre espèce est de se perpétuer même au prix du bonheur et de la liberté (A Reply to Professor Haldane dans W. Hooper : On This and Other Worlds, Fount paperback, 1982).
- Ce livre d’Eccles n’a pas été traduit en français.