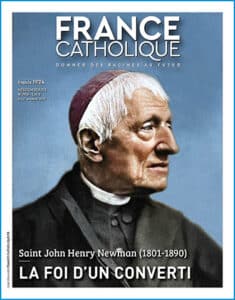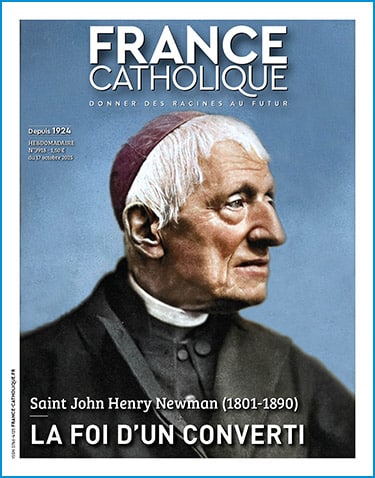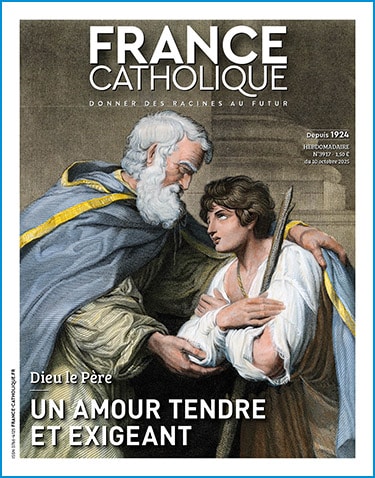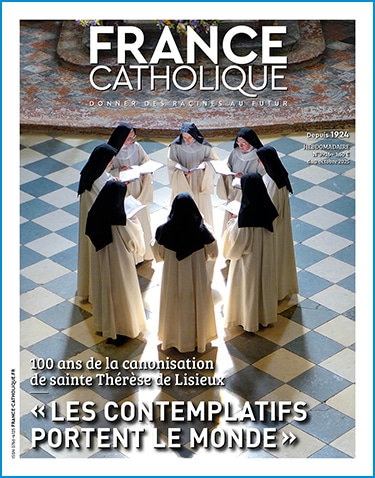Nombre de nos contemporains ne font d’ailleurs plus de différence entre les deux concepts : l’un et l’autre aujourd’hui sont perçus comme le bien ou l’intérêt du corps social, devant lequel chacun doit s’effacer. Pourtant ces deux concepts recouvrent des réalités distinctes et servent d’appui à des comportements différents.
En adoptant la fiction du « contrat social » comme fondement de notre vie en société, nous avons été amenés à remiser le bien commun dans un placard ; à lui substituer l’intérêt général, entendu comme intérêt du corps social entier, susceptible de s’opposer aux intérêts individuels. Il n’est plus désormais question de bien, mais d’intérêt, celui de chacun et celui du tout, que l’État détermine. Nous avons été amenés à accepter que l’intérêt général, substitué au bien commun, ne puisse avoir d’autre contenu que celui défini par les détenteurs du pouvoir de l’État, à travers la loi, censée exprimer la volonté générale – et au risque, si les représentants de l’État le jugent bon, de laisser se perpétrer des atteintes aux droits de la personne.
Aucune limite aujourd’hui n’est fixée aux représentants de l’État, éphémères silhouettes portées par des minorités – et placées sous l’influence des plus puissants groupes de pression – lorsqu’ils s’emploient à définir le contenu de l’intérêt général et à l’imposer au corps social entier.
Il en résulte que beaucoup de dirigeants d’entreprise pensent pouvoir s’acquitter de leur responsabilité à l’égard de l’intérêt général – qu’ils assimilent à l’ultime bien du corps social – en se contentant de respecter formellement les réglementations édictées par l’État, réputé seul en charge de ce bien du corps social. Ainsi, tout ce qui n’est pas interdit est permis, et tout ce qui n’est pas surveillé est possible. Telle est la norme qui semble présider à la production des biens et des services.
De leur côté, les maîtres de l’État propagent une conception de l’intérêt général qui, d’une part, se fait le relais des idées libérales d’Adam Smith et de Bernard Mandeville. Et qui, d’autre part, s’efforce d’en corriger les effets pervers, en promouvant l’extension sans fin de l’État-providence et en compilant des réglementations. Ils nous invitent à considérer que l’intérêt général n’est formé que de la somme des intérêts individuels et correspond, peu ou prou, à la somme des profits maximisés. Ils laissent se développer une course à l’obtention d’un profit maximal, qui se réalise à l’occasion d’une fourniture de biens et de services quelconques. C’est-à-dire dont l’utilité sociale peut être grande ou faible, voire nulle ou négative. Plutôt que d’encourager, dans le respect de la nécessité du profit, la création d’une richesse véritable, qui consiste en la fourniture de biens et de services répondant à une utilité sociale reconnue, à des besoins identifiés. Ils négligent que c’est dans les modalités même de la production et dans son résultat, que le bien du corps social doit commencer d’être servi, et non a posteriori, par le seul moyen de réparations, toujours insuffisantes. Quant à l’extension incontrôlée de l’État-providence, nous vérifions aujourd’hui qu’elle n’aboutit qu’à l’étouffement de l’économie de marché et à l’impotence de l’État.
Le concept de bien commun diffère de l’intérêt général. Il n’institue pas l’État unique promoteur du bien du corps social. Il appelle chaque personne, simple particulier, dirigeant d’entreprise ou responsable de l’État, à rechercher le bien du corps social en même temps que son bien propre. à se mobiliser pour ce bien du corps social sans se contenter d’un respect formel des règles édictées par l’État. En outre, il invite les dirigeants politiques à exercer la nécessaire autorité de l’État en faveur du bien du corps social, sans s’attribuer le privilège de définir, seuls, ce que sont les droits de la personne humaine. Mais en s’obligeant eux-mêmes à respecter ces droits.
Le concept de bien commun, tel que nous le recevons de la Grèce ancienne, de saint Thomas d’Aquin et de la pensée sociale chrétienne, repose sur le constat que l’homme est un « être en relation ». Ce qui signifie que chaque personne, pour accomplir son propre bien, est amenée à rechercher et inclure celui des autres, celui de ses enfants, de ses proches, de ses amis, celui du corps social entier dont elle est membre. Et que chaque responsable politique, en charge du bien du corps social, ne peut créer les conditions de réalisation de ce bien qu’en recherchant le bien de chaque personne, en préservant ses droits imprescriptibles. Notamment sa liberté de tendre vers le bien conformément à sa conscience, et de prendre des initiatives dans une application fidèle du principe de subsidiarité.
Le concept de bien commun rend inenvisageable qu’un dirigeant d’entreprise puisse se donner pour seul objectif un profit maximal. Au contraire, ce concept invite chaque membre de l’entreprise à exercer sa liberté, à rechercher lui-même de quelle façon il peut prendre en compte le bien de tous et de chacun, tant dans les modalités de la production que dans son résultat. Ce concept invite également les responsables de l’État à préserver ou à améliorer les conditions sociales favorisant le progrès de chacun et la recherche du bien de tous.
La référence à l’intérêt général ou au bien commun inspire ainsi des comportements contraires.
Prendre appui sur l’intérêt général conduit à attribuer aux dirigeants politiques la responsabilité du bien du corps social et à ne faire peser qu’indirectement cette responsabilité sur les dirigeants d’entreprise. Prendre appui sur l’intérêt général présente un autre inconvénient, celui de restreindre les moyens consacrés au bien du corps social aux seuls outils dont disposent les responsables politiques : la production d’une norme, le contrôle de son application et la coercition. Il en résulte que tous les moyens qui devraient être mobilisés en faveur du bien du corps social ne le sont pas. Et que les moyens proposés se traduisent trop souvent par un alourdissement de la réglementation, entravant l’initiative et pesant sur les coûts.
Prendre appui sur le bien commun ne conduit pas à contester la nécessité d’une régulation de l’économie de marché par les représentants de l’État. Mais conduit ces derniers à devoir améliorer leur régulation. Une coercition efficace – qu’à vouloir rendre toujours plus efficace, on finit par rendre attentatoire aux droits de la personne – ne suffit pas à faire prendre en compte par l’entreprise le bien de tous et le bien de chacun. La référence au bien commun a le mérite de rappeler aux représentants de l’État qu’il leur incombe de mettre en place des « conditions sociales » qui soient appropriées à la recherche du bien par chacun.
Au premier rang de ces « conditions sociales », ou « instruments », se trouve une entreprise dont les mécanismes internes permettraient à ses membres (actionnaires, salariés et dirigeants) d’exercer ensemble leur liberté d’initiative et leur liberté de conscience. Sans se limiter au respect formel des prescriptions fluctuantes émanant des dirigeants successifs de l’État. Les mécanismes de cette entreprise organiseraient la participation de ses membres à la définition de sa « raison d’être »1, à la sélection des aspects du bien commun qu’ils entendent privilégier.
C’est cette entreprise modernisée que nous proposons comme moyen pour sortir de la logique de maximisation des profits.
Cette entreprise pourrait continuer d’être abritée dans le moule de la société commerciale. Cependant son fonctionnement ne reposerait plus uniquement sur le pacte statutaire, institué à l’origine pour régir les relations des seuls actionnaires entre eux. Il reposerait également sur un second pacte qu’actionnaires et salariés auraient la faculté de conclure ensemble. Ce second pacte constituerait un contrat de gouvernance et d’action définissant des objectifs dédiés au bien commun.
Contrat de gouvernance, ce second pacte déterminerait l’influence respective des actionnaires et des salariés dans la composition des organes de direction et de contrôle. Il se prononcerait sur le mode de rémunération des dirigeants – celle-ci pourrait être liée à la réalisation des objectifs du pacte et ne pas dépasser un multiple de la plus faible. Un jour peut-être, il pourra se prononcer aussi sur une rémunération fixe attribuée au capital et sur le partage des bénéfices.
Programme d’action en vue du bien commun, ce second pacte aurait également vocation de rassembler les membres de l’entreprise dans le choix et la réalisation de ses objectifs : utilité sociale, modalités et qualité de la production, préservation de l’environnement naturel et humain, soutien local de l’emploi, organisation du travail et épanouissement des personnes…
Pour que l’attelage de ces deux pactes entre en piste, il faudrait encore instituer, à côté de l’assemblée des actionnaires, une assemblée des salariés.
Gouvernés ou gouvernants, devons-nous demeurer les jouets d’un intérêt général représentant la somme des intérêts des plus puissants lobbies ? Le bien commun pour être servi doit pouvoir être recherché par tous. Il a besoin de conditions sociales appropriées. D’institutions démocratiques qui ne soient pas de simples simulacres offerts à notre naïveté par les théoriciens de l’intérêt général. La démocratie restera un mirage, tant que ne pourront s’exprimer et se mobiliser, de leur propre initiative, les corps intermédiaires. Particulièrement ces communautés de personnes que forment les entreprises, du moins le plus grand nombre d’entre elles. Lorsque l’individu est seul devant l’État, les puissances d’argent sont seules à faire valoir leurs intérêts.
—
Olivier Pinot de Villechenon est avocat honoraire et essayiste. Dernier ouvrage paru : La société de capitalisme solidaire, instrument du bien commun, Paris, Les Presses universitaires de l’IPC, 2017.
Article extrait de la contribution de l’auteur à l’ouvrage collectif publié sous la direction de Michel Boyancé et Bernard Guéry : Le bien commun à la croisée des disciplines, Paris, Les Presses universitaires de l’IPC, 2018.