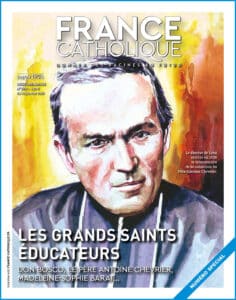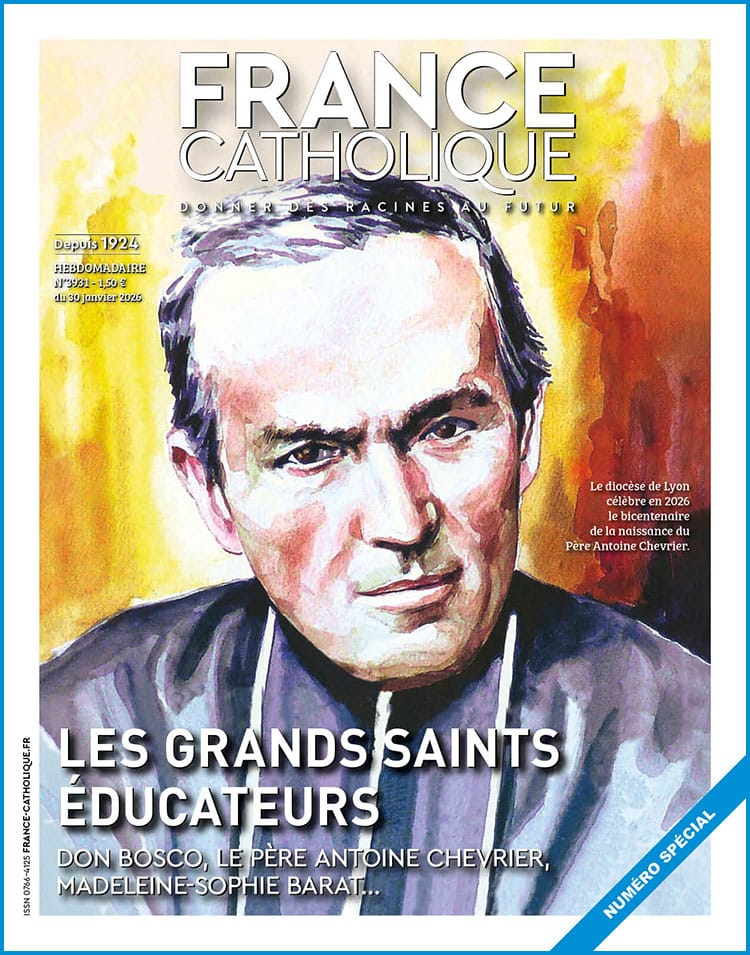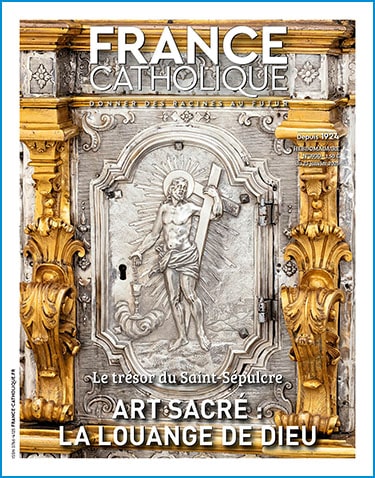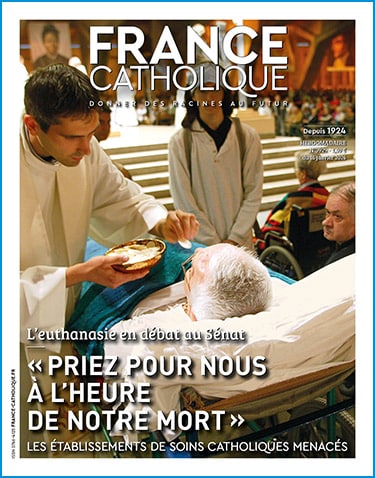25 MARS
Il y a trois jours, c’était donc le quarantième anniversaire du mouvement du 22 mars, qui depuis Nanterre, cette étrange université bâtie dans un terrain vague, aux abords d’un bidonville, allait allumer la mèche de l’embrasement de mai. Daniel Cohn-Bendit, avec sa personnalité singulière, donnerait à ce groupuscule la représentativité qu’il n’aurait peut-être pas acquise à lui seul. Il me faudrait confirmer mes intuitions avec des documents, des analyses que je n’ai pas sous la main. Mais on peut reconnaître une originalité à ce mouvement, c’est sa moindre dépendance aux idéologies très typées qu’étaient le trotskisme et le maoïsme, pour ne pas parler du communisme. Ainsi est-il déjà sans doute, et annonce-t-il déjà le gauchisme, c’est-à-dire cette sensibilité qui s’épanouira en mai, et par la suite, et qui se distingue par son émancipation d’une certaine matrice idéologique dure, pour être suffisamment réceptive, disponible à l’air du temps.
Cela avait l’avantage de faciliter l’échange avec un type de militant qui n’avait pas forcément en tête un arsenal de concepts et de préjugés pour enserrer dans ses catégories a priori et ses condamnations toutes faites. Quelques souvenirs s’éveillent en moi de discussions avec ces mutants qui vous ouvraient un espace authentique de délibération pour parler vrai, et s’exprimer sans crainte. C’était assez rafraîchissant. Il y avait bien sûr l’envers de cette ouverture, une sorte d’anarchisme débridé qui s’étant émancipé de l’ordre social et de ses bienséances n’était pas forcément fondateur et créateur d’un imaginaire mordant sur le réel. J’ai lu des témoignages selon lesquels les jeunes filles ont assez vite fui cette militance décalée, car elles n’y trouvaient pas leur place dans la durée, avec la reconnaissance de leur féminité ou simplement même de leur personne faite pour aimer et s’offrant à être aimée au-delà de l’éphémère. Les garçons eux-mêmes ont fini par souffrir d’un étrange erratisme affectif.
Mais ces jeunes gens avaient cet avantage considérable d’être foncièrement antistaliniens, de vomir tout ce qui, de près ou de loin, s’apparentait au totalitarisme, et en premier lieu le parti communiste français. Le moment le plus symbolique de mai fut la mémorable rencontre de Cohn-Bendit et d’Aragon sur le boulevard Saint-Michel, le premier traitant le second de « vieille crapule stalinienne ». C’était la consommation d’une rupture que les militants de gauche de l’époque auraient eu beaucoup de mal à consommer.
On l’a un peu vite oublié. Le progressif déclin du parti communiste, qui s’accélérera à toute vitesse dans les années 80, commence alors. Contre toutes les apparences, car en 68 le Parti garde tous les attributs de la puissance. C’est la CGT qui garde encore toutes ses capacités de mobilisation. Mais la jeunesse intellectuelle, en désertant les structures du parti et en les désignant comme l’ennemi, préfigure le désamour futur des masses ouvrières. Sans compter que le dernier mouvement révolutionnaire du vingtième siècle signe la fin de la révolution. Comment voulez-vous que l’organisation politique, qui l’incarna si mythiquement, résiste à cette mutation décisive ? Je crois, avec le recul du temps, qu’on a été plutôt injuste avec Georges Marchais, le dernier grand dirigeant communiste, qui n’avait sans doute pas la stature d’un Maurice Thorez, mais possédait l’aura et l’étoffe d’un leader. Philippe Robrieux, le meilleur historien du communisme français avait raison de souligner les faiblesses du personnage, mais Thorez, dans les mêmes circonstances, n’aurait pas fait mieux.
27 mars
De tout cœur, je m’associe aux manifestations de l’année Bernanos, à l’occasion du soixantième anniversaire de la mort de l’écrivain. Dans le centre qui porte son nom à Saint-Louis d’Antin, toute une série de manifestations est programmée. J’y rencontrerai Jean Lacouture dans quinze jours pour reparler des grands cimetières sous la lune. Il y a dix ans déjà – Jean-Loup, le fils cadet de Bernanos était encore parmi nous – il y avait eu un colloque du cinquantenaire où Lacouture était venu parler du même livre, qui l’avait ébloui, ému, une nuit à la veille de la guerre. Je dirigeais une sorte de table ronde, placé entre la comtesse de Paris et lui-même. Geneviève de Gaulle était venue apporter son témoignage, vivant et drôle. Tout cela sous l’autorité efficace de l’ami Olivier Moulin-Roussel qui est toujours là, en bernanosien militant.
Mais il y a aussi du nouveau sur le terrain de l’édition. La famille Bernanos a décidé, en effet, de confier la réédition des œuvres de l’écrivain au Castor Astral qui est, je crois, un éditeur bordelais. C’était Plon, qui détenait jusqu’alors les droits, et qui s’était sans doute assoupi, après avoir pleinement joué son rôle du temps de l’ami Marcel Jullian. Je n’oublie pas que cela nous avait valu une prodigieuse préface de Malraux à Journal d’un curé de campagne ! Et voilà, avec le Castor Astral, une série de rééditions avec de nouveaux préfaciers tout à fait intéressants et pertinents. Michel del Castillo nous introduit ainsi aux Grands cimetières et Sébastien Lapaque à Sous le soleil de Satan. Je médite son texte court, nerveux, empathique, auquel j’adhère pleinement. Merveilleux livre, envoûtant, dont on se récite les premières lignes avec le sentiment que brusquement un monde se lève devant vous, un monde intérieur poignant, pathétique, désespéré même, mais où retentit l’appel du Salut sous la forme de l’héroïsme et de la sainteté. Sébastien Lapaque souligne avec raison cette tonalité qui domine l’œuvre jusqu’au bout. Le Soleil a-t-il des accents jansénistes ? Maritain, avant la publication du roman, avait froncé les sourcils et demandait quelques coupes, me semble-t-il. William Busch l’avait révélé dans les années 80. Il faudrait revoir cela de près. Mais est-ce bien le lieu de faire des procès en orthodoxie ? Je ne le pense pas. L’homme d’imagination ne nous fait pas un traité de théologie, il tente d’accéder, avec ses moyens à lui, au drame de l’humanité en proie aux entreprises de saccage intérieur. Il rend palpablement sensible la chaîne du combat. On parlera peut-être de défauts de jeunesse à propos du premier roman, où l’on discerne des accents romantiques, notamment avec la représentation de Satan. Je parlerais plutôt de défauts du génie, comme Dostoïevski en avait eu avant Bernanos, auquel il ressemble si fort.
Mounier parlait à juste titre du surnaturalisme de Bernanos. J’avais repris ce thème dans mon petit livre paru chez Edern-Hallier en 1982 et l’avais mis au contraire, en accord avec l’orthodoxie la plus profonde. L’extraordinaire mérite du romancier est de montrer que c’est le Salut qui se joue dans les plus humbles, ceux qu’on appelle les marginaux, et jusque dans les plus sordides aventures de la vie. La grâce est là au cœur du désespoir, parce que notre déréliction est tout autre chose qu’affres psychologiques ou folies à soigner. Tout est grâce, parce que dans la plus noire obscurité, il y a l’appel de l’amour. L’amour qui est dans les mains de Mouchette qui se noie.
Alors, bien sûr, le romancier pousse le tableau à l’extrême. Cela correspondait, d’ailleurs, à son intranquillité personnelle, à la source permanente d’angoisse qui était la sienne, et qui le faisait paradoxalement proche de cet Antonin Artaud le déclarant « son frère en désolante lucidité ». Ce n’est pas du tout surjoué, cela nous donnera aussi Dialogues des carmélites dont la pureté déchirante est très loin des exubérances du Soleil. Mais c’est la même requête au Ciel, sur une terre qui est travaillée par le mal et la mort.
Un point de désaccord pourtant avec l’ami Sébastien Lapaque : « Il a rarement bénéficié de l’approbation des curés – et cela ne s’est pas arrangé avec les fonctionnaires de Dieu spécialisés dans la pastorale sociale apparus après Vatican II. » C’est qu’il n’a pas connu la génération des prêtres de mon enfance, qui citaient couramment en chaire Bernanos, à l’égal d’un père de l’Église. Car le romancier avait bel et bien mordu sur un vaste public auquel il avait insufflé sa propre vision du monde et sa sensibilité surnaturaliste. Contrairement aux prévisions pessimistes de Daniel Halévy rappelées par Lapaque – « Vous aurez en France 500 lecteurs » – Le Soleil en eut 100 000 ! C’était le début de deux décennies de chefs-d’œuvre qui marquèrent à jamais de nombreux jeunes prêtres. En revanche, il est vrai que le décalage constaté, à travers la crise du christianisme à partir des années 60 d’avec la mystique curé d’Ars de Bernanos, correspond à un vrai désastre spirituel. Mais d’autres générations s’avancent qui vont redécouvrir, les yeux neufs, cet univers que rien n’a rendu obsolète. C’est le prétendu moderne qui a vieilli, et non le surnaturalisme du grand écrivain.
31 mars
Yves Bernanos me proposant de présenter un ouvrage de son grand-père, j’ai choisi Français si vous saviez, par ce qu’il correspond pour moi à un souvenir précis. Ce fut un de mes livres de référence en classe de terminale. Il figurait en évidence sur mon bureau, livré au regard de mes camarades et de mes professeurs, comme si grâce à lui j’annonçais la couleur. Pour moi, la référence c’était lui Georges Bernanos ! Et j’en avais bien besoin dans ce moment de la vie où il faut trouver son chemin, conquérir ses armes intellectuelles. Certes, celui-là n’était pas philosophe, mais il vaut mieux qu’un discours philosophique à développer, une vision du monde grâce à une lucidité profonde que je pourrais quasiment définir infaillible ! La découverte du monde de la pensée s’avérait redoutable. Serait-il possible de saisir ces grands systèmes en découvrant les œuvres difficilement pénétrables pour un néophyte ? Bien sûr, nous avons eu en ces années de remarquables initiateurs auxquels je garde ma reconnaissance émue. Mais pour me définir au sein des problèmes et des affrontements de ce début des années 60, j’avais besoin de cet interlocuteur direct et fraternel.
Français si vous saviez est un recueil qui rassemble les articles d’après-guerre de Bernanos et qui fait directement suite au Chemin de la Croix-des-âmes qui rassemble les articles de la guerre écrits au Brésil et dont parlera dans le même cadre Sébastien Lapaque. Le critique du Figaro Littéraire a écrit un précieux petit livre sur l’expérience brésilienne de l’écrivain, après avoir suivi ses traces à Barbassena et ailleurs, quelque soixante ans après… Il en a néanmoins recueilli des souvenirs auprès des derniers témoins et de leurs descendants. Mais si mon choix s’est porté sur la période suivante, la dernière, c’est que les ultimes combats de Bernanos avaient encore à voir avec les débats de ma sortie d’adolescence. En 1960, quatre ans après le soulèvement de Budapest, le communisme signifiait quelque chose ! Et son emprise était encore chez nous dominante. Ce n’est pas pour rien que Sartre allait publier sa critique de la raison dialectique dont mon professeur monsieur Verneaux admirait le titre sans approuver le contenu. Par ailleurs, la tentation progressiste en milieu catholique entraînait les esprits dans une direction imprécise. Certains s’enflammaient pour la lutte contre le colonialisme, mais qui pouvait dire sur le moment sur quoi déboucherait le tiers-monde émancipé et l’Algérie désertée par les français ? Rétrospectivement, ce qu’en a dit un Jean-Marie Domenach laisse singulièrement à penser sur certaines causes « généreuses » d’hier. Mais c’est le fond de l’interpellation de Bernanos aux progressistes d’après-guerre, qui s’est inscrit en moi définitivement et dont je persiste à croire qu’il est aussi pertinent aujourd’hui qu’alors. « Vous trouvez que le visage de l’Église repousse aujourd’hui plutôt qu’il n’attire, mais s’il repoussait précisément parce que nous nous détournons de lui, que nous n’osons pas le regarder en face, que notre foi et notre amour ne s’y reflètent plus ? Les masses s’éloignent de l’Église, je le vois bien. Mais l’Église a-t-elle besoin des masses, ou les masses besoin de l’Église ? Imbéciles ! Vous avez laissé se former une civilisation ennemie de l’homme, et vous comptez sur les fils de l’Homme pour vous aider à poursuivre cette expérience jusqu’au bout. »
Quand vous lisez cela à 18 ans et que vous avez le sentiment d’une lumière qui éclaire et qui brûle, vous en êtes marqué à vie. Et je n’ai pas aujourd’hui d’autre réponse à donner à ceux qui gémissent sur la déception du monde à l’égard de l’Église ou qui dissertent à perte de vue sur sa disqualification sociale, voire son étrangeté par rapport aux mentalités contemporaines. La belle affaire ! ce qui disqualifierait l’Église, ce serait précisément son alignement inconditionnel sur les préjugés et les moeurs du jour.
2 avril
Bernanos, encore. Ce qui semble, aujourd’hui, le plus incongru, c’est le refus résolu de l’auteur de Français si vous saviez à se dire démocrate et plus encore démocrate chrétien. C’est bien là le point extrême où l’indulgence lui sera refusée. Disons que pour la majorité et l’intelligentsia cela relève de l’incompréhensible. Comment peut-on être contre le mouvement même de l’affranchissement du monde et de l’épanouissement de l’État de droit ? Comment refuser le droit à la citoyenneté égale et à toutes les garanties de la justice ? À tout cela Bernanos eut répondu – mais il a répondu d’avance sans qu’il soit utile d’imaginer sa réponse : « Je ne suis pas anti-démocrate, je déplore au contraire, qu’après avoir signifié une conviction profonde, un état d’âme, une foi, le mot de démocrate ait pris peu à peu le sens de citoyen d’une démocratie, rien de plus, en sorte que nous sommes menacés de voir un jour – pas pour longtemps, hélas ! – des démocraties sans démocrates, des régimes libres sans hommes libres. » Tout est dit ! ce qui compte à ses yeux, c’est la liberté profonde, le véritable homme libre, qui peut être déconfit d’assoupissement en régime démocratique, selon un processus qu’avait parfaitement repéré Tocqueville.
Fort heureusement, il est possible aujourd’hui de laisser un peu respirer les concepts et d’examiner, par exemple, en quoi la démocratie est un régime qui correspond à l’évolution de notre société, en lui apportant des éléments de droit, de justice, de citoyenneté, sans être exempt en même temps d’abus, de déviations, parfois de tendances fâcheuses et ruineuses. Un Alain Finkielkraut s’est fait l’analyste particulièrement aigu de ces traits en prenant une « modération de la démocratie » lorsque celle-ci se laisse aller à la démagogie égalitaire, celle qui veut, par exemple, que les élèves soient mis sur un pied d’égalité avec les maîtres et plus généralement encore pour « préserver l’intégrité de la connaissance de soi et la saveur du monde humain ». Ces derniers mots ne lui appartiennent pas, puisque je les reprends de la bouche de Pierre Manent, lors d’une belle émission de France Culture où Finkielkraut avait invité le philosophe politique à parler avec Mona Ozouf de l’essai de cette dernière sur le romancier Henry James (La muse démocratique. Henry James ou les pouvoirs du roman. Calmann-Lévy, 1998).
C’est un vrai plaisir d’entendre trois personnes de cette qualité discuter librement des ambiguïtés de la société démocratique, sans qu’elles songent à atteindre ce qu’il y a d’incontestable dans l’exigence de la démocratie. Et la question se trouve posée à propos d’un remarquable observateur de la société à travers l’expression romanesque. « Existe-t-il, demande Alain Finkielkraut, une irréalité, une abstraction, un oubli démocratique de la complexité des choses, contre lesquelles le roman est notre ultime et fragile recours ? » Mona Ozouf donne sa réponse : « Je pense que cela demeure vrai, dans la mesure où la démocratie met au centre de tout l’égalité et l’universalité de l’individu. Or cette idée, qui a bien sûr ceci de très beau qu’elle permet à chacun de décider pour lui-même de ce qu’il veut être, est spontanément intolérable à un romancier. Un romancier en effet est amoureux des différences et des singularités. Par conséquent, la démocratie représente une menace pour la littérature romanesque : elle l’entrave. » Finkielkraut va plus loin encore en parlant de l’abstraction égalitaire qui menace « de jeter le voile de ces impeccables lieux communs sur la réalité même de l’être. Tout se passe donc comme si le roman devait constamment réparer l’oubli dans lequel la démocratie nous plonge ». Mona Ozouf et Pierre Manent, loin de le contredire, ajoutent d’autres arguments qui sont autant de critiques de la démocratie, d’abord sous le biais de la démocratisation des mœurs, où la passion de l’égalité occulte la réalité humaine et la transforme pour le pire. Cela est vrai des rapports homme-femme, comme des rapports interfamiliaux qui tendent à être arasés. Ce qui amène nos trois interlocuteurs à interroger le mot nature qui est aujourd’hui la cible de toutes les attaques, notamment celle des féministes. Mona Ozouf est pour conserver une perception de la nature et se refuse désormais à employer les guillemets à son propos. Pierre Manent s’insurge contre l’interdit un peu ridicule autour d’un terme qu’il ne trouve pas plus problématique que ceux de loi, d’humanité et de droit. Il ne s’agit pas de quelque chose d’objectif et d’inerte, mais de « quelque chose que l’homme ne peut pas changer, mais qui peut être en même temps quelque chose à travers quoi l’homme se réalise ». Et de renvoyer à Aristote et à ce domaine que « nous ne cessons de découvrir en nous efforçant de le réaliser, de le déployer ». Finkielkraut rappelle encore qu’à la fin de sa vie, Hannah Arendt avait voulu réfléchir aux invariants anthropologiques. Le livre qui en résulte s’appelle bel et bien La condition humaine (The Human Condition) et non, selon la traduction française, Condition de l’homme moderne (on retrouve le texte de cette émission dans un recueil aujourd’hui disponible dans la collection Folio sous le titre Ce que peut la littérature).
On trouverait chez un critique aussi éminent que George Steiner des remarques qui rejoignent exactement ces convictions. Steiner n’est pourtant pas un pourfendeur obtus d’une démocratie dont il dit qu’elle rend « un hommage inégalé aux espoirs de l’homme » et que « seul un imbécile refuserait de reconnaître cela ou d’y accorder une profonde valeur ». Mais il ajoute que « certaines contradictions entre démocratie et excellence dans la vie de l’esprit sont peut-être intrinsèques ». Il est du même avis que les trois sur l’évolution fatale du système scolaire. « L’égalitarisme peut réduire l’éducation de masse à une imposture. » Et il développe un véritable réquisitoire contre la civilisation de la consommation et de l’argent. Steiner pose bien le problème ultime : « l’intimité est l’obsession intellectuelle, voilà mes idées politiques. Elles reposent sur l’immémoriale injonction de Dante énoncée par la voix d’Ulysse : nous ne fûmes « pas faits pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance » partout où elles pourront nous mener, quel qu’en soit le prix personnel et social ». (George Steiner, Les livres que je n’ai pas écrit. Gallimard).