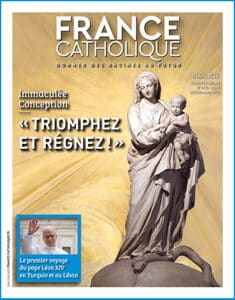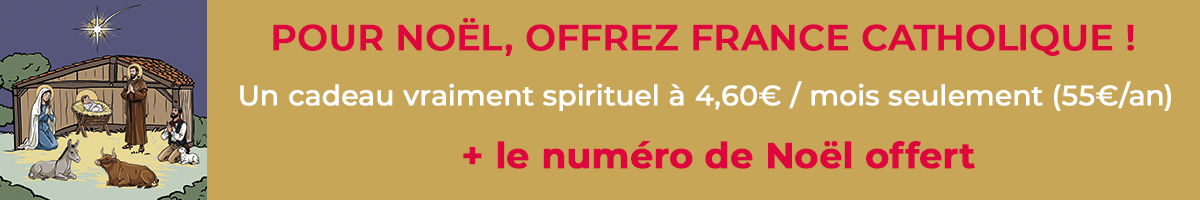Gérard Leclerc : Quelles étaient vos intentions en commençant ce nouveau travail ?
Marcel Gauchet : J’avais d’abord le désir d’aboutir à une conceptualisation rigoureuse de la démocratie. En général on se rabat sur des notions institutionnelles qui sont justes mais qui ne saisissent pas le phénomène dans son ensemble. Je conçois la démocratie comme le concept englobant de la modernité et j’essaie de comprendre en quoi la modernité et la démocratie ont partie liée.
Deuxième intention : la frustration croissante que j’ai ressentie devant ce qui tient lieu aujourd’hui de pensée sur la démocratie – celle de Tocqueville. Le point de vue tocquevillien a acquis une ’hégémonie d’évidence’ qui masque l’essentiel. J’aurais pu intituler mon livre : De la démocratie en Europe par opposition à De la démocratie en Amérique. Le voyage de Tocqueville aux États-Unis a permis de comprendre, en son temps, des aspects de la démocratie européenne. Mais pour comprendre la dynamique de la démocratie dans le monde d’aujourd’hui, il faut adopter une perspective longue, très longue, car le cadre européen permet de comprendre des choses que l’exemple américain ne donne pas à voir.
Troisième intention : approfondir mon diagnostic de la crise de la démocratie afin d’anticiper de manière plausible ce qui pourrait se passer lorsque nous sortirons de cette crise.
Peut-on présenter votre œuvre comme une philosophie de l’histoire ?
Non. Il s’agit d’une histoire de la philosophie du XXe siècle saisie dans la longue durée de la modernité européenne. Vous savez que j’ai essayé de caractériser notre modernité par la sortie de la religion ; je tente maintenant de préciser ce point en espérant parvenir à une conceptualisation générale du fait démocratique.
La sortie de la religion n’est pas l’arrachement à la croyance religieuse mais l’abandon de la manière d’être religieuse des sociétés. La révolution moderne qui se déroule depuis cinq siècles se définit par le basculement de cette structuration religieuse, hétéronome, dans un nouveau mode de structuration, autonome, des sociétés. Nous pouvons dégager les trois composantes de cette nouvelle structuration :
Premièrement, le Politique et plus précisément l’État-nation qui est le socle de l’autonomie. Cette forme politique n’est pas advenue une fois pour toutes entre 1500 et 1650 mais c’est au cours de cette période que sont posées les bases d’un processus qui se poursuit aujourd’hui. On ne cesse de dire que la nation est « dépassée » alors que le fonctionnement d’une société politique autonome suppose le socle de l’État-nation.
Deuxièmement, le Droit – pas le droit des juristes qui définit le légal à partir de quoi on peut trancher les litiges mais le droit fondamental qui définit le légitime : la pierre de touche du sentiment collectif quant à ce qui peut fonder un ordre, un pouvoir, une relation. Ce nouveau principe de droit, c’est le droit des individus.
Il y a deux systèmes de légitimité possibles, et deux seulement : ou bien une légitimité religieuse, transcendante, source extérieure et supérieure à l’humanité ; ou bien la légitimité qui tient au droit détenu par nature par les individus. Il n’y a pas de troisième solution. C’est ce droit naturel moderne qui s’invente entre 1650 et 1800 et qui acquiert aujourd’hui sa pleine efficacité.
Troisièmement, l’Histoire. Bien entendu, toutes les sociétés humaines sont historiques car elles ont cette propriété remarquable qu’elles ne peuvent pas ne pas changer. Mais quelque chose de nouveau advient entre 1750 et 1850 : le passage à une société qui ne se contente pas de changer mais qui s’organise pour changer, qui se déploie en vue de sa propre production dans le temps, qui bascule du passé de la tradition (qui définissait le temps, légitime par excellence) vers l’avenir de l’autoconstitution de la communauté humaine. Ce qui donne sens à la modernité économique, qui est ainsi rattachée à ses sources culturelles et politiques cachées derrière le règne apparent de la nécessité.
On voit donc que l’autonomie des modernes, ce n’est pas seulement se donner sa propre loi, c’est se produire soi-même au travers du changement.
Quelles conséquences tirer de cet inventaire des composantes de la modernité ?
La première conséquence, c’est le caractère problématique de cette modernité autonome. Les trois composantes que je décris matérialisent la liberté collective ; mais en même temps elles représentent une menace de dissociation de la collectivité.
L’État-nation qui permet l’autogouvernement menace d’une oppression sans mesure la communauté politique qu’il est supposé servir.
Le droit des individus crée les conditions de la liberté collective mais il porte le danger d’empêcher la constitution d’une collectivité.
Quant à l’Histoire, il est vrai que nous nous faisons à travers elle, mais nous sommes devant un processus qui nous échappe. La nature de l’Histoire est de mettre la collectivité humaine qui se produit à travers elle dans le risque de ne pas savoir ce qu’elle fait d’elle-même. Autrement dit, l’autonomie n’est pas la voie facile vers une réconciliation générale : elle est la condition la plus problématique qui soit puisqu’elle pose la question de la maîtrise des moyens de l’autonomie. Ce qui rend libre l’humanité est ce qui la menace le plus… quant à sa liberté.
Selon cette réflexion, comment définissez-vous la démocratie ?
La démocratie peut être définie comme la mise en forme politique des moyens de l’autonomie. Ce régime ne va pas de soi ! D’autant plus que l’autonomie présente plusieurs aspects. La démocratie des modernes va devoir réinventer le régime mixte : l’idéal politique des sociétés anciennes était de réaliser le mélange des trois formes pures de gouvernement – monarchie, aristocratie et démocratie. Cette formule mixte avait été écartée par les théoriciens de la refondation individualiste de l’ordre social qui faisait perdre son sens au fait collectif contenu dans les concepts de démocratie et d’aristocratie. Mais elle est réinventée avec de nouvelles composantes : la démocratie doit articuler le Politique, le Droit et l’Histoire.
L’accord entre ces trois éléments ne va nullement de soi !
En effet ! Chaque composante possède sa dynamique et se présente comme une solution en elle-même suffisante à la définition du collectif. Cela se vérifie à l’examen des trois grandes idéologies contemporaines qui inspirent les principales tendances : les conservateurs sont du côté du Politique et de l’ordre qu’il permet d’assurer ; les libéraux sont du côté du Droit ; les socialistes du côté de l’Histoire. Pourtant, la démocratie contemporaine suppose de combiner ces trois composantes : tel fut le problème fondamental du XXe siècle.
Ces trois composantes se sont présentées successivement, chacune sous la forme d’une hégémonie qui chassait la précédente. À l’âge classique, on ne voit que le Politique. Au XVIIIe siècle, l’âge du Droit chasse le précédent et on ne voit que lui. Puis, au XIXe siècle, l’âge de l’Histoire chasse le Politique et le Droit. Ainsi Marx affirme que le processus révolutionnaire aboutit à la destruction de l’État et du Droit.
Le problème constitutif du XXe siècle que j’analyse dans La crise du libéralisme, est le suivant : les composantes de la société autonome sont nécessaires toutes les trois et il faut essayer de les harmoniser. C’est le « choc 1900 » : la conviction du premier libéralisme, selon laquelle le point de vue de l’Histoire et la dynamique sociale suffisent à tout, est mise à mal par la découverte du retour du Politique. Non seulement il fait retour mais il s’impose de manière massive comme État de guerre dans le moment impérial et comme État social qui commence à s’affirmer. Il y a aussi retour de la logique pure du droit des individus qui est tout autre chose que le droit des transactions entre des acteurs historiques. La crise, c’est de ne pas savoir comment ajuster ces trois éléments. Et les totalitarismes peuvent être interprétés comme des tentatives de réinventer la forme de l’unité ancienne des sociétés avec des éléments de la modernité.
Dans ce Moment 1900, l’idée démocratique paraît triompher avec la généralisation du suffrage universel, mais on passe en même temps à l’ère des masses avec ses partis et ses syndicats. De fait, on ne sait pas faire fonctionner la démocratie dans la période 1900-1914 : nous avons le souvenir d’un âge d’or parce qu’il y a eu ensuite la première guerre mondiale mais Emmanuel Todd a montré que la Belle époque fut une période d’inquiétude – un « âge d’or de l’autodestruction » où les taux d’alcoolisme, de suicide, de folie crèvent tous les plafonds. On peut alors parler d’une première crise de croissance de la démocratie : toutes ses dimensions sont déployées, son principe l’emporte… mais on n’en a pas la formule. Dans les années trente, bien peu voyaient un avenir à la démocratie : les régimes « forts » semblaient l’emporter.
Le miracle du second XXe siècle, c’est que nos sociétés ont trouvé la formule du régime mixte de la démocratie des Modernes. 1945-1975 est le moment de la stabilisation des démocraties . On a su faire fonctionner ensemble : le Politique, réformé par l’État-Providence qui donne un contenu social à la nation et stabilisé par le dépassement du régime d’Assemblée ; le Droit qui prend au travers de l’État-Providence une épaisseur concrète comme droits réels des individus ; l’Histoire rendue maîtrisable par le développement d’un appareil de pilotage politique et administratif unique.
Tout cela se défait depuis 1975…
Oui, nous sommes devant une seconde crise de la démocratie. On ne voit que la destruction économique mais cela va beaucoup plus loin. Nous sommes encore portés par la dynamique des trois éléments que j’ai évoqués : le parachèvement de la forme politique État-nation, la relance de l’individualisation en droit et l’accentuation de l’orientation historique de nos sociétés. Dans les trois cas, il y a réouverture de tous les problèmes relatifs à ces différents éléments.
Le plus difficile à cerner, c’est l’effet paradoxal du parachèvement de l’État-nation : il fait basculer le Politique dans l’infrastructure, ce qui nous le rend invisible. Nous sommes dans des sociétés qui fonctionnent grâce au Politique – par exemple, les marchés n’existent que par leur cadre politique sous-jacent. C’est particulièrement vrai en Europe à cause de l’ancienneté du phénomène, mais il y a là une telle évidence qu’on n’y pense plus. Dans les États de création récente, le nationalisme est clairement affirmé alors que pour nous c’est du passé. En fait, ce n’est pas du passé : cela va de soi ! Soixante ans de paix ont fait que la contrainte collective que représentait la mobilisation pour la défense nationale a disparu de notre horizon intellectuel. Ce qui reste perçu dans la forme politique, c’est la Sécurité sociale. Du coup, nous sommes dans des sociétés qui se comportent comme si elles n’avaient pas besoin de forme politique.
Sur l’individualisme, je n’ai pas besoin de souligner ses manifestations sociales mais je veux insister sur sa racine juridique : la logique du droit des individus. C’est ce qui le rend intraitable : sa puissance est sans limite parce qu’il est porté par l’abstraction du droit qui ne s’arrête jamais.
Quant à l’orientation historique, mon propos peut paraître paradoxal parce que l’effet de cette accélération de l’activité sociale tournée vers l’avenir a fait disparaître l’avenir des représentations collectives. C’est parce que nous sommes dans des sociétés qui travaillent à tous les niveaux et de façon constante à se changer que l’horizon figurable a disparu.
Ce point mérite d’être explicité !
Quand l’individu est tout occupé à se changer lui-même, il n’y a pas d’avenir collectif possible. Il n’y a même pas d’avenir personnel pensable car il y a une sorte d’altérité du possible qui devient la seule manière de se représenter ce que sera demain.
Nous sommes devant une nouvelle crise du libéralisme mais ce n’est plus le même libéralisme et les éléments de cette crise sont profondément différents. Je ne veux surtout pas suggérer que cette seconde crise de croissance de la démocratie ressemble en quoi que ce soit à la précédente. Au contraire : cette seconde crise est aux antipodes de la première qui s’est manifestée par des mobilisations collectives en vue de la restauration d’un contrôle des sociétés sur elles-mêmes à n’importe quel prix. Le seul élément qui conserve une centralité fonctionnelle, ce sont les individus. Et en fait, cette situation pousse les individus à être toujours plus des individus et à se détourner par tous les moyens de l’engagement collectif. Nous sommes donc à l’abri des totalitarismes mais les effets de dissociation sont considérables.
Puisque Tocqueville ne nous donne pas les instruments de compréhension de l’histoire européenne, comment caractérisez-vous la dialectique Europe – États-Unis ?
Mon quatrième et dernier volume s’intitulera Le Nouveau monde et c’est là que j’essaie de donner une réponse à votre question. Pour résumer, le Nouveau monde, c’est bien sûr la mondialisation actuelle mais c’est aussi le moment de la rencontre forte, obligée, des Européens avec les États-Unis. Cette rencontre, capitale, se fait dans la dissymétrie : les Européens savent qu’ils ne peuvent pas demander aux Américains de les comprendre ; mais les Européens doivent essayer de comprendre les Américains pour intégrer ce qu’il y a d’essentiel dans leur expérience tout en restant eux-mêmes.
Aux États-Unis, Tocqueville voit la troisième dimension dont je vous parlais : l’orientation historique, le point de vue de la société, qui ont tant de peine à s’établir en Europe et qui triomphent outre-Atlantique. Mais ce qu’il ne discerne pas en Europe, sinon pour le passé périmé, c’est le rôle du Politique et du Droit : c’est-à-dire les questions qui vont ressurgir dans les années 1900.
Le Politique et le Droit sont présents dans l’histoire américaine !
Oui, mais d’une tout autre manière. Le Politique est présent sous la forme de la souveraineté des États-Unis qui est l’État-nation le plus puissamment ancré du monde actuel : la vitalité des Américains dans leur affirmation nationale n’est pas à démontrer et leur capacité d’intégration est très forte. Par ailleurs, les États-Unis sont une société de changements très importants mais les Américains estiment qu’ils restent une société du Droit – la société de la Révolution américaine telle qu’elle naît à la fin du XVIIIe siècle sous le signe du droit des individus. Ce qui permet ce fonctionnement, c’est le cadre religieux providentiel qui fait des États-Unis un monde hors du monde. L’Amérique, c’est la terre élue par Dieu pour la réalisation de la Liberté – le reste de la planète étant voué à la perdition et relevant dans le meilleur des cas d’actions charitables.
Comment peut-on dépasser le point de vue tocquevillien ?
Il faut faire une nouvelle lecture des États-Unis afin de comprendre pourquoi ils ne peuvent pas être la réponse à nos questions. Certes, l’expérience américaine est profondément semblable à la nôtre mais le cadre politique y est toujours solidement en place, ce qui change tout. En Europe, nous avons l’impression que les instruments collectifs d’une maîtrise de notre destin n’existent quasiment plus alors que cette idée ne traverse l’esprit d’aucun Américain – qu’il soit ou non content de la politique menée par le gouvernement de son pays.
Je crois donc que la juste appréciation de ce qui nous apparente aux Américains ne comporte pas de réponse aux questions que nous nous posons en Europe. L’antiaméricanisme est un réflexe absurde qui méconnaît profondément les États-Unis, mais nous n’avons rien à attendre des Américains.
Le véritable événement qui fera diverger l’Europe et les États-Unis dans l’avenir, c’est la crise d’identité qui menace les États-Unis du fait de la mondialisation. L’Europe est intellectuellement adaptée à la mondialisation en raison de son histoire (longue pratique des relations internationales, expérience du décentrement, crise de conscience coloniale, etc.) car elle a le sens de la diversité des manières d’être du monde. La société américaine n’a pas le sens de sa propre relativité, à cause de la dimension religieuse de son identité. C’est ce que nous avons vu le 11 septembre : les Américains sont atteints pour la première fois sur leur territoire et ils découvrent qu’ils sont dans le monde ! Les guerres se passaient au loin, dans des pays étrangers plus ou moins considérés comme des repaires de bandits. Le 11 septembre a provoqué le choc qui décentre les États-Unis et la mondialisation en provoquera d’autres en ce siècle.
Pour les Européens, le problème identitaire n’est pas celui de leur place dans le monde : ils ont relativisé leurs expériences dans les conflits qui les ont opposés au fil des siècles, lors des grandes découvertes, lors de la colonisation qui a permis de connaître des peuples exotiques. Le problème des Européens, c’est de savoir qui ils sont, c’est le rapport à leur propre passé, c’est l’illusion que l’on peut fonder une identité collective sur le droit des individus, sans référence au passé historique… Au contraire, les Américains savent qui ils sont et ne doutent pas une seconde de leur passé historique. Les Américains ont quelque chose à nous apprendre sur les ressorts de la vitalité d’une collectivité politique. Nous avons quelque chose à leur dire sur la diversité du monde, la relativité des expériences.
Selon cette prospective, nous commençons à discerner la tâche qui nous attend à l’échelle des décennies qui viennent…
Nous avons à refaire ce que nos prédécesseurs immédiats avaient su réaliser entre 1945 et 1975 non sans peine et pas toujours de manière satisfaisante : il ne s’ agit pas de revenir au passé mais de reconstruire un régime mixte par recomposition des éléments de la modernité autonome – ceci dans le dépassement des unilatéralismes idéologiques qui ne nous font voir que certains aspects du problème. Nous avons plus que jamais besoin d’esprits politiques larges sachant connaître ce qu’il y a d’indispensable chez ceux dont ils ne se sentent très éloignés.
Je ne dis pas que ce travail de recomposition aura lieu : il est possible que l’heure de l’histoire européenne soit passée. Mais si nous sommes à la hauteur du passé de l’Europe et de l’invention de la démocratie nous pouvons aboutir de nouveau à des régimes démocratiques qui fonctionnent.