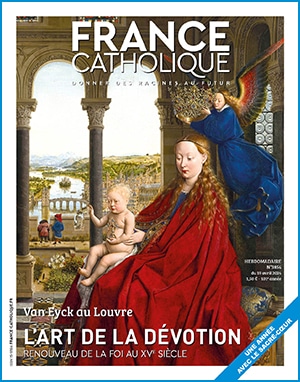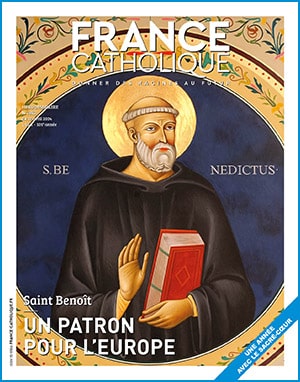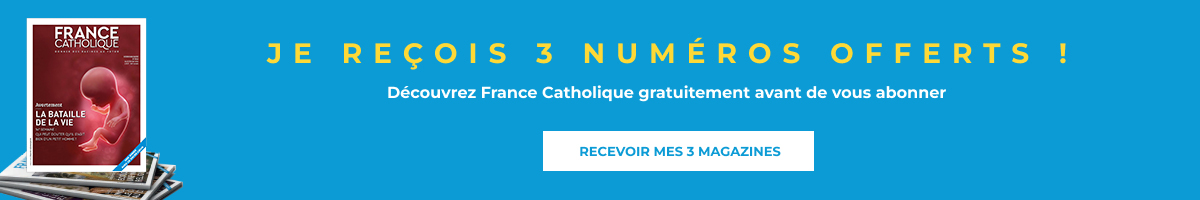31 JUILLET
Départ il y a quatre jours pour une autre belle région de France. Traversée de l’Auvergne avec le panorama des Puys, le Forez, la région lyonnaise puis l’entrée dans les Alpes. Après Grenoble, à Vizille, passage là où a eu lieu le terrible accident des pèlerins polonais revenant de La Salette. Des bouquets de fleurs sur le parapet rappellent le souvenir d’il y a seulement quelques jours, au bas de cette descente de l’Affrey. Nous n’avons pas le temps de monter prier Notre-Dame de la Salette. C’est qu’un autre sanctuaire marial nous attend, Notre-Dame du Laus, à proximité de Gap. Le site est moins sauvage que celui où la Vierge apparut à Mélanie et Maximin, il n’en est pas moins magnifique. Un vrai coin de paradis que ce petit sanctuaire en hauteur et en vis-à-vis d’un cirque de montagne. C’est aussi une bergère, Benoîte Rancurel, qui reçut la vision de Notre-Dame au XVIIe siècle. J’ai beaucoup goûté le climat de ce pèlerinage, l’accueil, les fidèles, avec le souvenir de la voyante, la prière…
Que dire aussi de la joie de rencontrer des amis, des longs échanges des soirées d’été, du mélange des générations, de la différence des formes d’esprit au sein d’une unité de fond… Il y a aussi au Laus un groupe d’étudiants amenés de Paris par le père Benoît de Sinéty, qui s’occupe de la pastorale des jeunes dans la capitale. Le Père a été le dernier secrétaire ecclésiastique du cardinal Lustiger, juste avant sa retraite en 2005. Il y a deux jours, il était encore à son chevet. Le Cardinal va mal, très mal. Mais les médecins ne peuvent encore discerner le terme qui peut être soudain mais peut aussi se laisser attendre. Dans un tel état, il vaudrait peut-être mieux que le Ciel lui ouvre ses portes.
Cela fait des semaines que la pensée du grand malade me poursuit de jour en jour. Depuis le début de l’été, je suis prêt à toute éventualité pour rejoindre Paris. Il m’est inconcevable de ne pas accompagner à sa sépulture un des hommes qui aura le plus marqué mon existence. Que Notre-Dame du Laus l’ait en sa garde maternelle ! J’ai en tête une homélie du Cardinal encourageant les personnes en fin de vie à se réfugier dans les bras maternels de Marie.
Ier AOÛT
Il est toujours difficile de rompre la belle connivence qui vous a unis plusieurs jours entre amis, et il vaut mieux ménager des transitions avant d’être tous dispersés. C’est pourquoi l’étape du retour qui nous réunit encore quelques-uns chez Michel et Françoise est bienvenue. Nous y ranimons la vieille tradition des discussions à l’infini, jusqu’à ce que le sommeil soit plus fort. Cette fois, le sujet a été amorcé par Henri, dont les origines alsaciennes renvoient au souvenir de sa famille en cette époque déchirante des guerres franco-germaniques. Quand, « la revanche était reine de France », les guerres d’enfer nées de la rupture révolutionnaire pouvaient aligner leurs millions de morts. Avons-nous à être fiers de cette forme de patriotisme sanglant ? Avec la distance, certains couplets « patriotiques » font mal. Certains textes passent mal. Tous les romans de Barrès n’ont pas résisté à la morsure du temps. Si Les Déracinés et La Colline inspirée se lisent plutôt bien, Colette Baudoche n’est pas supportable.
Est-ce à dire que nous avons à condamner sans indulgence ce qui nous paraît aujourd’hui si mesquin, si outrancier, et même plutôt barbare ? Je ne puis reprendre ici avec ses nuances, notre conversation nocturne. Elle fut plutôt animée. Si personne ne soutint la thèse de la légitimité d’un absolu patriotique justifiant le carnage, il parut difficile, en somme, de refaire l’Histoire, ou plutôt de la réinventer comme si elle ne s’était pas déroulée implacablement comme cela. Quelqu’un esquissa l’explication par la technique, l’industrialisation de la guerre. La machine et la masse guerrière, ce n’est plus le temps de la guerre en dentelle. Il y eut unanimité pour rendre justice à l’action pacifique de Benoît XV, le pape de la Grande Guerre.
Retrouvant Thibaudet, de retour dans mon hameau, j’y découvre tout de suite les mêmes interrogations, que ce soit autour des chroniques de Barrès sur la guerre (réunies en une douzaine de volumes). L’auteur y voyait le meilleur de son œuvre et le critique n’est pas d’accord. On sait quelle polémique est née à propos du « rossignol du carnage », mais tous les autres aspects sont aussi traités : la question d’Alsace-Lorraine à l’enseigne des minorités, celle de la paix, dans le cadre d’un équilibre européen. Cet équilibre se concevait alors dans une carte bouleversée par rapport à ce qu’était l’ancienne Europe. Et ce pourrait être une des clefs pour répondre à ce débat sans fin. Notre Europe n’est plus exactement celle d’hier. Les nations qui la composent ont trouvé l’entente impossible, semblait-il, dans la première partie du vingtième siècle.
Le dossier est trop complexe pour que je le résume en quelques phrases, avec tous les protagonistes cités et discutés par Thibaudet. Mais il me semble qu’on pourrait concentrer la difficulté en parlant du problématique accord des principes (ceux du président américain Wilson, ceux de la Société des nations à Genève, ceux éventuellement du Pape) et de la géopolitique. L’intéressant avec notre critique, c’est qu’il défend les premiers et ne sous-estime pas la seconde. C’est un aspect de son « libéralisme actif ». Le problème, c’est qu’il faudra attendre un nouveau désastre mondial, encore plus tragique, puis la « guerre froide » Est-Ouest, pour que se dessine un concert européen de nature nouvelle. Un sujet de réjouissance quand même : pour une fois, les leçons de l’expérience semblent avoir servi et les nations européennes ont enfin décidé de s’entendre. Les modalités exactes de l’entente ne sont pas encore pleinement précisées. Mais on voit mal – heureusement – qu’on en revienne aux déchirements des siècles passés.
3 AOÛT
Il n’y a pas eu cette année que la publication de Réflexions sur la politique, dans la collection Bouquin, pour nous rappeler l’importance d’Albert Thibaudet, Gallimard nous a offert, en même temps, dans sa collection Quarto, les Réflexions sur la littérature, du même, c’est-à-dire les articles parus dans la NRF, de 1912 à 1938, au-delà de sa mort, qui est de 1936, la même année que Jacques Bainville. C’est Antoine Compagnon qui a dirigé également cette réédition, qui l’a préfacée et connotée avec une équipe qui a fort bien travaillé. Je préfère les notes en bas de page, de ce volume, plutôt que celles de Bouquin qui renvoient en fin de volume, ce qui provoque pour le lecteur une gymnastique éprouvante.
Le préfacier prononce cet éloge peu commun : «Lues au long, les Réflexions se révèlent aussi pleines de culture que les Lundis de Sainte-Beuve et aussi riches de sagesse que les Essais de Montaigne. Thibaudet vit la littérature à la manière de ces deux immenses précurseurs. Il la connaît « du dedans », il l’habite comme son pays ; il est familier de ses moindres recoins. Et il l’arpente sans relâche et en tous sens.» Plus on progresse dans les textes des deux volumes, plus on se persuade que cela est vrai à la perfection. Et lorsqu’Antoine Compagnon parle du scepticisme de Thibaudet dans l’esprit de Montaigne, je suis d’accord, mais en donnant à ce scepticisme une rigueur qui s’oppose au pyrrhonisme et oblige sans cesse à rechercher le pôle complémentaire qui s’oppose à un pôle unique de la pensée et permet d’ouvrir le champ de la conscience à l’ampleur de l’interrogation historique et philosophique, bien au-delà de la littérature et de la critique. Maurras disait de celui qui lui avait consacré un essai bienveillant et perspicace, qu’il était « bilatéral », c’est-à-dire qu’il avait la faculté de partager en même temps les vérités contraires de deux pôles intellectuels. Était-ce un reproche ? Peut-être. Mais quelle chance d’avoir un tel analyste de soi-même, capable de venir de l’autre bord pour vous reconnaître avec votre identité, votre œuvre, vos raisons, votre vie. C’est un sacré cadeau.
Quant à ce recueil fleuve (1500 pages), il m’est impossible d’en donner une appréciation synthétique. Je m’y promène. Je m’y attarde et même je m’y arrête complètement, saisi par la qualité du jugement, la densité des propositions. Un exemple : traitant du cas très particulier de la religion de Barrès, Thibaudet le rapproche du cas Chateaubriand : « Quand Chateaubriand mourut, il y avait de longues années qu’il suivait avec exactitude les pratiques de sa religion, écrivant même, La vie de Rancé sur les conseils de son confesseur. C’est qu’il mourut à quatre-vingts ans. Mais à trente ans, avec Le Génie du christianisme, il avait fondé un catholicisme du dehors, qui est devenu presque, entre le catholicisme et le protestantisme, une des religions de la France. Paraissant le jour de la mise en vigueur du Concordat, le Génie était une manière de concordat entre la religion et la littérature. L’auteur de La Grande Pitié des Eglises de France (Barrès) appartient à la religion du Génie. Il n’a pas dénoncé ce concordat. Il lui a même ajouté dans Le Culte du moi, quelques articles organiques. Mais le fond de Chateaubriand était un déisme du XVIIIe siècle, à la Rousseau, tandis que le fond de Barrès était un panthéisme venu du XIXe, un panthéisme nature, sans métaphysique. »
Qu’ajouter à cela ? Il y a tant de connaissance du sujet, fondée sur des lectures complètes, l’exploration historique, l’empathie avec les sensibilités successives des siècles qu’on ne peut qu’approuver en admirant.
4 AOÛT
Il n’est pas de jour, depuis des semaines, où la pensée du cardinal Lustiger ne se soit imposée à moi, avec ses souffrances et la perspective de son proche retour à Dieu. Je sais par son entourage qu’il en est à ses toutes dernières heures et qu’il a perdu connaissance. J’attends maintenant la nouvelle de sa mort dans la paix certaine de l’espérance, avec au cœur une infinie reconnaissance pour ce qu’il fut et ne cessera jamais d’être. Il me semble que le Cardinal se préparait à ce départ, sa tâche accomplie. Pensait-il qu’il participerait au conclave pour la succession de Jean-Paul II ? Le souhaitait-il ? Son épiscopat fut tellement associé à celui du pape défunt qu’il est impossible de les dissocier l’un de l’autre. N’a-t-il pas confié qu’il préférait partir avant le Pape pour la maison du Père ? Ce qui est sûr, c’est qu’il participa à l’élection de Benoît XVI avec une singulière intensité, mesurant la responsabilité qui reposait sur ses épaules de membre du Conclave. Benoît XVI élu, sa solidarité avec lui était totale. Au lendemain de la conférence de Ratisbonne, je le retrouvais égal à lui-même, c’est-à-dire plus déterminé que jamais à défendre le Pape attaqué de toute part.
5 AOÛT
Le Cardinal est mort dimanche à 19 h 30, l’heure où il terminait habituellement sa messe à Notre-Dame, et dans la vigile de la transfiguration du Christ.
Les messages s’accumulent sur mon répondeur. C’est comme cela que j’apprends la nouvelle. Mon fils qui l’a su par la télévision. Des collègues qui me demandent des interventions. Le Père Matthieu Rougé qui est allé se recueillir à la Maison Jeanne Garnier où le Cardinal a poussé son dernier soupir devant les religieuses qui le veillaient.
6 AOûT et SUIVANTS
Je n’ai guère dormi cette nuit. La présence du Cardinal, passé sur l’autre rive, s’est manifestée par de multiples souvenirs et images qui me revenaient, les uns suscitant les autres. Au matin, il me faudrait répondre par téléphone aux questions de Louis Daufresne sur Radio Notre-Dame. Ce qui est sûr, c’est que je parlerai de l’abondance du cœur, tant le Cardinal m’a apporté et son témoignage est vivant en moi. Au cours des jours prochains je vais être assez sollicité de la part des médias et je livrerai morceau par morceau tout ce que je puis exprimer de ce que j’ai compris et reçu de lui. Aussi voudrais-je tenter ici une première synthèse, imparfaite et incomplète, utile pour moi d’abord, car j’éprouve le besoin de faire le point en rassemblant plus que des images pour aboutir à une sorte de bilan de reconnaissance.
Apparition.
Mes premières images de Jean-Marie Lustiger, hors celles de la télévision, son celles de sa messe d’installation à Notre-Dame de Paris. La cathédrale est comble, je vois encore le professeur Jérôme Lejeune venu presqu’en voisin et qui l’admirera beaucoup malgré des relations pas toujours faciles entre les deux hommes. Mon impression dominante : l’extrême dynamisme du nouvel archevêque. Sa force d’entraînement est palpable. Tout ce que je sais de lui me vient alors de mes amis Jean-Luc et Corinne Marion qui l’ont eu comme aumônier au centre Richelieu et ont continué à le suivre comme curé de Ste-Jeanne de Chantal. C’est d’ailleurs Jean-Luc qui m’a prévenu de sa nomination à Paris. Le Quotidien de Paris, où je travaille, a été du coup, le premier à lancer l’information, ce qui a failli me causer quelque ennui. Nous avons en effet grillé l’embargo. De plus, mon directeur de rédaction, Bernard Morrot, a une fois de plus démontré son sens du choc des mots avec une manchette sensationnelle : «Le Pape a nommé le nouvel archevêque de Paris, il est juif». De moi-même, je n’aurais évidemment pas procédé ainsi. Même si mon article ne cachait rien à propos de l’origine de Jean-Marie Lustiger, je ne voulais pas empirer un effet tapageur, par respect d’abord pour lui-même et ce qui relevait de ses secrets et des douleurs que je devinais. Mais je n’étais plus maître de rien. Malgré moi, j’avais contribué à déchaîner la tempête et il n’était plus question que de cela. Mon propre journal revenait sur le sujet en enregistrant les déclarations de ceux qui réagissaient sur la judéité de l’archevêque. A ma confusion, certains lui reprochaient de s’en faire un étendard – alors que c’était nous les responsables qui avions déclenché l’affaire. Je n’ai jamais parlé par la suite à Jean-Marie Lustiger de ce premier incident. Peut-être l’avait-on averti de mon innocence et de mon identité.
Il y a d’ailleurs quelque chose que je n’ai pas réussi à éclaircir par la suite. Lorsqu’il m’a remis, quelque vingt ans plus tard, les insignes de chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire le Grand, le Cardinal a prétendu m’avoir connu bien avant sa nomination à Paris. Il a même affirmé se souvenir de moi dans les prolongements de 68 lorsque, dans le sillage de Maurice Clavel, je m’étais lancé dans une interprétation particulière de la crise de civilisation. J’avoue en avoir été vivement surpris, car c’était la première fois qu’il me parlait de cela. N’avait-il pas reconstruit dans sa tête cette préhistoire ? Ou s’était-il souvenu, après coup, d’épisodes anciens où j’avais été associé ? Arrivé à Paris en 1967 après un séjour africain, j’avais suivi des cours en Sorbonne sans fréquenter le centre Richelieu, à l’exception peut-être d’une réunion où participait le philosophe Claude Bruaire. J’ai lu quelques fois Paraboles, le journal du Centre, mais n’ai jamais rencontré à l’époque le Père Lustiger.
Mais je crois que ce compagnonnage avec Clavel lui agréait beaucoup et qu’il lui était aisé d’imaginer mon propre parcours en relation avec les orientations intellectuelles qu’il me connaissait. Toujours est-il que j’ai commencé à bien connaître le nouvel archevêque à cause des réunions de presse où il nous conviait, nous les informateurs religieux. C’était toujours une vraie fête de l’esprit que de l’écouter. Ses vues étaient originales, réfléchies à la suite de lectures très diverses dont il tirait le meilleur pour comprendre la société et envisager une action pastorale. Mais j’en reparlerai à propos de sa forme d’intelligence. Mes contacts avec lui prirent une tournure décisive lorsque mon ami Olivier Jay, qui était chargé de la communication de l’archevêque, organisa une rencontre pour un entretien au Quotidien de Paris. C’était à la veille de Pâque 1982 et Olivier m’avait dit : «C’est une occasion pour toi de l’interroger sur le mystère pascal, c’est le cœur de la foi, écris tes questions et envoies les quelques jours avant la rencontre». Je m’en souviendrai jusqu’à la fin de ma vie : «Monsieur, j’ai lu vos questions et je constate que vous ne me parlez ni du mariage des prêtres, ni de l’ordination des femmes qui semblent les seuls sujets propres à intéresser vos confrères. Les vôtres concernent la foi et les conditions de son accueil par nos contemporains, et je me ferai une joie d’y répondre.» S’ensuivit une magnifique méditation qu’il me faudra retrouver dans mes archives, ainsi que des vues personnelles et pertinentes sur l’annonce du Christ dans une société en train de perdre sa culture chrétienne. Faut-il préciser que j’étais comblé, enthousiasmé et que tout ce que j’avais imaginé à partir du témoignage de Jean-Luc et Corinne Marion se trouvait confirmé au-delà du possible ? Il n’y avait plus aucun doute dans ma tête : Jean-Paul II nous avait fait cadeau de l’archevêque dont nous avions absolument besoin. Celui qui répondait à la situation d’une Eglise déstabilisée et d’une société en crise. En plus de sa lucidité intellectuelle, il y avait l’élan de la foi enracinée dans la plus profonde méditation intérieure. Comme le dirait André Frossard : «Oh oui, cet archevêque avait la foi !». À certains moments de l’entretien, il s’était interrompu. «Ce n’est pas possible… ça ne peut pas passer dans un journal. C’est une instruction pour une retraite sacerdotale.» Je m’empressais de lui intimer de continuer. Pour rien au monde je n’aurais voulu qu’il brise le cours de sa méditation. Une de ses inflexions les plus fortes m’avait saisi, comme si elle me livrait une part de son secret. L’instant le plus véridique de la vie de François d’Assise, disait-il en substance, ce n’est pas celui du jeune aventurier des débuts, c’est celui, alors qu’il est aveugle, où il reçoit les stigmates sur l’Alverne. C’était bien cela : cet homme si actif, si plein de projets et d’idées, si impatient, était d’abord un mystique, brûlé comme François par la morsure d’un amour inextinguible. Plus tard, alors qu’au début de Radio Notre-Dame – on était un peu dans l’improvisation – j’étais venu rue Barbet-de-Jouy pour recueillir le mot hebdomadaire de l’archevêque, il avait parlé de Thérèse d’Avilla un peu dans la même tonalité.
A la fin de cet entretien pour le Quotidien, il avait dit à Olivier Jay : «Il faudra faire relire tout cela par le Père Chapelle». Et à mon adresse : «C’est un ami théologien». Grâce au Cardinal, je ferai la connaissance de ce jésuite belge, très proche de l’archevêque de Paris, et je serai conquis par sa bonté et son intelligence. Je comprendrai le rôle important qu’il a tenu comme conseiller théologique et formateur des séminaristes que lui Cardinal lui envoyait à Bruxelles.
Dernier souvenir : Balthasar vient de traduire en allemand les Sermons d’un curé de Paris, ceux que Jean-Marie Lustiger prononçait quand il était curé de Ste-Jeanne de Chantal. C’est une sérieuse marque de confiance de la part de ce théologien de premier ordre. Un peu gonflé, je demande à Mgr Lustiger de m’en dédicacer un exemplaire et il apprend – heureusement étonné – que je suis un lecteur de l’auteur de La Gloire et la Croix. Toujours est-il que de cet entretien date le début de relations suivies. Je n’oserais parler d’amitié si le Cardinal n’avait lui-même prononcé le mot, le jour de sa réception à l’Académie française : «Gérard, je vous remercie de votre amitié».
Le résultat de cette entrevue, ce fut donc un quart de siècle où il me fut donné de le voir longuement lorsque j’avais besoin d’un éclairage sur telle ou telle question. Je crois n’avoir pas abusé de son temps, sachant qu’il était précieux. Impossible ici de résumer, même à grands traits, le contenu de ces conversations aux objets les plus divers : l’affaire de l’école, sous le premier septennat de François Mitterrand, les énigmes de la post-modernité, l’état de l’Église de France, l’évangélisation, les JMJ, Jean-Paul II, l’islam, etc. Malheureusement, je ne tenais pas de journal avant 2002, et je n’ai pas transcrit au fur et à mesure, sur le moment, ses propos. Ce sera un de mes regrets, comme celui de n’avoir pas noté les paroles du cardinal de Lubac, au cours de la dizaine d’années où je lui ai rendu visite. J’ajoute que certains propos du Cardinal étaient confidentiels et qu’il m’aurait été impossible de les publier sur le moment.
Judaïsme.
Il me dira, lors du grand entretien filmé pour ses 80 ans, que KTO n’a diffusé qu’après sa mort, à propos de sa première rencontre avec Jean-Paul II : «Je savais qu’il savait». C’est en connaissance de cause que le Pape a nommé à Paris Jean-Marie Lustiger. Il y a quelque chose de saisissant dans le face à face des deux hommes : l’un venu du cœur névralgique de l’Europe, du lieu même de sa tragédie, et le fil du peuple juif, converti à quatorze ans au christianisme et dont la mère a été martyrisée à Auschwitz. Depuis 1981, je n’ai cessé de voir, de comprendre le Cardinal, dans cette lumière tragique et eschatologique à la fois. Il était évident qu’il portait sur lui le destin du peuple juif, tout comme Edith Stein, partant avec sa sœur pour l’ultime étape. La photo sur son bureau, dans son habit de carmélite, de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix n’était-il pas le signe le plus remarquable de cette mission qu’il assumait avec elle ? Pour comprendre cela en plénitude, il faut relire le grand enseignement de Paul aux Romains, repris d’ailleurs dans la fameuse déclaration Nostra Aetate de Vatican II. Mais avec Jean-Paul II et Jean-Marie Lustiger, cet enseignement devenait vivant, manifeste, il se traduisait en actes et entraînait l’Eglise entière à se référer au mystère d’Israël.
Il a fallu qu’il devienne archevêque de Paris pour que sa judaïté devienne ainsi manifeste. Jusqu’alors, me semble-t-il, il avait été discret, et certains de ses proches ont attendu longtemps pour savoir le drame de sa mère. Projeté par une responsabilité si éminente, il ne pouvait plus échapper à une visibilité que les médias se chargeaient de rendre implacables. Il a reçu cette provocation comme un appel, même si à certains moments, il lui était dur de se charger publiquement du poids de la Shoah. Parfois il demandait grâce, car replonger dans l’enfer de l’extermination où avaient péri tant des siens lui était un supplice. En même temps, il ne pouvait se dérober à la vocation dont Dieu seul pouvait être la source et qui lui demandait impérativement de tirer les conséquences de sa situation singulière. D’où sa célèbre formule : « C’est comme si tous les crucifix s’étaient mis à porter l’étoile jaune ! » A elle seule, elle nous ouvre un abîme qui est le sien, tout en étant celui de l’Histoire. ■