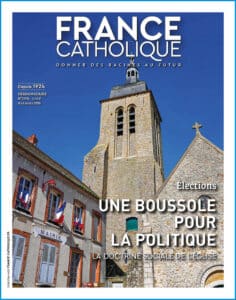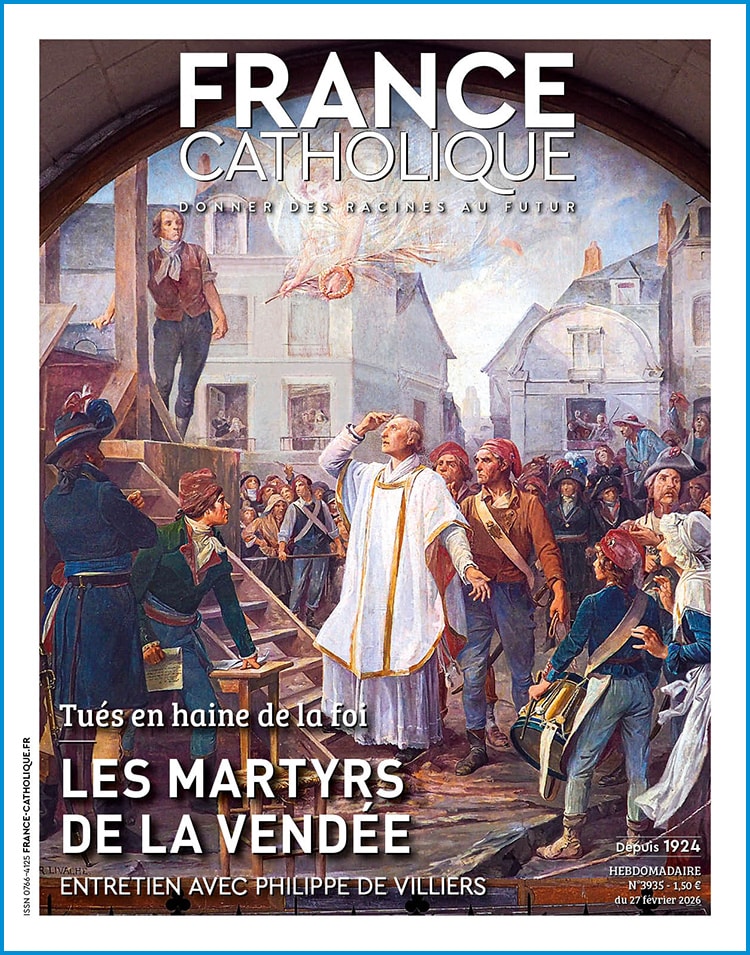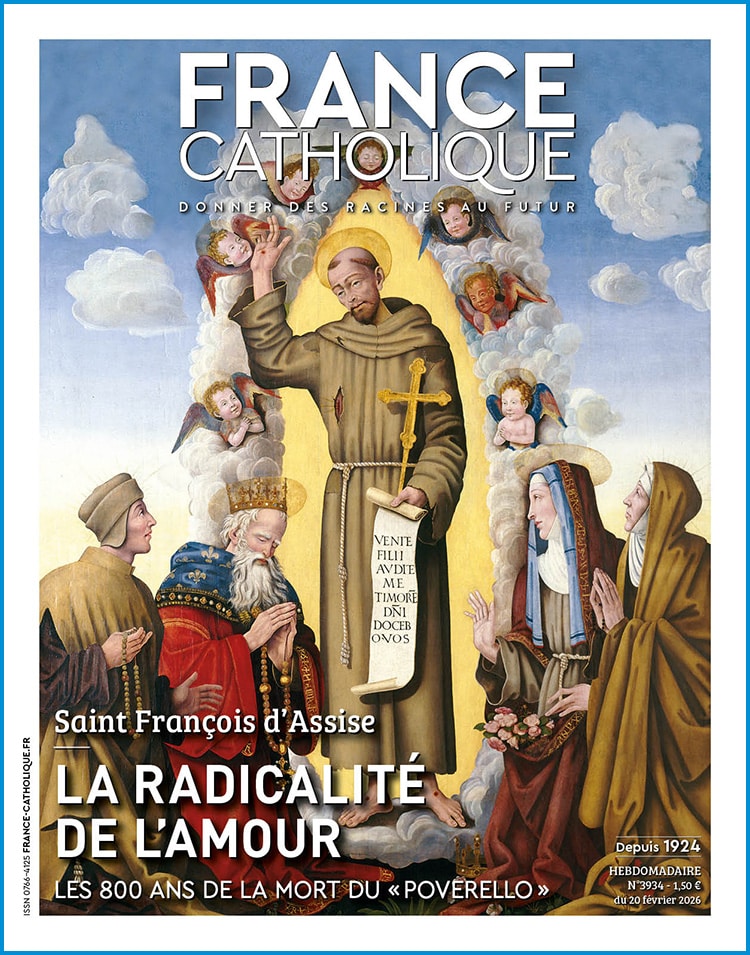On sait (on le lit tous les jours) que si les Etats-Unis d’une part, la Russie et la Chine de l’autre, sont si désireux de passer l’éponge sur leurs querelles, c’est que les premiers ont grande envie de vendre, et les autres d’acheter. D’où la question que beaucoup se posent : en même temps que la science et la technologie américaines, les Russes et les Chinois ne seraient-ils pas, par hasard, en train d’acheter à leurs rivaux le moyen de les rattraper, puis de les dépasser et de les détruire ? et l’Occident avec ?
Cette inquiétude s’est manifestée surtout à l’annonce d’un marché de quelque deux mille centres de calcul électronique que les Américains sont tout disposés à vendre aux Russes, clés en main. Fabuleux marché, bien propre, a-t-on dit, à susciter des réflexions désabusées sur l’irresponsabilité des grosses firmes américaines, prêtes à tout pour gagner de l’argent, y compris à commercialiser leur suicide.
Déjà, fait-on remarquer, le produit national brut américain a cessé de croitre, alors que celui des Russes et des Chinois accuse une constante progression 1. Alors ? Les Américains ne sont-ils pas en train de fabriquer, pour un provisoire coussin de dollars, le poignard qu’on leur mettra demain dans la gorge ?
Une « hérésie capitaliste »
Cette chronique étant une chronique scientifique, je n’examinerai pas l’aspect politique et moral de ce problème, ni s’il est souhaitable ou déplorable que le capitalisme soit bientôt peut-être, comme dit M. Marchais, « frappé au cervelet » 2. Je me bornerai à examiner si, compte tenu de ce qu’on sait des processus de développement scientifique et technologique, les énormes marchés qui vont s’ouvrir entre les trois Grands auront pour effet de supprimer, d’accroître ou de laisser inchangé l’avantage américain.
Ainsi posée, la question prête à toutes les spéculations que l’on voudra. Non qu’elles soient toutes également légitimes ou vraisemblables, mais il ne sert à rien de les développer, puisque chacun n’en croira que selon ses désirs.
Examinons donc plutôt pourquoi les Russes, dont les prouesses spatiales ont émerveillé le monde, sont obligés, en 1972, de négocier l’achat de deux ou peut-être trois mille centres de calcul. Là, le problème est d’une parfaite limpidité. Si les Russes n’ont pas ces centres de calcul (qu’ils auraient pu construire comme les Américains en s’y prenant à temps), c’est qu’il y a vingt-cinq ans l’idée même de « centre de calcul » n’existait pas, et que, n’existant pas, on n’a pas pu l’insérer dans les Plans qui sont le système nerveux de toute activité socialiste.
Quand, après Hiroshima et Nagasaki, on apprit l’existence de la bombe A, les savants eux-mêmes mirent un certain temps à évaluer les enseignements du « projet Manhattan » qui avait servi à la construire. Il leur fallut deux ou trois ans pour comprendre que le rôle essentiel avait été joué par les premiers ordinateurs inventés à cet effet.
Ces ordinateurs étonnaient certes, mais on crut d’abord que leur usage était limité On y vit une curiosité, certes très excitante pour l’esprit, mais leur réelle portée économique, sociale et politique ne fut devinée par personne, même pas par Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, dont le livre fameux : Cybernétique et société, remue une foule d’idées passionnantes sans grand rapport avec ce qui allait se passer. 3
Si les savants ne comprirent pas, est-il raisonnable de jeter la pierre aux hommes politiques ? Inspirateur et arbitre suprême des plans russes, Staline décida que la cybernétique était une hérésie capitaliste, et qu’il n’y avait pas lieu de donner dans ce piège. C’est cette fatale décision qui, vingt-cinq ans plus tard, va multiplier colossalement la fortune d’IBM aux dépens du contribuable russe.
Et cependant, Staline avait raison ! Je parlais récemment de cette « erreur » historique avec des mathématiciens américains spécialistes des ordinateurs 4 Et voici ce qu’ils m’ont dit : « Il faut admirer l’intuition de Staline qui, sans la moindre notion technique, devina que les processus de recherche et d’application du software étaient incompatibles avec l’idée de planification. Car comment se développent les recherches de software, c’est-à-dire des mathématiques d’application des ordinateurs ? Par nécessité organique, uniquement dans le hasard, la concurrence et la liberté, ou si l’on préfère le libéralisme. Le software est par essence implanifiable, puisqu’il vise à imiter et à généraliser les processus vivants, lesquels ne peuvent progresser que dans la constante improvisation. Dès l’instant que l’on planifie la vie, c’est l’agriculture et l’élevage, et les résultats obtenus ne sont que ceux que l’on cherche : les espèces domestiques ne répondent qu’à un but, celui du Plan, et sont incapables de développer de l’imprévu. On ne planifie pas l’imprévu. Ce qui est vrai de la vie l’est encore plus de la pensée. Et le software, c’est la pensée artificielle. Comment planifier la pensée sans l’empêcher de penser ? Voilà ce qu’avait parfaitement vu Staline : les techniques de pensée artificielle étant par nature implanifiables, donc antisocialistes, elles étaient du même coup, selon lui, vouées à l’impasse des contradictions capitalistes, et condamnées. La décision prise par le dictateur prouve deux choses : qu’il était un grand esprit, et qu’il croyait réellement à la supériorité du socialisme. Il se trouve simplement que, sur ce point décisif, le système socialiste est en défaut.
D’éternels clients
Que va-t-il donc se passer quand les firmes américaines auront livré aux Russes l’énorme matériel que ceux-ci désirent leur acheter ?
Du côté russe, on se retrouvera devant le même problème tranché jadis par Staline : ou bien on persistera dans la planification intégrale, et le retard supposé comblé par cet achat recommencera à se creuser ; ou bien ayant compris la leçon, les planificateurs décideront de libéraliser, creusant ainsi une autre brèche, mais bien plus dangereuse, au flanc du système politique et social lui-même. Car c’est la liberté complète qu’il faut, ou rien, je montrerai cela dans une prochaine chronique à la lumière d’exemples que j’ai pu observer aux Etats-Unis.
Du côté américain, cette gigantesque opération industrielle se traduira évidemment par un bond en avant correspondant, par d’immenses réinvestissements intellectuels et par des progrès encore accélérés, fût-ce au prix de crises sociales.
Tout cela a été évidemment pesé avec soin par les technocrates qui conseillent M. Nixon. L’Amérique sait ce qu’elle fait en libérant complètement son catalogue en faveur des pays planificateurs : elle les enferre. Il faudra, ou bien qu’ils se libéralisent, ou bien qu’ils se résignent à ne jamais sortir de l’état de clients. 5
Aimé MICHEL
Les Notes de (1) à (5) sont de Jean-Pierre Rospars
(*) Chronique n° 104 parue initialement dans France Catholique − N° 1 339 − 11 août 1972.
Pour aller plus loin :
- Ce décrochage américain se révèlera faux. Voir la chronique n° 270, C’est la « chute finale », in La Clarté, chap. 13, p. 361, à propos du livre d’Emmanuel Todd, La Chute finale, Laffont, 1976.
- Lorsqu’Aimé Michel écrit ces lignes, Georges Marchais (1920-1997) n’est pas encore secrétaire général du Parti communiste français, fonction qu’il va exercer quatre mois plus tard jusqu’en 1994. Né dans une famille catholique et pauvre du Calvados, il devient mécanicien ajusteur à l’usine de constructions aéronautiques Voisin en région parisienne. En décembre 1942 il part travailler chez Messerschmitt à Augsburg. Selon le communiste Charles Tillon et le journaliste Jean-François Revel, il s’est porté volontaire (Marchais ne les attaquera pas en diffamation) mais selon son biographe, Thomas Hoffnung, il est muté en Allemagne dans le cadre de la réquisition des travailleurs de l’industrie aéronautique. Après la guerre il adhère au Parti Communiste, devient syndicaliste à la CGT et monte rapidement dans la hiérarchie. Il devient membre du comité central et du bureau politique en 1959. En 1968 il commence par qualifier Daniel Cohn-Bendit d’« anarchiste allemand » et attaque les « faux révolutionnaires » avant de soutenir le mouvement étudiant. Il garde le silence lors du Printemps de Prague. En juin 1972, il signe le Programme commun de gouvernement avec le Parti socialiste et les radicaux de gauche. En décembre de la même année il succède à Waldec-Rochet comme secrétaire général du PCF. L’année suivante il est élu député dans le Val-de-Marne et est régulièrement réélu par la suite. En 1974, alors que l’Union soviétique est au faîte de sa puissance, Marchais défend son « bilan globalement positif » au XXIème congrès du parti, ce qui provoque une vive polémique. Pourtant, en 1976, le PCF, suivant l’exemple du PC italien, abandonne toute référence au modèle soviétique et à la dictature du prolétariat. Aux élections européennes de 1979 le PCF obtient 20,6% des voix et G. Marchais est élu député européen (il le restera 10 ans) mais aux élections présidentielles de 1981 il n’obtient que 15,4% des suffrages. Devenu parti de gouvernement avec F. Mitterrand, l’érosion de l’influence du PCF se confirme : 11,2% aux élections européennes de 1984 et moins de 9% aux présidentielles de 1988. Ces mauvais résultats contrastent avec sa popularité télévisuelle où il se distingue par sa physionomie, son élocution, ses fautes de français (« Je vous donne quelle est mon opinion »), ses réparties (« J’ai dit à ma femme : Liliane, fais les valises, on rentre à Paris », suite à une déclaration de Mitterrand alors qu’il est en vacances en Corse), son art d’esquiver les questions (« – Vous permettez ! Quand vous avez posé une question, si ma réponse vous gêne tant pis pour vous ! – Ce n’était pas ma question ! – C’était p’têt pas vot’ question, oui, mais c’est ma réponse ! »). En 1994, il cède son siège à Robert Hue mais reste titulaire du bureau politique (devenu bureau national). Il décède trois ans plus tard d’un malaise cardiaque.
- Sur Norbert Wiener voir la chronique n° 67, La querelle des programmes, parue ici le 26 avril 2010.
- Aimé Michel rencontra ces « spécialistes des ordinateurs » lors de son voyage aux Etats-Unis en mai 1972. Ce sont notamment Douglas Engelbart, le co-inventeur de la souris, et Jacques Vallée. Tous deux travaillaient alors à un projet intitulé « Augmentation de l’intellect humain » dirigé par le premier à l’Institut de Recherche de Stanford (SRI). Jacques Vallée, qui reçut Aimé Michel, relate cette visite et plusieurs des entretiens qui l’émaillèrent dans son journal Forbidden Science Volume Two : Journals 1970-1979, The Belmont Years, Documatica Research, 2008, pp. 132-137.
- A l’époque cette analyse des difficultés de l’URSS et de son retard économique n’était pas encore partagée par l’opinion et il faudra attendre 1976-1978 pour qu’elle soit plus largement admise. Dans un discours au Politburo, Léonid Brejnev, qui fut secrétaire général du Parti communiste et donc principal dirigeant de l’Union soviétique de 1964 à 1982, déclarait en 1971 :« Nous communistes devons faire un bout de chemin avec les capitalistes pour quelque temps. Nous avons besoin de leurs crédits, de leur agriculture et de leur technologie. Mais nous allons poursuivre des programmes militaires massifs et, vers le milieu des années 1980, nous serons en mesure de revenir à une politique étrangère beaucoup plus agressive conçue pour l’emporter dans nos relations avec l’Ouest ». De leur côté Richard Nixon, arrivé au pouvoir en 1968, et son conseiller Henry Kissinger, dans un contexte de crise (guerre au Vietnam, inflation), redéfinissaient la politique étrangère des Etats-Unis. Les deux blocs inaugurèrent ainsi une politique de détente substituant la négociation à la confrontation dont quelques signes visibles furent la signature des accords SALT I sur la limitation des armements stratégiques en mai 1972, une collaboration dans le domaine spatial (vol commun Apollo-Soyouz en 1975) et la vente massive de blé à l’URSS (le quart de la récolte américaine en 1972). Dans le domaine informatique les choses ne se passèrent cependant pas comme les soviétiques le souhaitaient et comme Aimé Michel le prévoyait. Jusque là les ventes de matériels et données stratégiques aux pays communistes étaient administrées par un Comité de coordination de l’OTAN (COCOM) qui donnait ou non son accord pour les produits ne figurant sur la liste approuvée. La détente impliquait un assouplissement des règles du COCOM, en particulier en matière informatique. Fin 1973, Nixon demanda à ses conseillers quels ordinateurs et logiciels pouvaient être vendus aux pays communistes. Après analyse de la situation ils conclurent que l’URSS manquait à la fois d’ordinateurs et de moyens de paiement et donc que les Soviétiques viseraient d’abord l’achat des ordinateurs les plus puissants, ceux qui présentent le plus de risques en matière de sécurité. Ils recommandèrent un accroissement modéré de la puissance des ordinateurs autorisés à la vente à l’Est et maintinrent l’interdiction d’exporter les ordinateurs les plus puissants de crainte de les voir utilisés pour la mise au point d’armes nucléaires et la cryptographie. Ces mesures furent approuvées par Nixon en mars 1974. Les soviétiques tentèrent de compenser cette interdiction en mettant en place un réseau d’espionnage très efficace qui ne sera révélé qu’en 1981 à la suite de la défection du Colonel Vladimir Vetrov, le fameux « Farewell » ainsi nommé par les services secrets français, mais ceci est une autre histoire…