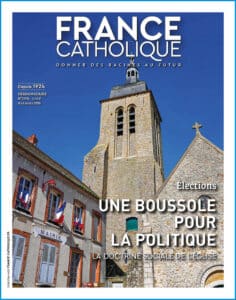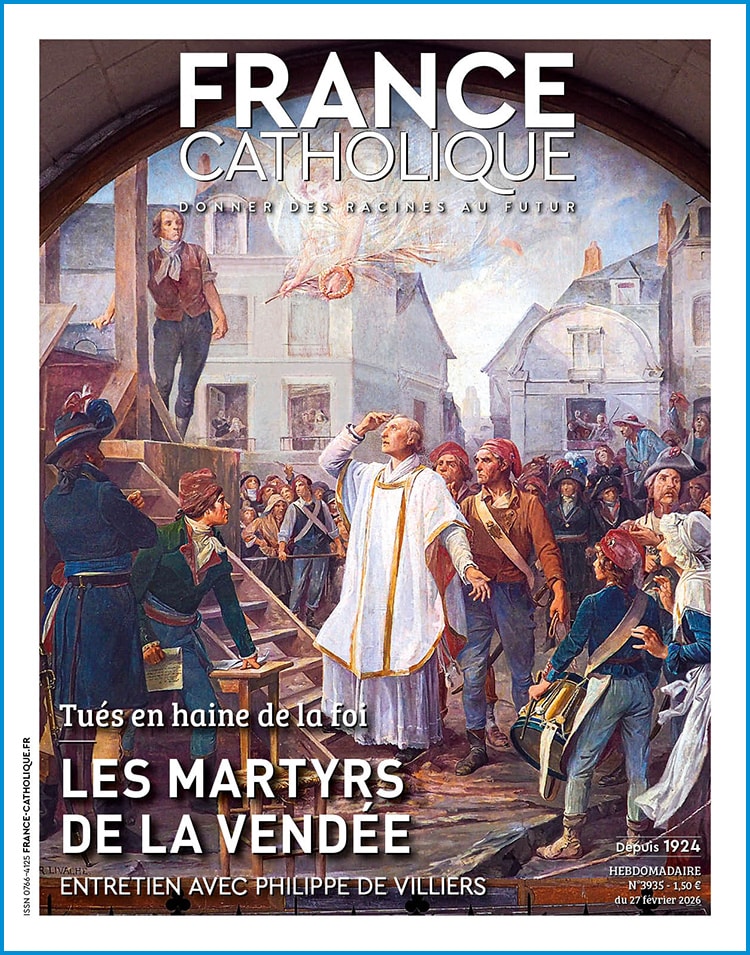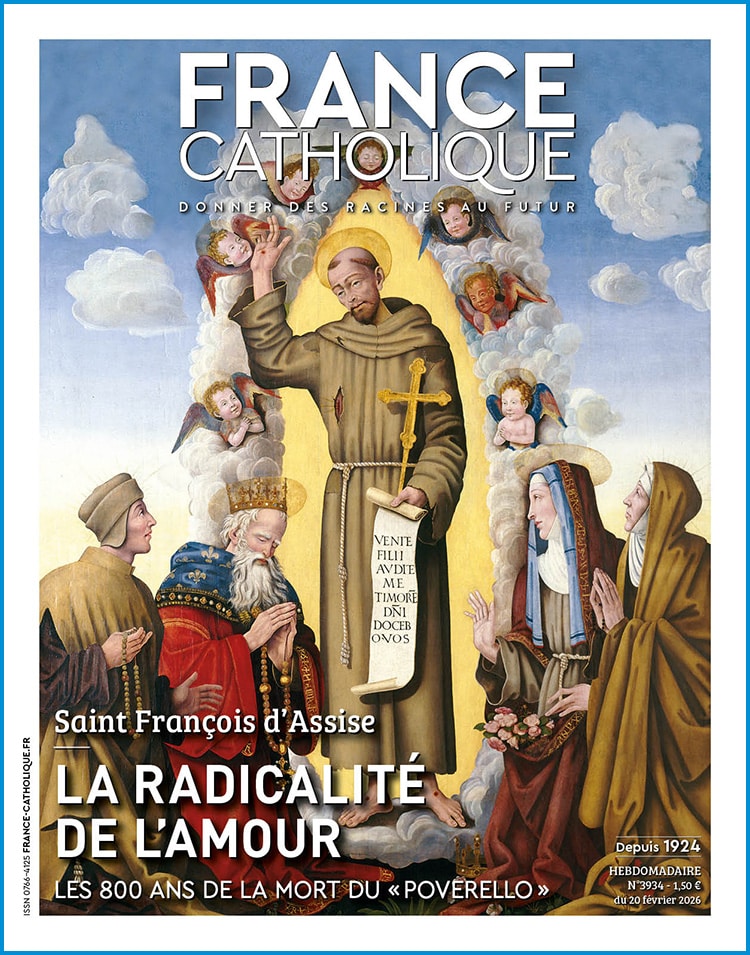EH OUI, EH OUI, D’ABORD, le péché, cela existe, ce n’est pas une invention culpabilisante des cultures répressives. Seuls les ignares dont toute la science est puisée dans un journal s’imaginent cela.
Toutes les cultures, sans exception, ont leur idée du péché, pour la simple raison que l’homme ne peut vivre sans un certain sentiment d’insatisfaction et de doute. Ce paradoxe est une des découvertes de l’ethnographie – j’entends la vraie, celle qui enregistre ce qui existe sans se prémunir d’un système anticipé d’explication capable de tout réduire au mythe favori de la culture à laquelle appartient le chercheur.
Cette découverte, en deux mots, c’est que toute société existante ou ayant existé se maintient ou s’est maintenue grâce à des systèmes de lois implicites dont la sanction, chez le déviant, est, soit la honte, soit la culpabilité (shame culture et guilt-culture, l’observation ayant d’abord été faite par des Anglo-Saxons)1.
C’est-à-dire que ce qui retient chaque membre d’une société donnée de s’écarter trop des normes admises, c’est un sentiment soit de honte, soit de culpabilité. Notre présente société ne ressemble à un chaos d’immoralité que parce qu’elle est en train, selon une alternance classique, de passer de l’un à l’autre type.
C’était depuis deux mille ans une civilisation de culpabilité ; tout individu se sentait coupable envers ses parents (« ils ont tant fait pour moi, ils ont tellement souffert et travaillé »…) et envers Dieu (la pensée du péché originel et surtout du Golgotha).
[|*|]
Sont survenus les destructeurs de ce sentiment, et surtout Freud avec son « complexe d’Œdipe ». Freud a eu une claire conscience des effets lointains de sa doctrine : rappelons-nous sa rupture avec Jung et le mot qu’il prononça en mettant le pied sur le sol américain : « Ils ne se doutent pas que ce que nous leur apportons, c’est la vérole. »2
Entre parenthèses, la « vérole » freudienne s’est avérée bénigne outre-Atlantique : une petite fièvre passagère et vaccinante, limitée à quelques milieux mal considérés par la société américaine, qui continue tranquillement à se sentir pécheresse, ainsi qu’on l’a vu avec l’affaire de l’interview de M. Carter à Playboy3. En revanche, la maladie a produit et continue de produire ses effets dévastateurs en France, pays où l’influence intellectuelle dominante est entre les mains non des savants, mais des professeurs.
Or les professeurs, qui sont un milieu éminemment rebelle aux influences de la technique et de l’économie (on trouverait là sans peine de vieilles traditions cartésiennes et même platoniciennes, celles-ci remontant à la Renaissance), montrent en revanche une extrême susceptibilité aux idées. On les voit en ce moment s’enflammer à l’énorme pensum de Michel Foucault sur le sexe : cinq ou six gros volumes de démonstrations pédantesques4, dans le style ténébreux que l’on connaît, sur un sujet que la « civilisation de culpabilité » traditionnelle tenait pour une affaire privée.
Foucault va ainsi, du haut de sa chaire au Collège de France, accentuer notre mutation en une société, non plus de culpabilité (un des maîtres mots des pédagogues d’avant-garde est la déculpabilisation), mais de honte.
On est déjà affreusement honteux lorsqu’on n’est pas « de gauche », tellement honteux que seuls quelques provocateurs suspects de vouloir se rendre intéressants se déclarent parfois « de droite ». De ma vie, en tout, je n’ai jamais rencontré que trois hommes reconnaissant être « de droite », et je me garderai de citer deux d’entre eux : les malheureux ! Ils habitent Paris ! Ils seraient tellement écrasés par la honte que, pour sûr, j’aurais des poursuites judiciaires ! Le troisième, c’est le grand écrivain argentin Jorge Luis Borges. Il l’a même dit, je crois, à la télévision française5, et j’imagine l’horreur sacrée, le frisson d’outre-tombe qui dut secouer l’équipe enregistreuse de ce bien-pensant organisme6.
[|*|]
Revenons à Foucault et à sa gigantesque philosophade sur le Sexe. Heureux pays que le nôtre ! On sait d’avance, par ses « travaux » antérieurs, que les 5 ou 6 kilos de littérature du maître n’apporteront pas un seul fait nouveau, mais seulement de l’idéologie, qu’aussitôt toutes les têtes pensantes de France (à l’exception, hélas, des savants, traditionnellement bouchés, comme vous l’expliquera Simone de Beauvoir), vont s’y baigner avec délices, et se mettre à écrire force essais et manuels à l’usage de nos enfants pour transmettre le nouveau message.
Eh bien, à vrai dire, cela ne m’épouvante guère, et même, cela me fait rire. Aucune société n’existant sans honte ou culpabilité, que font en réalité tous ces jeteurs de bombes, ou qui se croient tels ? Ils obéissent à de très vieilles lois inscrites dans le cœur de l’homme. Ils sont les petits et innombrables instruments par quoi s’accomplit le plan des choses, que l’on peut, si on préfère parler français, appeler la Providence.
L’homme est ainsi fait que le sens du péché lui est pour ainsi dire consubstantiel. Il ne le perd qu’avec la vie. Quand il cesse de se sentir coupable, c’est pour choir dans le sentiment de sa honte. Freud et ses disciples déculpabilisent, mais en répandant la honte. Le déviant n’éprouve plus aucune contrition, mot disparu de la conversation, et même, me semble-t-il, de la théologie. Mais il se sent affreusement rejeté. Ce qu’il recherche à tout prix, ce n’est pas le pardon, c’est la conformité.
On en voit force exemples amusants dans les tentatives toujours renaissantes d’intégrer le non-conforme d’une façon ou d’une autre : pensons à l’énorme littérature bien-pensante destinée à récupérer les prostituées, les homosexuels, les délinquants, les voleurs, les assassins.
Rien de tout cela n’est nouveau, bien entendu. Dans les civilisations antiques, qui étaient des civilisations de honte, il y avait des dieux pour tout ce monde-là. Chez Homère, toute morale se ramène à l’acceptation par autrui et si possible au bon renom : la « timê ». Ulysse raconte avec bonhomie comment, ayant saccagé une ville qui ne lui avait rien fait, tué ses hommes, vendu ses femmes et ses enfants, il procéda ensuite au partage avec tellement d’« honnêteté » que « personne ne put lui faire le moindre reproche ».
On voit renaître maintenant cette façon de penser : voyez la bonne foi du terrorisme quand il est politique. Et même quand il ne l’est pas. Ce qui est désormais condamné et condamnable, c’est la mauvaise foi, ainsi que Sartre l’a montré. D’où, rétrospectivement, l’horreur inspirée par les sociétés de type victorien ou louis-quatorzième, qui obligeaient le pécheur à pécher en secret.
Les nouvelles pédagogies « morales » croient avoir effacé l’idée de péché. Mais comment effacerait-on ce que l’on porte dans ses gènes, ou encore une fois, pour parler français, dans son âme ? On n’a fait qu’en transformer la définition. Le mot « pécheur » fait ricaner Sartre. Mais que n’a-t-il écrit sur ceux qu’il appelle les « salauds » ? Est-il plus pitoyable envers ses « salauds » que la reine Victoria envers les « pécheurs » ? Un puritanisme chasse l’autre.
Je ne veux pas dire que rien ne change. Il y a une distance infinie entre la « timê » homérique ou marxiste ou freudienne ou sartrienne et l’anxieuse interrogation intérieure de l’amour divin : « Suis-je digne d’amour ou de haine ? » Il n’y a entre eux que la ressemblance de la dérision. Mais cette dérision ne peut cacher les réalités du cœur. Il n’est pas au pouvoir des idéologies de métamorphoser la création.
C’est pourquoi elles la nient, en enseignant que l’homme est tout entier dans ses rapports sociaux, et que hors cela il est « vide ». Ce serait si facile, s’il l’était ! Il suffirait d’un petit livre rouge pour faire un homme nouveau ! Vieux rêve, toujours avorté !
Un éternel désir en nous ne se laisse apaiser par aucun petit livre écrit de main mortelle. Au-delà de la conformité sociale, nous voulons encore être aimés. Nous voulons l’être infiniment, quoique nous-mêmes limités. Nous voulons l’être même seuls, même mourants et abandonnés. Même rejetés socialement. Même pécheurs.
Aimé MICHEL
Chronique n° 264 parue dans F.C.-E. N° 1563 –26 novembre 1976. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, Aldane, Cointrin, 2008 (www.aldane.com), chapitre 11 « Pécheurs, délinquants et criminels », pp. 318-329.
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 4 novembre 2013
Pour aller plus loin :
- Cette distinction a été proposée par l’anthropologue Ruth Benedict à propos du Japon traditionnel dans un livre intitulé Le Chrysanthème et l’épée (1946). Elle a été reprise par l’helléniste E. R. Dodds à propos des Grecs de l’antiquité dans Les Grecs et l’irrationnel (1959, trad. française par M. Gibson, Aubier-Montaigne, Paris, 1965 ; collection Champs, Flammarion, 1977), livre qu’Aimé Michel admirait beaucoup et citait souvent. Elle oppose deux types de civilisations : celles dans lesquelles l’individu ayant commis une transgression se sent personnellement coupable, et celles où il ne ressent qu’un sentiment de honte devant autrui. Dans ce dernier cas « La faute n’est qu’une atteinte aux exigences objectives du conformisme social, mais sans charger d’aucun poids moral le for intérieur de la conscience. » (Charles Baladier, article Culpabilité de l’Encyclopedia Universalis). Dodds décrit dans le chapitre 2 de son livre, intitulé « De “civilisation de honte” à “civilisation de culpabilité” », le passage d’une civilisation de la honte à l’époque homérique, où l’estime publique compte bien plus que la jouissance d’une conscience tranquille, à une civilisation de la culpabilité avec intériorisation de la faute au Ve siècle. Il ajoute en note « Nous sommes nous-mêmes les héritiers d’une “culture de culpabilité” puissante et antique (mais aujourd’hui en son déclin) » (p. 36). Mais déjà des voix s’élèvent en faveur d’une troisième voie, car, selon Jeremy Rifkin (Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Vers une civilisation de l’empathie, Les liens qui libèrent, 2011), la culture de la honte empêche les individus d’éprouver de l’empathie et peut conduire à extérioriser son sentiment d’abandon en déchaînant sa rage sur autrui.
Bien entendu, on ne sera pas surpris d’apprendre que les anthropologues de nos jours rejettent ce type de classification des cultures qu’ils jugent trop sommaire. Cela n’aurait pas gêné Dodds qui ne se sert de ces deux termes que « comme d’étiquettes commodes pour décrire les deux attitudes en question » et « d’une manière descriptive, sans prendre à [son] compte aucune théorie précise de la transformation des civilisations. »
- La formule exacte est : « que nous leur apportons la peste ». [Note de Bertrand Méheust]
Arrivé en vue de Manhattan, le 29 août 1909, Freud appuyé au bastingage, aurait confié à mi-voix ces mots célèbres à Carl Jung. C’était à l’occasion de son premier et seul voyage en Amérique. Il avait été invité, avec Jung et Ferenczi, à participer aux cérémonies du vingtième anniversaire de la fondation de l’université Clark de Worcester dans le Massachusetts. C’est lors de ce voyage, raconté de manière vivante par Ernest Jones dans La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, que se manifestèrent les premiers signes de dissension entre Freud et Jung. La rupture entre les deux hommes résulta de leurs attentes divergentes. Certes, Jung admirait Freud et ses découvertes et trouva en lui la figure paternelle qu’il recherchait et n’avait pas trouvé auprès de Flournoy et Janet (sur Janet voir la chronique n° 148, Janet et la découverte de la conscience – ou comment des découvertes importantes peuvent sombrer dans l’oubli, 22.07.2013), tandis que Freud pensait avoir trouvé en Jung un disciple capable de lui succéder. Mais Freud exigeait que ses disciples acceptent ses théories sans réserve, alors que Jung, qui espérait une collaboration entre égaux, n’accepta jamais la théorie du complexe d’Œdipe et de la libido avancée par son maître (H. F. Ellenberger, Histoire de la découverte de l’inconscient, Fayard, 1994, p. 687).
- Dans cette interview, publiée en novembre 1976 et qui fit grand bruit, Jimmy Carter, alors candidat à la présidence, déclare « J’ai regardé de nombreuses femmes avec désir. J’ai commis de nombreuses fois l’adultère dans mon cœur ». Ces propos lui coûtent presque la présidence ! Une vingtaine d’années plus tard, le 18 août 1998, la confession publique de Bill Clinton sur ses relations avec Monica Lewinsky confirme la remarque d’Aimé Michel.
- Comme souvent quand il cite un maître à penser de l’époque, Aimé Michel se contente d’une référence approximative et dédaigneuse. [Note de Bertrand Méheust].
En réalité cet ouvrage de Michel Foucault, Histoire de la sexualité (Gallimard), ne comporte que trois volumes (La volonté de savoir paru en 1976, L’usage des plaisirs et Le souci de soi parus en 1984). Le premier volume s’intéresse aux interdits, surtout au 19e siècle et les deux suivants aux sources antiques et gréco-romaines où se sont élaborées, selon l’auteur, les formes de notre sexualité.
Michel Foucault (1926-1984) devint dès les années 60 l’un des intellectuels français les plus influents. Il publia successivement une Histoire de la folie à l’âge classique (1961), une Archéologie du savoir (1969), Les Mots et les Choses (1966) etc. En 1970 il fut élu professeur au Collège de France où il occupa la chaire d’histoire des systèmes de pensée. Foucault entendait « affoler » le lecteur et le « décentrer » en lui ôtant ses repères et en multipliant les métaphores. C’est cette volonté de brouiller les cartes dans un vain jeu de miroir et un « style ténébreux » qui explique sans doute en grande partie le rejet d’Aimé Michel, dont la méthode est toute différente.
Dans une chronique précédente La cathédrale engloutie – La culture français ligotée par les cancres et mise au tombeau (07.10.2013), Aimé Michel mettait également dans le même sac Alain Robbe-Grillet, Roland Barthes, Jean-Paul Sartre et Jean Genêt.
- Jean d’Ormesson dans une chronique du Figaro du 8 juillet 1980 (reproduite dans Odeur du temps. Chroniques du temps qui passe, Ed. Héloïse d’Ormesson, 2007), évoque un autre passage à Paris de même tonalité du grand écrivain argentin. « Après Senghor et Sakharov, après Anouilh et Guéhenno, après Konrad Lorenz, Lewis Mumford et beaucoup d’autres qui illustrent tous avec éclat les lettres et les sciences d’aujourd’hui, Jorge Luis Borges vient de se voir attribuer le prix mondial Del Duca pour 1980. Il est venu à Paris pour recevoir cette distinction. (…) Borges n’écoute presque rien. Infiniment courtois, mais perdu dans un rêve intérieur renforcé par la cécité (…) la politique ne l’intéresse pas. Le moins qu’on puisse dire est qu’il n’est pas un homme de gauche. Violemment opposé à la dictature de Perón, il l’attaquait plutôt par la droite. Il n’est pas tout à fait exclu que cette attitude ait plus ou moins contribué à lui fermer la route vers le Nobel. C’est une vieille tradition suédoise, murmure-t-il volontiers, d’ignorer Jorge Luis Borges. Et il ajoute qu’il mourra sans doute favori pour le prochain prix Nobel. S’il lui faut se définir, il se déclare à la fois conservateur et anarchiste : conservateur, parce que le passé est le bien le plus précieux et doit être préservé ; anarchiste, je suppose, parce qu’il ne veut pas qu’on l’embête. A Perón, à Castro, à Brejnev, il préfère Héraclite et Parménide, Stevenson et Kipling. Je crois qu’il déteste l’Etat, la nation, peut-être même – baissons la voix – peut-être même le peuple. En tout cas la masse, qu’il met dans le même sac que l’élite. Il est cosmopolite. (…) Il est partout chez lui. »
Tout ceci est bien résumé par cette déclaration de Jorge Luis Borges que cite Jean d’Ormesson : « Je n’écris pas pour une petite élite dont je n’ai cure, ni pour cette entité platonique adulée qu’on surnomme la masse. Je ne crois pas à ces deux abstractions, chères au démagogue. J’écris pour moi, pour mes amis, et pour adoucir le cours du temps. »
- Selon un sondage publié par l’hebdomadaire Marianne le 23 avril 2001 la situation ne semble guère avoir changé. Interrogé par sondage un an avant les élections présidentielles de 2002 sur leurs intentions de vote au premier tour, les journalistes répondaient dans l’ordre : Lionel Jospin (32%), Noël Mamère (13%), Jean-Pierre Chevènement (8%), Arlette Laguiller (5%), Robert Hue (5%), Jacques Chirac (4%), Alain Madelin (1%), François Bayrou (1%), Jean-Marie Le Pen (0%). Au total 63% étaient à gauche et 6% seulement osaient se déclarer de droite. (Cité par Jean Sévillia : Le terrorisme intellectuel de 1945 à nos jours, Perrin, collection Tempus, 2004, p. 261).