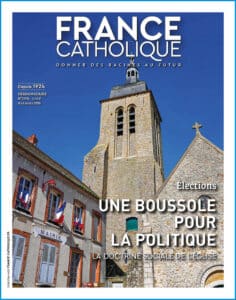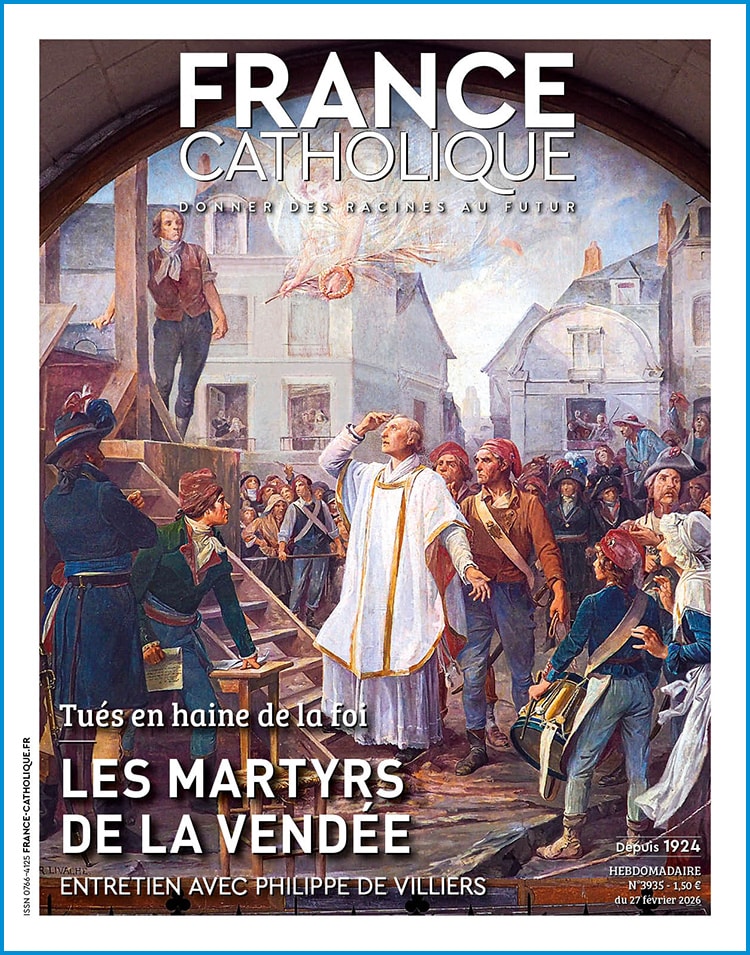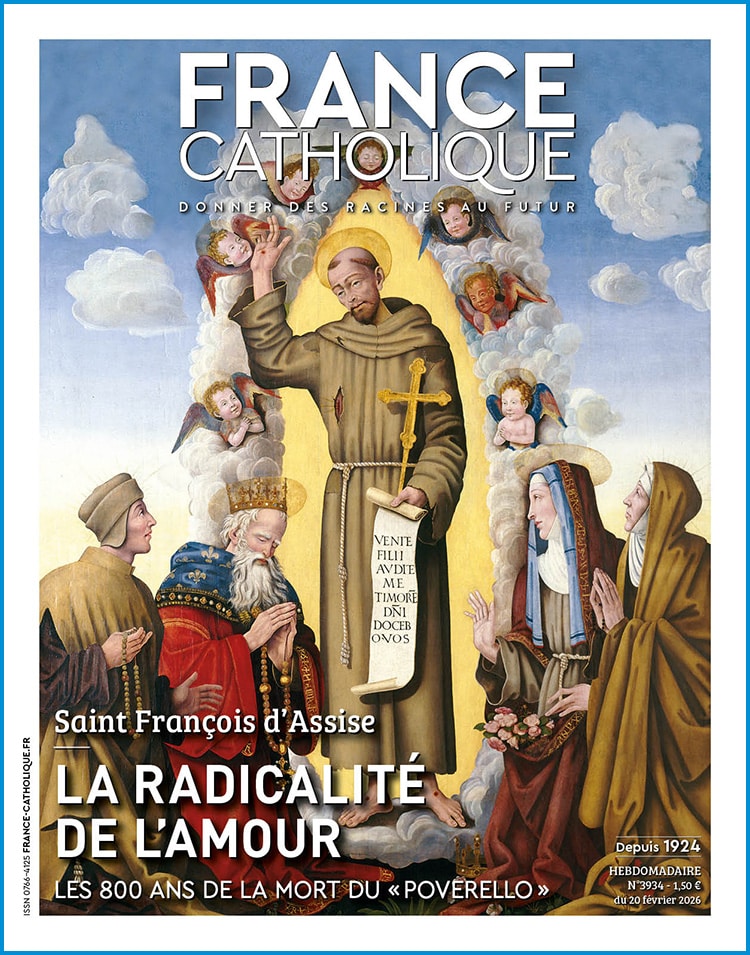Il y a deux ans, chez Lorenz 1, j’avais lu un livre du Pr René Dubos dont le pessimisme raisonné m’avait frappé.
Dubos, rappelons-le, est un éminent biologiste de l’Institut Rockefeller, né en France, émigré aux États-Unis à l’âge de 24 ans, naturalisé Américain, et ayant fait aux États-Unis toute sa carrière scientifique 2. Le livre s’appelait So human an animal (Un animal si humain) et développait l’idée que les futurologues optimistes étaient encore plus lugubres que les pessimistes.
Une incroyable mélancolie
Selon les pessimistes, l’humanité irait tout droit à sa destruction sous les décombres d’un château de cartes technologique promis à l’effondrement : peu après l’an 2000, la planète intégralement transformée en porcherie − air vicié, ciel obscurci par les poussières et les gaz, terre végétale épuisée, océans empoisonnés − retournerait peu à peu (ou soudainement) à son désert originel ; selon les optimistes, l’homme guéri de tous ses maux physiques et délivré de tous ses besoins pourrait enfin se livrer aux activités de l’esprit (on sait que Pauwels a développé cette thèse 3).
Or, disait René Dubos, même si les optimistes ont raison, le monde qu’ils nous promettent est un enfer. Pourquoi ? Parce que l’homme profond n’est pas du tout ce que croit l’homme conscient. A supposer − ce qui, sans être sûr, reste possible − que l’homme conscient réalise tous ses rêves, qu’il se libère de la faim, de la maladie, de la douleur, de la mort même, il lui resterait le désespoir d’avoir perdu sa vraie nature héritée de la préhistoire, du long passé animal vécu au long de millions et de millions d’années, autrement dit de sa création.
Le genre de vie si communément prédit (par les optimistes) pour le XXIe siècle est incroyable au sens étymologique du terme, écrit Dubos, « parce qu’il est incompatible avec les besoins essentiels de la nature humaine. Ces besoins, qui n’ont pas beaucoup changé depuis la fin du paléolithique, et qui ne changeront pas dans un avenir prévisible, définissent les limites au-delà desquelles toute prédiction du futur devient littéralement incroyable ».
Il y a dans l’homme, souligne Dubos, une part essentielle qu’aucune culture ne peut ni effacer ni métamorphoser, et qui est son être même. Observez un lion tout à loisir dans sa brousse. Que fait-il ? Il mange, il dort, il se reproduit. En fait, il dort quatre heures de sa vie sur cinq. Il chasse et se déplace le moins possible. S’il pouvait parler et qu’on l’interrogeât sur ses désirs, il déclarerait sans aucun doute qu’il veut manger à sa faim et dormir.
Or, c’est précisément ce qu’on lui offre dans un zoo, où, néanmoins, il sombre dans une incurable mélancolie.
L’homme peut parler, lui. Et que demande-t-il ? Lisez ses revendications. Et voyez à quoi il occupe son temps. N’est-il pas étrange que les gauchistes se recrutent dans les beaux quartiers ? Le livre de René Dubos vient d’être traduit (a). Publié en Amérique en 1968, et donc écrit avant le grand chahut de mai, il apparaît comme prophétique et va même plus loin dans la compréhension de l’événement que bien des études publiées après.
Dans la révolte des jeunes, montre-t-il, le désœuvrement et la saturation doivent être compris comme des causes non pas occasionnelles, mais bien essentielles : les jeunes gens désœuvrés et saturés ont parfaitement raison d’être mécontents, car l’homme n’est pas fait pour cela. Son être n’a pas été forgé pour le désœuvrement et la satiété, mais pour la difficile poursuite de buts moraux.
Il est vrai que, pendant les siècles sans nombre de la préhistoire, la lutte pour survivre fut un but moral : il s’agissait de sauver ses enfants de la faim, du froid et des bêtes ; de laisser après soi la cellule familiale renouvelée et si possible consolidée et enrichie. Les buts matériels étaient donc aussi des buts moraux. Mais leur adéquation n’a pas survécu à la satisfaction du minimum vital. Désormais, les biens matériels qui nous submergent, tuent l’âme par l’indigestion du corps, l’abondance noie l’âme dans ce que Gabriel Matzneff appelle vigoureusement un océan de m… grisâtre.
On voit ici se préciser la discussion ouverte par la Lettre ouverte aux gens heureux : à Pauwels demandant pourquoi cracher sur les biens de la terre, qui sont bons, Dubos répond que, certes, ils sont bons, mais qu’au-delà des biens, l’animal humain a besoin de la conquête des biens. Il aurait pu citer Pascal remarquant que le joueur acharné aux cartes pour trois écus périrait d’ennui si on lui donnait les trois écus pour prix de ne plus jouer. Aux nantis qui s’ennuient dans la satiété, Pauwels propose la thérapeutique du coup de pied au derrière. Dubos répond que leur ennui prend sa source au plus profond de l’être, et que cet ennui est bon, puisqu’il exprime le besoin d’un dépassement. Pauwels ne nie pas ce besoin. Il l’affirme au contraire (c’est même cette constante de son œuvre qui me mit à ses côtés lors de certaine bagarre, il y a dix ans) 4 .
Mais il pense que c’est affaire personnelle, et que le dépassement doit être trouvé dans la solitude et non demandé à la société.
Nous voici au cœur du débat, car Dubos, biologiste professionnel, croit pouvoir affirmer que l’ardeur de l’homme à se dépasser naît de sa relation, et notamment de sa relation avec la nature. En se climatisant en un zoo créé de ses propres mains, il s’emprisonne et se suicide.
Survivre à la porcherie
Qui a raison ? Faut-il, pour savoir si oui ou non nous sommes malades d’abondance attendre qu’éventuellement nous en crevions ? Je m’étonne que le biologiste Dubos n’ait pas pensé à l’atroce rémission que, même dans ce cas-là, nous pourrons nous accorder à nous-mêmes en nous transformant par la biologie de telle sorte que, même à la porcherie, nous survivions. Je m’étonne, d’ailleurs, que l’on pense si peu et qu’on ne parle jamais de cette dernière conquête en train de mûrir doucement entre nos mains, à. savoir la complète maîtrise de notre code génétique, qui nous fera capables, si nous en décidons ainsi, de nous changer corps et âme, en plus qu’humains, ou en porcs 5
. Car c’est devant ce choix qu’en définitive nous nous acheminons, conformément au plan mystérieux de la vie qui, depuis trois ou quatre milliards d’années qu’elle existe, ne cesse de créer des êtres de plus en plus libres : nous serons bientôt les maîtres, non plus seulement de nos actes, ce qui est la condition de l’homme, mais bien de notre substance, de notre nature. Pour en faire quoi ? Qui donc y pense (b) ?
Aimé MICHEL
(*) Chronique n° 89 parue dans France Catholique − N° 1 324 − 28 avril 1972.
(a) René Dubos : Cet animal si humain (Hachette, 1972).
(b) Il y a quelques erreurs dans Dubos quand il parle de techniques très éloignées de la sienne. Par exemple, il croit que les ordinateurs ont presque atteint leurs limites. Ils ont en fait doublé leurs performances depuis la rédaction de son livre, et les spécialistes ne voient aucune limite à leur développement.
Les Notes de (1) à (4) sont de Jean-Pierre ROSPARS
Pour aller plus loin :
- Konrad Lorenz (1903-1989), prix Nobel en 1973. Voir la chronique n° 10, Le coup de pied de Malebranche − « Cela crie, mais cela ne sent pas », du 4 décembre 1970, parue ici le 27.04.2009. Voir aussi la chronique n° 79, L’importance des premières années − Empreinte et éducation précoce, parue ici le 20.06.2011.
- René Dubos naît le 20 février 1901 à Saint-Brice-sous-Forêt, aujourd’hui dans le Val-d’Oise. Ingénieur de l’Institut National Agronomique (aujourd’hui AgroParisTech), il quitte la France pour l’Italie puis les États-Unis où il s’installe en 1924. Devenu citoyen américain en 1938, il meurt à New York le 20 février 1982. « Tout au long de sa carrière, successivement agronome, microbiologiste du sol, biochimiste des bactéries s’attaquant à l’homme, spécialiste des problèmes de la tuberculose, puis des problèmes généraux de la santé, enfin environnementaliste de renommée mondiale, prix Pulitzer de littérature, René Dubos a fait partie de ces individus, non pas secrets mais discrets, qui, comme il le disait lui-même, “appartiennent à cette cohorte à laquelle on ne dresse pas de statues, mais qui servent à hisser vers les sommets ceux qui aiment cueillir les lauriers de la gloire”.
René Dubos (…) a connu des épisodes glorieux au cours de son existence. Mais si ce qu’il a fait est très largement oublié aujourd’hui, c’est qu’il n’a jamais songé à entretenir sa gloire. Il n’était d’aucun clan. Il mettait un point d’honneur à faire cesser très rapidement les manifestations d’enthousiasme qui succédaient à ses nombreux exploits. “Ça le gênait pour travailler” (sic). » (Jean-Paul Escande, « Qui a découvert les antibiotiques », Encyclopédie de l’Agora, www.agora.qc.ca).
Le plus grand de ces exploits et le plus méconnu fut en effet la découverte des antibiotiques. Dans ce même article précis et bien documenté, le médecin Jean-Paul Escande, ami de René Dubos, bien connu du grand public pour ses nombreux ouvrages et interventions dans les médias, montre que la version « officielle » de la découverte des antibiotiques est une légende.
Selon cette version, en 1929, Alexander Fleming « dans le désintérêt général qui entoure souvent les travaux d’un génie méconnu, démontre sans contestation possible, l’action de la pénicilline » puis, en 1940, Howard Florey et son équipe, à Oxford, parviennent à purifier la pénicilline et à en confirmer les avantages exceptionnels. En fait, Fleming s’il a bien découvert qu’une moisissure, le Penicillium notatum, produisait un « jus » capable de détruire certaines bactéries en culture, fut « incapable d’extraire quoi que ce soit de sa soupe de Penicillium et d’ailleurs il n’y croyait pas. » Et ce fut bien Florey, l’Australien taciturne, qui, avec l’aide du biochimiste Ernst Boris Chain, jeune Juif réfugié de Berlin, parvint à isoler le principe actif de ce « jus ».
Alors, point de Dubos ? En réalité, ce dernier, passé maître dans l’art d’extraire des substances actives des bactéries, est engagé en 1927 par Oswald Theodore Avery à l’Institut Rockefeller de New York, « un des hommes les plus puissants de l’Institut de recherche le plus célèbre du monde ». En septembre 1939, au congrès international de microbiologie à New York, Dubos présente des résultats que le New York Times du 9 septembre rapporte en ces termes : « Un savant de Rockefeller annonce la découverte d’un destructeur de germe très puissant. Les tests sont conduits seulement sur des animaux. Le médicament, extrait d’un bacille du sol, ouvre un nouveau champ de recherche ». Dubos vient d’isoler le premier antibiotique, la gramicidine, qui est capable de détruire à dose infime toutes les bactéries dites Gram positives (d’où son nom). Il dépose un brevet. « Il est impossible, écrit Escande, à la lecture de ce document et des travaux publiés par Dubos, de lui contester la paternité totale de la découverte des antibiotiques. C’est lui qui a créé le concept d’antibiotique et accouché du premier d’entre eux ».
Que s’est-il passé ? Florey a repris les études de Dubos, qu’il admire, mais avec le Penicilium de Fleming. En quelques mois, lui et ses collègues, parviennent à extraire la pénicilline du « jus » et publient leur découverte dans le Lancet en mai 1940. En 1945, Fleming, Chain et Florey se partagent le prix Nobel. Florey devait déclarer plus tard : « J’ai deux regrets dans ma vie : d’abord que l’on ait tellement dit qu’il y avait des dissensions au sein de l’équipe pénicilline. Ensuite, de ne pas avoir reçu le prix Nobel avec Dubos pour ses travaux préalables aux nôtres. »
Plusieurs circonstances expliquent l’oubli de Dubos. L’illustre Almroth Wright, patron de Fleming, monta au créneau pour défendre son élève « qui, sans rien dire, accepta les hommages. (…) Dubos, pour des raisons personnelles que je ne veux pas détailler, se taisait. Florey s’énervait un peu de voir, et Chain et Fleming, tirer la couverture à eux. Mais Florey se taisait. Par nature. Ces deux silences ont peut-être une autre explication ; les savants purs ont souvent cette certitude que l’histoire rectifiera. Ils veulent croire que la gloire contemporaine indue ne vaut pas la reconnaissance posthume. Une véritable renaissance. Après tout, il vaut mieux avoir été Galilée que ses inquisiteurs. La gloire, souvent, est mauvaise fille. Mais après s’être trompée longuement, elle sait, parfois rectifier. Pour le tandem Florey-Dubos, il faut espérer. »
Cette ingratitude fréquente de l’histoire à l’égard de ceux qui la font n’est certainement pas propre à la science. Peut-être est-elle simplement plus facile à mettre en évidence dans ce domaine en raison des documents précis et datés que l’activité scientifique génère ?
- Dans sa Lettre ouverte aux gens heureux et qui ont bien raison de l’être (Albin-Michel, Paris, 1972), Louis Pauwels, suivant son habitude, défend le monde moderne et dit « sa fierté de vivre aujourd’hui et d’être d’Occident ». « Il n’est pas vrai, écrit-il, que notre civilisation est inhumaine. Il n’est pas vrai que le progrès est catastrophique. Il n’est pas vrai que notre société est invivable. Aliénation, population, surpopulation, sont des mythes. La grande injustice faite au Tiers Monde est aussi un mythe. Bien entendu, il y a des dangers, des accidents, des problèmes. La navigation est difficile ? Oui, mais permettez : je ne fais pas confiance aux gens qui, à propos de la mer, ne me parlent que du mal de mer. (…) Persuader les hommes qu’ils sont malheureux est une action infâme. C’est une tâche sacrée que de répéter à l’homme qu’il est heureux et qu’il ne s’agit pour lui que de s’en rendre compte. »
- « Il y a dix ans », c’était le début des années 60. Louis Pauwels et quelques amis lancent le premier numéro de la revue Planète. Le premier numéro, tiré à 8000 exemplaires, sort en octobre-novembre 1961 et rencontre un succès immédiat et deux rééditions porteront son tirage à 80 000 exemplaires. Quarante-et-un autres numéros suivront jusqu’en juillet-août 1968 et des éditions dans d’autres pays européens. Ce succès provoquera bien des réactions, les plus voyantes étant négatives. Citons les critiques rassemblées dans Le Crépuscule des Magiciens, édité par l’Union Rationaliste en 1965 (« Contre Planète, la bataille est engagée, y écrit l’astrophysicien Evry Schatzman. Force doit rester à la Raison »), celle de Robert Escarpit dans Le Monde (« des malheureux qui, dans un univers où ils s’ennuient, font des efforts pathétiques pour donner un goût étrange et rare à la plate réalité quotidienne »), ou celle plus surprenante d’Umberto Eco en 1964 (« Planète est devenue en France – ici je ne sais pas encore – un phénomène de masse ; et donc elle n’est plus un stimulant pour les raffinés »).
Aimé Michel fait paraître son premier article « Voltaire, contemporain de l’ère cosmique » dans le n° 3 et il signe l’éditorial du dernier numéro « Le vaisseau fantôme » qui est un condensé de ses thèmes de réflexion de l’époque. Pour une analyse de ce moment important de l’histoire culturelle française on lira avec profit le mémoire de Grégory Gutierez, Le discours du réalisme fantastique : la revue Planète (Mémoire de maîtrise de Lettres modernes spécialisées, Université Paris IV Sorbonne, 1998, disponible sur http://greguti.free.fr/litt/gutierez-planete.pdf).
- Voir la chronique n° 91, La fin de la nature humaine ? − Un avenir impensable : l’homme va changer de nature et devenir un autre être du 12 mai 1972, parue ici le 26 septembre 2011.