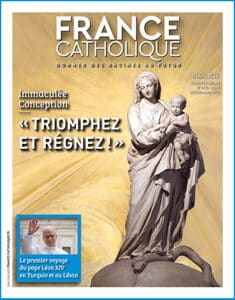Dans ses Lettres écrites de la montagne contre ses censeurs de l’Église calviniste de Genève, J.-J. Rousseau propose un autre type de raisonnement qui, moins vertigineux 1, m’a toujours frappé par son bon sens. Il se fonde en effet non sur ce que nous croyons savoir, mais sur nos ignorances. « Vous dites, écrit-il en substance (je résume son argumentation), qu’un miracle est une suspension des lois de la nature ; si c’est cela que vous appelez un miracle, vous vous mettez dans la position de ne jamais reconnaître un miracle quand il se produit ; car pour dire que la nature ne peut produire ceci ou cela, il faut que vous connaissiez toutes les lois de la nature. » 2
Prenant dans Rousseau ce que j’y trouve de bon et laissant le reste (car l’arrière-pensée de Rousseau était l’absurdité de l’idée même de miracle), je dirai qu’il existe peut-être des choses impossibles, mais qu’on ne sait pas lesquelles et qu’on ne le saura jamais. Car pour pouvoir décider que telle chose est impossible, il faudrait que l’on ait préalablement fait le tour de tous les secrets de l’univers et qu’on n’y ait pas trouvé la chose cherchée (je parle ici, bien entendu, de faits matériels, se produisant dans l’espace-temps, non d’impossibilités abstraites telles qu’un triangle n’ayant que deux côtés ou qu’une droite coupant un cercle en plus de deux points dans un plan euclidien, ou telle encore que le fait de trouver le mot « lundi » dans la liste des mois).
Une démarche difficile
Il me semble donc que la science est incapable de décider si tel événement imaginaire que l’on voudra est ou non possible dans le cadre des faits naturels, je ne vois pas comment échapper à cette conclusion tant qu’on ne connaîtra pas la dernière virgule de la dernière des lois naturelles : mais précisément, qui peut, qui pourra jamais se flatter d’une telle connaissance ?
Donc (me semble-t-il) même les plus inconcevables chimères, de celles qui révoltent le plus notre raison, sont peut-être réalisables dans le cadre de la nature. Certes, ce raisonnement, sagement tiré de l’immensité de nos ignorances, ne saurait prouver que telle ou telle rêverie de notre imagination est réellement possible, mais seulement qu’elle l’est peut-être. Dès lors nous devons admettre la possibilité du mystère naturel. Et du fait qu’il est possible, nous devons, par le principe de prudence qui requiert de toujours prévoir le pire, raisonner comme s’il était vraiment.
Vous donnez donc raison à Rousseau, me dira-t-on peut-être ici, vous en arrivez à dire qu’aucun fait ne peut être déclaré miraculeux ! Pas du tout. Cette conclusion implicite que Rousseau met malicieusement dans l’esprit de son lecteur en se gardant de l’exprimer constitue au contraire la faille de son raisonnement. Car il ne suffit pas qu’une chose soit possible dans le cadre des lois naturelles pour qu’elle se produise naturellement !
Voici une question brûlante que me pose un lecteur (M. H. B…, de Tournan-en-Brie) : existe-t-il des mystères naturels ? Existe-t-il des faits se produisant dans la nature par le simple jeu de ses lois et qui cependant seraient, par leur nature même, à jamais incompréhensibles à l’intelligence humaine ?
Une telle question brûle, si je peux dire, par tous les bouts, qu’on l’aborde par la démarche naturelle de la science, ou par celle de la pure logique, ou qu’on en examine les possibles implications religieuses.
Commençons par la logique. C’est, à ma connaissance, le mathématicien autrichien Kurt Gödel qui a donné à cette question la réponse la plus profonde. En 1931 (il avait vingt-cinq ans à peine, l’âge des grandes découvertes mathématiques) Gödel montrait dans deux théorèmes célèbres que, quelque formulation que l’on puisse imaginer de la syntaxe arithmétique, celle-ci comporterait toujours des énoncés « indécidables », c’est-à-dire dont on ne peut prouver qu’ils sont soit démontrables, soit réfutables.
La démarche de Gödel est difficile, d’une redoutable abstraction. Ce que j’en dis ici n’est qu’une grossière traduction, et je ne me hasarderai pas à la préciser davantage. Mais les théorèmes de Gödel me semblent avoir une implication philosophique sans appel : ils sapent le fondement même de l’explication scientifique, si l’on entend par explication l’élucidation totale 3]. Car le maximum que puisse espérer la science, son ambition ultime, c’est le projet pythagoricien de traduire toutes choses en une formulation arithmétique. Or, premièrement, rien ne nous dit que ce projet soit réalisable ; et deuxièmement, même supposé réalisé, il restera toujours que l’arithmétique elle-même doit être acceptée depuis 1931 (contrairement à ce qu’avaient espéré Hilbert et Bertrand Russel) comme une structure comportant des énoncés dont on ne peut pas prouver la non-contradiction interne.
Je ne m’avancerai pas davantage dans cette discussion difficile de crainte de dire des sottises 4. La conclusion ci-dessus me semble inéluctable, je l’ai souvent formulée devant des mathématiciens qui l’ont toujours acceptée comme allant de soi, mais enfin, peut-être s’en trouvera-t-il d’autres pour penser autrement : je ne me sens pas de taille à les réfuter, s’ils existent.
Cette conclusion est qu’il ne peut exister d’explication scientifique ultime. La science ne peut aspirer, au plus, qu’à énoncer des lois partielles et limitées. Le mystère naturel existera donc toujours, quoi qu’on fasse.
Descendons de ces hauteurs où, je l’avoue, une vieille méfiance des abstractions m’incline à douter de tout, y compris des évidences les plus aveuglantes (c’est le mot).
La tête parlante en 1608
Une bicyclette, un fer à repasser, une clarinette n’ont rien, que je sache, de miraculeux. Ces trois estimables ustensiles ne témoignent assurément de la « suspension » d’aucune loi naturelle ! Pourtant, même le douteur le plus décidé voudra bien, je pense, reconnaître que si je fais apparaître une bicyclette sur un simple claquement de doigts, c’est que j’en sais plus sur les lois naturelles qu’aucune science actuellement existante, ou bien que je suis un grand magicien. Dans les deux cas, mon claquement de doigts aux surprenants effets témoigne que j’ai accès à une source de connaissance qui n’est pas la science, quoique le résultat de mon geste soit en tout conforme à la science la plus banale.
Dans sa fameuse lettre écrite de Rome le 28 février 1608 à son protecteur, M. de Cornet, saint Vincent de Paul rapporte qu’il a construit un « ressort artificiel pour faire parler une tête de mort » et plusieurs autres objets aussi extraordinaires qui ont été montrés à « Sa Sainteté et aux cardinaux » par l’ancien vice-légat du Pape à Avignon 5.
Je ne sais que penser de cette tête parlante, mais deux choses sont certaines : d’abord, que Charles Cros et Edison la construisirent à leur tour deux siècles et demi plus tard avec des matériaux qui (sauf erreur) existaient tous en 1608 ; mais aussi que les principes d’acoustique utilisés par les deux inventeurs du phonographe n’étaient pas encore connus du temps du saint. Ce n’est pas la « tête parlante » qu’il faut expliquer : tout le monde, en 1973, sait la faire ; c’est qu’on l’ait su en 1608.
Aimé MICHEL
Les notes de (1) à (5) sont de Jean-Pierre Rospars
(*) Chronique n° 160 parue dans F.C. – N° 1404 – 9 novembre 1973. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, chap. 23 « Prodiges et miracles », pp. 584-587.
Pour aller plus loin :
- Semble poursuivre une réflexion commencée dans la chronique précédente, ce qui n’est pas le cas ; la chronique précédente du 2 novembre (n° 159, Doutes et balivernes) est une réflexion sur la vulgarisation scientifique, celle du 26 octobre porte sur L’hérédité du génie (n° 158, chapitre 7, p. 208). L’argument de Rousseau est évoqué dans Superstition de notre temps (La clarté, chap. 19, p. 499) et La Bible confrontée aux affirmations de la science (chap. 26, p. 665 et F.-C. du 27 mars 2009).
- Rousseau a rédigé ces lettres entre 1763 et 1764, à l’âge de 51 ans, à Môtiers près de Neuchâtel, en réponse aux Lettres écrites de la campagne du Procureur Général de Genève, Jean-Robert Tronchin (mais leurs titres évoquent également le Sermon sur la montagne). L’argumentation de Rousseau relevée par Aimé Michel se trouve dans la troisième des neuf lettres. En voici quelques extraits (on peut en lire l’intégralité par exemple sur
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/rousseau_lettres_de_la_montagne.pdf) :
« Je reprends mon raisonnement, et après avoir établi que les miracles ne sont pas un signe nécessaire à la foi, je vais montrer en confirmation de cela que les miracles ne sont pas un signe infaillible et dont les hommes puissent juger.
Un miracle est, dans un fait particulier, un acte immédiat de la puissance divine, un changement sensible dans l’ordre de la nature, une exception réelle et visible à ses lois. Voilà l’idée dont il ne faut pas s’écarter si l’on veut s’entendre en raisonnant sur cette matière. (…)
Puisqu’un miracle est une exception aux lois de la nature, pour en juger, il faut connaître ces lois, et pour en juger sûrement il faut les connaître toutes, car une seule qu’on ne connaîtrait pas pourrait en certains cas inconnus aux spectateurs changer l’effet de celles qu’on connaîtrait. Ainsi celui qui prononce qu’un tel ou tel acte est un miracle déclare qu’il connaît toutes les lois de la nature et qu’il sait que cet acte en est une exception.
Mais quel est ce mortel qui connaît toutes les lois de la nature ? Newton ne se vantait pas de les connaître. Un homme sage témoin d’un fait inouï peut attester qu’il a vu ce fait et l’on peut le croire ; mais ni cet homme sage, ni nul autre homme sage sur la terre n’affirmera jamais que ce fait, quelque étonnant qu’il puisse être, soit un miracle, car comment peut-il le savoir ?
Si dans le sein même des arts, des sciences, des collèges, des académies ; si dans le milieu de l’Europe, en France, en Angleterre, un homme fut venu le siècle dernier, armé de tous les miracles de l’électricité que nos physiciens opèrent aujourd’hui, l’eût-on brûlé comme un sorcier, l’eût-on suivi comme un prophète ? Il est à présumer qu’on eût fait l’un ou l’autre : il, est certain qu’on aurait eu tort.Les miracles sont, comme j’ai dit, les preuves des simples pour qui les lois de la nature forment un cercle très étroit autour d’eux. Mais la sphère s’étend à mesure que les hommes s’instruisent et qu’ils sentent combien il leur reste encore à savoir. Le grand physicien voit si loin les bornes de cette sphère qu’il ne saurait discerner un miracle au-delà. Cela ne se peut est un mot qui sort rarement de la bouche des sages ; ils disent plus fréquemment, je ne sais. Que devons-nous donc penser de tant de miracles rapportés par des auteurs, véridiques, je n’en doute pas, mais d’une si crasse ignorance, et si pleins d’ardeur pour la gloire de leur maître ? Faut-il rejeter tous ces faits ? Non. Faut-il tous les admettre ? je l’ignore. »
- S’il avait entendu parler de Cornelius Castoriadis, Aimé Michel l’aurait sans doute admiré. Ce philosophe, encore très peu connu dans les années soixante-dix et quatre-vingt, était en effet animé par un effort intense pour saisir le réel dans toutes ses dimensions, et rejetait le jargon de la philosophie à la mode. Il constituait une remarquable exception à la tendance jargonneuse, pédantesque, et logocentrique qui animait alors la philosophie française, et il avait des sciences une connaissance profonde qui eût attiré le respect de l’ermite de Saint-Vincent. Mais par ailleurs l’antichristianisme de Castoriadis lui eût causé problème. Pour nous en tenir au théorème de Gödel, Castoriadis a écrit à propos de sa célèbre démonstration qu’elle constituait « une catastrophe totale et irrémédiable » (Les carrefours du labyrinthe, le Seuil, 1978, p. 154.) [Note de Bertrand Méheust
- On comprend la prudence d’Aimé Michel : on a tant parlé à tort et à travers du théorème de Gödel. On en trouvera une excellente présentation dans le livre de Roger Penrose, Les ombres de l’esprit, trad. par F. Balibar, InterÉditions, 1995.
- Deux années auparavant Aimé Michel avait fait inséré l’appel suivant : « P.-S. – Aimé Michel est à la recherche de toute bibliographie sur saint Vincent de Paul, et spécialement ses années de jeunesse. » (voir chronique n° 61 du 5 novembre 1971, La méthode globale en question, parue ici le 22.03.2010). Quelques semaines plus tard il avait consacré tout un article à cet illustre personnage dans une revue anglaise: « An enigmatic figure of the XVIIth century » (Flying Saucer Review, 18, 2, 1972, voir aussi « Postscript on Monsieur Vincent », F.S.R. 18, 4, 1972). Résumons l’affaire à grands traits. En mai 1605, le futur saint Vincent de Paul (1579-1660), personnage historique hors du commun par l’intelligence, l’humilité et la bonté, encore jeune et inconnu, est fait, selon ses dires, prisonnier par les Turcs lors d’une traversée de Marseille à Narbonne. Débarqué à Tunis, il est l’esclave de trois maîtres. Le second est un vieil alchimiste « médecin spagirique, souverain tireur de quintessence, homme fort humain et traitable » et le troisième, un chrétien « rénégat » qui, pris de remord, l’aide à s’enfuir. Revenu en France le 28 juin 1607, ils vont tous deux à Avignon auprès du vice-légat du pape. Et immédiatement ce dernier accompagne les deux hommes à Rome pour voir le pape Paul V. À Avignon et à Rome (je cite ici Aimé Michel) « devant le vice-légat et devant le pape et les cardinaux, M. Vincent, selon ce qu’on dit ces témoins, a montré des machines qui étaient incompréhensibles, l’une d’elle avait la forme d’une tête avec buste et parlait. La machine, dirent-ils, avait effectivement parlé devant toute cette audience d’hommes instruits et sceptiques. Le secret de son fonctionnement (ou de son origine) avait, semble-t-il été donné en confidence seulement aux plus hautes autorités. » A la fin de 1608, Vincent est envoyé en mission à Paris et on ne sait rien de cette mission sinon qu’elle fut secrète.
Là s’arrête le récit biographique d’Aimé Michel mais commence sa discussion. À ses yeux la captivité à Tunis n’est qu’un plagiat du « Prisonnier d’Alger » de Cervantès dont la première édition de Don Quichotte à Madrid date de 1605. Il précise que l’idée n’est pas de lui mais d’un frère lazariste, c’est-à-dire d’un membre de la congrégation fondée par saint Vincent de Paul en 1625, qui lui écrivit à la suite d’un article où il se demandait si les rosicruciens n’avaient pas eu une forte influence sur les fondateurs de la science expérimentale. Selon le Lazariste, cette histoire aurait pu servir de couverture a posteriori pour une mission confiée à Vincent par ses supérieurs : enquêter en divers lieux d’Europe où se trouvaient des rosicruciens influents, instruits et intelligents mais obligés à la discrétion et à la prudence en raison de l’intolérance de l’époque. D’où ces connaissances et cette tête parlante qui auraient assurées son succès à Avignon et à Rome. « Avec ou sans machine parlante, poursuit Aimé Michel, la personnalité et les exploits de M. Vincent méritent toute notre attention. Sa disparition de deux ans reste une énigme, les explications suspectes qu’il en donne ; son savoir et ses connaissances ; l’essor absolument improbable de sa vie dès son retour, à une époque de l’histoire où seuls les hommes d’origine noble ou bourgeoise avait une chance de faire quoi que ce soit ou d’approcher les grands de ce monde – toute l’affaire est énigmatique et laisse perplexe. »
Malencontreusement, comme la lettre de son correspondant ne parlait que de Saint Vincent de Paul (« un personnage auquel j’étais tout à fait certain de ne jamais m’intéresser » écrit-il), il la jeta après y avoir répondu, perdant du même coup toutes les références précises qu’elle contenait ainsi que le nom de son érudit correspondant, et l’obligeant à le citer de mémoire…
Que faut-il penser de la captivité à Tunis et de la tête parlante ? Disons d’emblée qu’il ne s’agit pas de récits apocryphes : les deux lettres de M. Vincent qui en font état, signées par leur auteur, ont été conservées jusqu’à nos jours. Un large extrait de la première, écrite le 24 juillet 1607 à Avignon, a été publiée par son biographe Louis Abelly en 1664 (voir en livre Google, La vie de Saint Vincent de Paul, tome premier, chap. IV, pp. 25-28 ou bien http://s2.e-monsite.com/2010/03/20/84828292saint-vincent-en-esclavage-pdf.pdf).
L’historicité de ce récit passionnant aux évidentes qualités littéraires, dont je recommande la lecture car rien ne remplace le contact direct avec les textes originaux, est depuis bientôt un siècle l’objet d’une vive controverse. Elle a commencé avec le père Pierre Coste qui soutenait l’historicité en public mais la dénigrait en privé et sous couvert d’anonymat. Antoine Redier, en 1927, pensait que « le faux y est évidemment mêlé avec le vrai » (La vraie vie de Saint Vincent de Paul, Paris 1947, p. 24). Pierre Grandchamp, spécialiste de l’histoire de la présence française en Tunisie, concluait en 1928 que l’on pouvait « nier avec suffisamment de certitude l’esclavage et le voyage en Barbarie » (voir Les Cahiers de Tunisie, n° 49-52, 1965, p. 51-84). Cette position fut critiquée par le Lazariste J. Guichard (Saint Vincent de Paul esclave à Tunis. Étude historique et critique, Paris, 1937). Plus récemment André Dodin fut également critique (Saint Vincent de Paul et la Charité, Paris, 1960, p. 144-168), tandis que Guy Turbet-Delof contredit point par point la thèse de Grandchamp (Saint Vincent de Paul et la Barbarie en 1657-1658. Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 1967, vol. 3, n° 3, pp. 153-165 ; Saint Vincent de Paul a-t-il été esclave à Tunis ? Revue d’histoire de l’Église de France, vol. 58, n° 161, 1972, pp. 331-340 ; ces deux derniers articles sont disponibles sur http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1967_num_3_1_948 et http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhef_0300-9505_1972_num_58_161_1780.
Quant à la tête parlante, n’ayant pu consulter les textes originaux qui en font état, je ne peux juger de leur caractère intriguant. Abelly en dit peu de choses. Il vante simplement « la vertu extraordinaire de M. Vincent à retenir et supprimer en lui toutes les connaissances que ce médecin spagirique lui avait communiquées de divers beaux secrets de la nature et de l’art, dont il lui avait vu faire des expériences merveilleuses durant une année qu’il fut à son service, comme lui-même en témoigne dans la suite de cette lettre à M. de Commet, dont nous avons rapporté seulement un extrait, et dans une autre qu’il lui écrivit après son arrivée à Rome [datée du 28 février 1608] » (op. cit., p. 29). Ces secrets d’alchimiste n’étaient selon Guichard que d’« innocents tours de magie blanche ». Ils servent d’argument négatif à Pierre Grandchamp car « il est incroyable qu’en 1607 un alchimiste tunisien anonyme ait découvert la transmutation des métaux et ait inventé le phonographe trois siècles avant Édison. » Ce à quoi J. M. Román répond : « C’est une objection d’une incroyable ingénuité, bien que ce soit le P. Coste qui l’ait proposée. Il saute aux yeux que Vincent se réfère à des trucs ou des tours propres à un prestidigitateur ou un ventriloque ; de tels trucs apparaissent dans d’autres histoires d’esclaves, contemporaines de celle de Vincent. » (Román, José María : Saint Vincent de Paul. Biographie, 1981, trad. par A. Sylvestre, J. Vilbas, et J.-M. Lesbats. Disponible sur famvin.org/fr/fondateurs%20histoire/aECRITSenPDF/ROMAN_SV.DOC).
Mais un « tour de ventriloque » aurait-il suffit à impressionner le vice-légat ? André Frossard n’est pas loin de le penser qui dresse un portrait plaisant du protecteur de M. Vincent : « Monsignore le vice-légat du pape, dévoré de curiosité scientifique et passionné de cuisine philosophale, ne se lassait pas d’écouter son agréable compagnon lui parler recettes médicales, transmutations, géométrie et têtes de mort ventriloques. (…) Le soir, il versait la science barbaresque dans l’oreille de Monseigneur, heureux comme un enfant (…) » (Votre très humble serviteur Vincent Depaul, Bloud et Gay, 1960). Selon Frossard toujours, l’alchimiste « faisait parler les têtes de mort au moyen d’un ingénieux dispositif mécanique », ce qui ne nous avance guère.
A défaut d’éclairer ces énigmes historiques, je pense en avoir résolu une plus modeste : l’identité du correspondant lazariste d’Aimé Michel dont il regrettait tant de n’avoir pas noté le nom ni retrouvé la trace par la suite. Il s’agit très probablement d’André Dodin, doyen honoraire de la Faculté de théologie de l’Université catholique de l’Ouest, membre de la Compagnie de la Mission, spécialiste connu de Vincent de Paul et auteur entre autres d’un livre très critique à l’égard d’Abelly, La Légende et l’histoire. De Monsieur Depaul à Saint Vincent de Paul (O.E.I.L., Paris, 1985, 216 pp.).
L’hypothèse du plagiat de Cervantès proposée par Dodin n’est guère prise au sérieux par G. Turbet-Delof qui s’exclame : « Le chanoine Dodin va jusqu’à supposer que Vincent de Paul aurait lu Don Quichotte dans une des toutes premières éditions espagnoles ! » (note 29, p. 339 de son article de 1972) mais sans expliquer pourquoi l’hypothèse lui paraît à ce point irrecevable (notons au passage que Vincent fut quelques mois étudiant à Saragosse au cours de ses années universitaires entre 1597 et 1604). Comme quoi il est peu de points sur lesquels ces auteurs sont prêts à s’accorder ! Je me garderai donc bien de conclure jusqu’à plus ample informé. D’ailleurs, est-il nécessaire de les résoudre pour goûter la saveur de ces énigmes et l’érudition des historiens qui les mettent en valeur ?