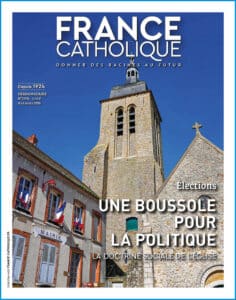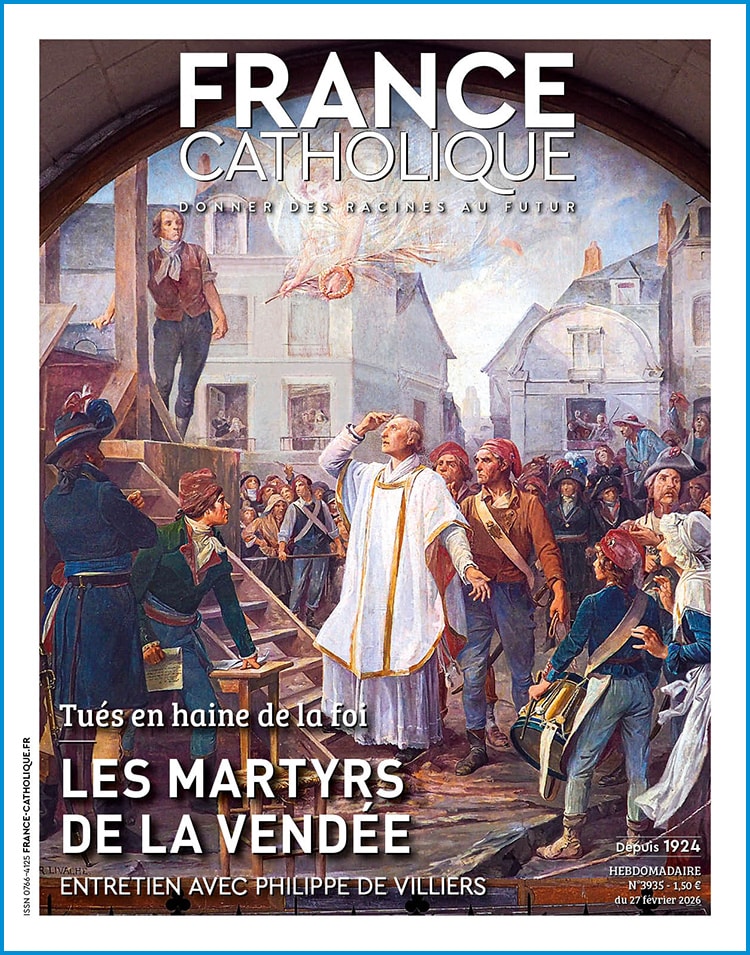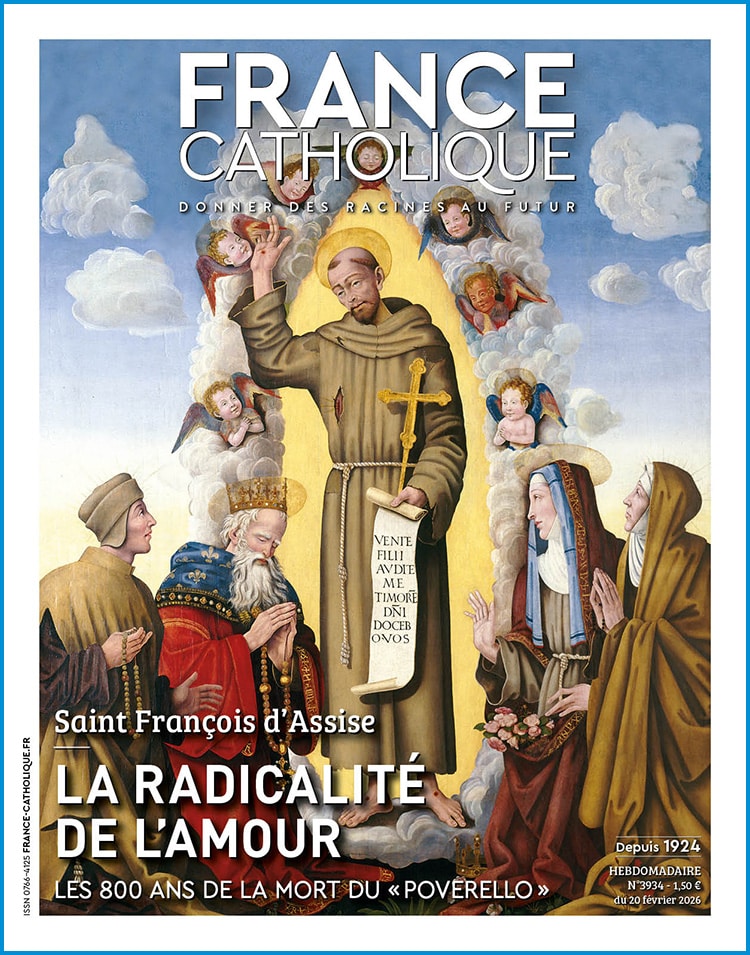Comme on pouvait s’y attendre, mes chroniques sur la science des rêves et de l’inconscient 1 commencent à susciter des lettres. Tous, nous sentons que notre vie inconsciente est au cœur de notre être, que c’est elle qui détermine notre spontanéité, nos inclinations, nos répulsions, que d’elle monte sans cesse le mystérieux pullulement de nos pensées et de nos sentiments. Et comme cette vie inconsciente est par définition inaccessible à notre regard intérieur, toute découverte la concernant est, par là même, passionnante. Objection d’un lecteur (médecin, je crois) : cette science expérimentale qui (ai-je dit) est en train de remplacer la psychanalyse ne remplace rien du tout, car elle n’atteint notre réalité intérieure que de l’extérieur ; elle laisse donc sa place légitime à une science non expérimentale, purement descriptive, que le praticien exerce par le biais de l’interrogatoire ; le patient raconte son histoire ; et le médecin le soulage en décryptant ses problèmes intérieurs.
La connaissance par l’empirisme
Si notre lecteur a cru comprendre que la physiologie du cerveau est appelée à remplacer le praticien, je me suis mal exprimé. La médecine est un art qui utilise les résultats de toutes les sciences, y compris la psychologie. Rien ne remplacera de sitôt le médecin. On parle, certes, de l’ordinateur. Il est même utilisé dans quelques hôpitaux, surtout aux États-Unis et en Suède. Mais quand il sera en mesure de vraiment remplacer le médecin, qui donc ne remplacera-t-il pas ? Nous n’en serons pas là avant au moins la fin du siècle.
Mais si notre lecteur veut dire qu’il peut exister des sciences non expérimentales, je crois que – leur place étant bien entendu réservée aux mathématiques – il se trompe. Il cite l’astronomie qui, dit-il, étudie les astres sans pouvoir – « et pour cause » – expérimenter sur eux, et donc se borne à les décrire. Eh oui, elle décrit les astres : mais elle ne le fait qu’en expérimentant sur la lumière que les astres nous envoient. C’est même l’astronomie qui, avec la physique des particules, mobilise actuellement les plus énormes dispositifs expérimentaux, et peut-être les plus raffinés, télescopes et antennes géantes, photomètres, polarimètres, spectrographes, appareils électroniques variés, etc.
Il n’y a plus, en cette fin de XXe siècle, de science que dans et par l’expérience et la mesure. Même les historiens utilisent toutes sortes de techniques pour étudier ce passé 2qui, nous rappelait récemment Gustave Thibon, est seul à échapper à toute atteinte (F.C. du 11 février).
Certains s’effraient de cet empirisme généralisé. Ils y voient une sorte de mépris matérialiste envers la pensée, sinon même envers l’esprit. On me permettra d’avancer un avis exactement opposé.
D’abord, parce que nulle activité ne requiert plus d’intelligence, d’imagination, de patience, de volonté, d’esprit critique, de réalisme que l’élaboration d’une expérience, surtout quand, comme c’est maintenant le cas, le but recherché devient de plus en plus compliqué à mesure qu’avancent nos connaissances. La spéculation pure « pardonne », comme on dit en parlant des voitures qui s’accommodent des erreurs de conduite, elle pardonne infiniment plus que l’expérience, qui ne pardonne rien. Une erreur de raisonnement peut passer inaperçue pendant des siècles (par exemple l’objection opposée par Lactance à la théorie des antipodes et que tout le Moyen Âge crut sans réplique : de l’autre côté, disait-il, « la pluie tomberait vers le haut »).
Ces contradictions des philosophes, qu’aucune discussion ne parvient jamais à résoudre de façon contraignante pour l’adversaire, ne montrent-elles pas, elles aussi, l’incertitude de la spéculation laissée à elle-même ? Au lieu qu’une expérience ratée se réfute par son seul échec.
Mais la grande vertu de l’expérience (et j’entends ici le mot dans le sens que lui donne l’homme de laboratoire), c’est qu’elle livre la vérité, dussent notre sottise, notre manque d’imagination et nos préjugés, regimber. On ne sait jamais ce qui va sortir d’une expérience : elle donne la parole à la nature, et son principe même nous oblige à l’écouter en silence. Une des plus anciennes expériences de psychologie statistique est celle que Leuba, adversaire fameux, au début du siècle, de toute religion, conduisit parmi les savants américains (a).
Il voulait savoir s’il existait un rapport entre l’esprit scientifique et la foi. Il découvrit que la foi en Dieu et en la survie est d’autant plus répandue parmi les savants que leur spécialité relève davantage du laboratoire et de l’expérience. Par exemple, 44 % des physiciens croient en Dieu contre 24 % seulement des psychologues et 51 % des physiciens croient à l’immortalité contre 20 % des psychologues. Je doute que Leuba se fût attendu à ce résultat. Mais c’était un résultat expérimental. Il ne pouvait pas le contester. Il l’accepta et le publia, quitte à ratiociner pour essayer d’en minimiser la portée. Car si l’expérience est univoque, en revanche on ratiocine impunément 3.
Avoir peur de l’expérience, c’est craindre la vérité. Mais qui donc fait plus confiance à la vérité, qui donc aspire plus à sa révélation que celui qui sait qu’elle manifeste Quelqu’un et que ce Quelqu’un est amour ?
L’expérience est une grande maîtresse d’humilité. Elle apprend à être docile. C’est peut-être pour avoir longuement médité sur ce qui leur avait été dit de leur cou raide que les Juifs réussissent si brillamment en sciences (une vieille plaisanterie de Congrès scientifique affirme que les deux tiers des congressistes sont juifs, le troisième tiers étant constitué par la délégation israélienne).
Ratiociner voilà l’écueil
Pour cette raison, je crois que l’expérience scientifique dispose l’esprit à accepter l’expérience intérieure. Ce sont deux choses différentes, que les Anglo-Saxons désignent de deux mots distincts : experiment et experience. L’orgueil qui ferme à l’experience ne s’accommode pas davantage de l’experiment. L’experiment ouvre donc la voie à l’experience et c’est sans doute ce qui explique les résultats de Leuba.
Je me risquerai donc à cette prophétie sans grand mérite : que dans l’actuel renouveau de l’esprit religieux, la masse des réfractaires se recrutera toujours chez les ratiocineurs : philosophes, journalistes, politiciens, psychanalystes et autres techniciens du verbe. Et peut-être à cette autre à peine plus osée : que les idéologies hostiles à une interprétation religieuse des choses ne tarderont guère à dénoncer la malfaisance de la science 4.
L’homme est la mesure de toute chose 5.
Aimé MICHEL
(a) J.-H. Leuba : The belief in God and immortality (Boston, 1921).
Les notes de (1) à (5) sont de Jean-Pierre Rospars
(*) Chronique n° 78 parue dans F.C. – N° 1315 – 25 février 1972. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, chap. 18 « La science et sa méthode », pp. 475-477.
Pour aller plus loin :
- Au cours des semaines précédentes Aimé Michel a consacré cinq chroniques consécutives à la science des rêves, toutes reproduites ici. Il ne reviendra sur ce sujet que deux ans et demi plus tard dans la chronique n° 198, Quand le cerveau se déconnecte, in La clarté au cœur du labyrinthe, chapitre 7, p. 213.
- On a vu quelques exemples de ces « multiples techniques » utilisées en préhistoire dans la chronique n° 52, Sur un crâne de deux mille siècles, publiée ici le 11 octobre 2010. Yves Coppens en donne d’autres exemples : « Bien des gens se demandent, écrit-il, comment font les préhistoriens pour parvenir aux résultats qu’ils assènent comme si ces résultats avaient été aisément vus ou lus. Or il ne s’agit ni de facilité ni de magie, mais de recherches, parfois compliquées d’ailleurs, faisant appel à des pratiques mathématiques, physiques, chimiques, etc. Citons la biogéochimie isotopique qui permet la reconstitution de l’alimentation des hommes fossiles. (…) Citons encore la paléogénétique qui repose sur le décryptage de l’ADN nucléaire et mitochondrial. (…) Citons la paléodémographie qui fait feu de tout bois – le comptage des sites archéologiques (…) ou la prise en compte de la diversité des outillages lithiques réalisés (…) etc. » (Le présent du passé. L’actualité de l’histoire de l’homme. Odile Jacob, Paris, 2009, pp. 236-237).
L’histoire quant à elle a connu sa « révolution quantitative » à partir des années 1930 avec Lucien Febvre et Marc Bloch (les fondateurs de la revue et de l’école des Annales), Ernest Labrousse, Fernand Braudel, Pierre Chaunu et bien d’autres. Ces historiens délaissent les « événements historiques », grands hommes, batailles, traités etc., pour s’intéresser aux structures sous-jacentes opérant dans la longue durée, donc à l’économie, la démographie, la sociologie, le climat… Emmanuel Leroy Ladurie en donne l’exemple suivant, que je retiens parmi d’autres pour son rapport avec la présente chronique : « L’histoire psychologique elle-même a été contaminée, chez nous comme ailleurs, par le quantitatif. Cette histoire brillamment inaugurée par Lucien Febvre, [est] prolongée aujourd’hui par des hommes comme Jacques Le Goff, Robert Mandrou, Alain Besançon (…). Et dans ce domaine, déjà anciennement exploré, l’utilisation des méthodes quantitatives a représenté un cas classique de migration culturelle : venu de l’histoire économique et sociale, où il a donné plusieurs ouvrages importants, François Furet a appliqué au XVIIIe siècle les méthodes statistiques qui ont fait antérieurement leurs preuves en sociologie historique. Classant et ventilant, par genres divers, les dizaines de milliers de titres de livres qui furent publiées en France à l’époque des Lumières et jusqu’à la Révolution, Furet a pu quantifier, pas à pas, le processus de laïcisation, “d’évacuation du surnaturel” qui caractérise la conscience française au temps des philosophes. Dans le même ouvrage, Roche a donné pour la première fois une analyse quantitative d’un “milieu de culture” : le milieu académique provincial. Il a démontré statistiquement (entre autres choses) que les frontières du monde des Lumières passent à l’intérieur de la bourgeoisie ; elles excluent les manufacturiers et les négociants ; elles incluent au contraire, en communauté de culture avec la Noblesse, la bourgeoisie éclairée des grands Notables. » (Le territoire de l’historien, coll. Tel, Gallimard, 1973, pp. 33-34 ; l’ouvrage qu’il commente est Livre et société dans la France du XVIIIe siècle, de G. Bollème, J. Ehrard, F. Furet et D. Roche). Leroy Ladurie conclut : « à la limite (mais c’est une limite très lointaine, et qui dans certains cas est tellement hors de portée des recherches actuelles qu’elle n’est peut-être qu’imaginaire), il n’est d’histoire scientifique que du quantitatif. » (op. cit., p. 22).
- Le sondage de Leuba a été refait en 1996 par E.J. Larson et L. Witham (Nature, 386, pp. 435-6, avril 1997 et 394, p. 313, juillet 1998). Il indique que 39,3% des quelques 600 scientifiques américains ayant répondu au questionnaire (sur 1000 tirés au hasard) croient en un dieu personnel (au lieu de 41,8% en 1916) et 38,0% à l’immortalité de l’âme (contre 50,6% en 1916). Les mathématiciens sont les plus enclins à croire en Dieu (44,6%) ; les biologistes (30,5%) et surtout les physiciens et astronomes (22,1%) le sont beaucoup moins. Parmi les membres de l’Académie des Sciences (considérés comme « plus grands » savants), la croyance en Dieu (7,0%) est nettement plus faible, avec dans l’ordre : les mathématiciens (14,3%), les physiciens (7,5%), les biologistes (5,5%) ; pour la croyance en l’immortalité de l’âme, chez les académiciens les pourcentages sont respectivement de 7,9%, 15%, 7,5% et 7,1%. Il n’est pas question des psychologues dans cet article.
- Trente ans après, ce pronostic semble se réaliser. Tandis que la méfiance monte à l’égard de la science et que les universités scientifiques peinent à attirer les étudiants, on peut lire sous la plume du physicien Roger Belbéoch : « Ce qui est inacceptable dans les biotechnologies (et dans la science) c’est qu’elles représentent un énorme danger » (in R. Riesel : Aveux complets des véritables mobiles du crime commis au CIRAD le 5 juin 1999, Éd. de l’Encyclopédie des nuisances, Paris, 2001).
- Cette célèbre phrase du sophiste Protagoras d’Abdère (v. 485-v. 411 av. J.-C.) qui enseigna à Athènes d’où il dut s’enfuir sous l’accusation d’athéisme, se trouve dans le Théétète de Platon. « − Socrate. (…) Maintenant il s’agit d’examiner en commun si cette conception est solide ou frivole. La science est, dis-tu, la sensation ? − Théétète. Oui. − Socrate. Cette définition que tu donnes de la science, n’est point à mépriser : c’est celle de Protagoras, quoiqu’il se soit exprimé d’une autre manière. L’homme, dit-il, est la mesure de toutes choses, de l’existence de celles qui existent, et de la non-existence de celles qui n’existent pas. Tu as lu sans doute ces paroles ? (…). » On peut lire cette phrase de multiples façons. Un des auteurs favoris d’Aimé Michel, Sextus Empiricus, qui en donne une version un peu différente (« L’homme est la mesure de toutes choses, de celles qui existent et de leur nature ; de celles qui ne sont pas et de l’explication de leur non-existence ») l’interprète ainsi : « Protagoras a été rangé, lui aussi, par certains auteurs dans le chœur des philosophes qui ont détruit le critère de la vérité » puisqu’« il affirme, en effet, que toutes les représentations et les opinions sont vraies, et que la vérité est de l’ordre du relatif puisque tout ce qui est objet de représentation et d’opinion pour quelqu’un est immédiatement doté d’une existence relative à lui » (Contre les mathématiciens, VII, 60). En ce sens qui met en question le caractère universel de la vérité, Protagoras devient le père du relativisme. Anatole France en donne une interprétation fort différente que le physicien moderne ne renierait pas : « L’homme ne connaîtra de l’univers que ce qui s’humanisera pour entrer en lui, il ne connaîtra jamais que l’humanité des choses. »