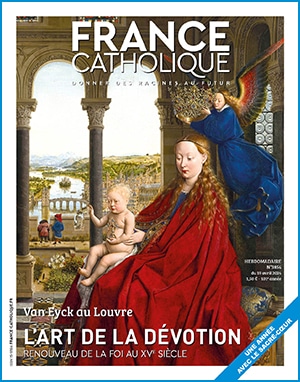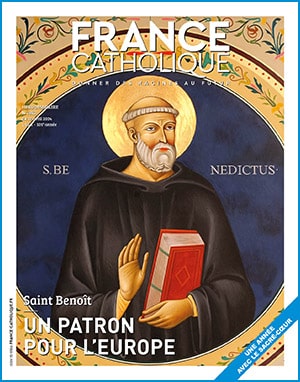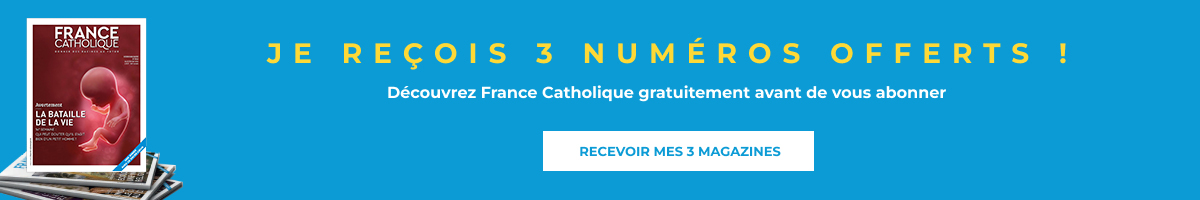7 NOVEMBRE
Carl Schmitt, ce théoricien, juriste de métier, passionne les catégories les plus diverses d’intellectuels : conservateurs et réactionnaires dont il est d’évidence le plus proche, mais encore des libéraux au sens classique – la famille aronienne par exemple – et jusqu’à des gens d’extrême gauche, fascinés par sa perception de l’essence du politique. Je l’ai toujours abordé avec la plus extrême prudence, faute d’avoir une connaissance exhaustive de son œuvre. Mais je l’ai lu suffisamment avec ses commentateurs les plus avertis, pour en percevoir l’intérêt, sans pouvoir me départir d’un certain trouble qui m’éloigne irréductiblement de lui. Et je ne fais pas seulement allusion à son engagement résolu dans le régime nazi à ses débuts, à propos duquel il n’a jamais émis de véritable regret. C’est sa pensée elle-même qui fait difficulté, y compris sur les points où je pourrais l’écouter attentivement.
Un seul exemple : la question de la décision en politique. La mission première de l’autorité est de prendre les décisions les plus graves dans les situations d’exception, lorsque repose sur elle la responsabilité directe. Ainsi Schmitt avait-il salué l’importance de l’article 16 de la Constitution de notre Ve République, qui accorde au Président des pouvoirs exceptionnels en cas de danger manifeste pour le pays. Il est des cas où le jugement doit être immédiatement porté, entraînant une décision qui s’applique sur le champ, sans délibération excessive qui pourrait s’avérer dilatoire.
Mais où commence et où s’arrête la situation d’exception ? N’y a-t-il pas risque de dérapage avec l’instauration de ce qu’on appelle aujourd’hui le pouvoir autoritaire ? Le goût de Schmitt pour des régimes tels que ceux de l’Espagne de Franco ou du Portugal de Salazar révèle à quel point on passe de l’exception à l’habitude. Il n’empêche que la question de départ est justifiée. La gauche française qui dénonçait l’article 16 (et le régime gaullien) ne s’est pas plainte de son utilisation au cours de la crise algérienne.
L’exception ne saurait justifier l’habitude. C’est en ce sens que j’admets la dénonciation d’une pente autoritaire de l’État – même si l’utilisation du mot me semble souvent abusive. Schmitt est représentatif d’une famille d’esprit qui est naturellement attirée par les solutions dictatoriales. Pourtant, les questions qu’il pose sont impératives. Qu’un Alain Finkielkrault y soit sensible est un signe intéressant. Il s’inscrit d’ailleurs dans une tradition prestigieuse (Raymond Aron, Julien Freund, etc.) C’est pourquoi j’ai lu la traduction française d’un essai paru en Allemagne sur la réception de Schmitt après la guerre (Carl Schmitt, un esprit dangereux, par Jan-Verner Müller, Calmann-Lévy). Très hostile, comme le titre l’indique, il n’en dit pas moins l’influence d’une pensée qui semble indispensable à ses adversaires pour confirmer leurs propres convictions.
Il est un thème que Müller n’élude pas et qui pourrait pourtant sembler un peu extérieur à une problématique purement politique au sens moderne. C’est celui de la théologie politique dont s’est réclamé Carl Schmitt déjà entre les deux guerres et qu’il a repris après-guerre. Un nom essentiel est rappelé à ce sujet, celui d’Erik Peterson, universitaire protestant, professeur de patristique, converti au catholicisme et devenu professeur à Rome où il mourut en 1960. Le père de Lubac l’évoque d’une phrase au début de ses Carnets du Concile : « Le P. Leclercq m’a annoncé la mort d’Erik Peterson, survenue il y a quelques jours ; depuis notre première rencontre en 1953 dans l’église St-Louis des Français et notre prière commune à St-Eustache, je l’aimais beaucoup. » (12 novembre 1960). Il y a un accord profond entre Lubac et Peterson sur un point essentiel : le refus de la notion de théologie politique et, dans la même logique, de l’idée d’un augustinisme politique qui aurait conduit à la conception médiévale d’une subordination du pouvoir politique au pouvoir théocratique.
En 1984, le père de Lubac avait réuni quelques études dans un volume intitulé Théologies d’occasion (Desclée-de-Brouwer). Dans la dédicace de mon exemplaire, il parle de « ce fourre-tout, ces vieilleries », mais les dites vieilleries m’avaient passionné et notamment toute la section intitulée Théologie politique où l’auteur défend, contre de fallacieuses interprétations, la légitime autonomie du temporel en démontrant que le pseudo augustinisme politique est complètement étranger à la pensée d’Augustin. Telle que celle-ci s’est exprimée surtout dans la Cité de Dieu. Or c’est exactement le thème d’Erik Peterson dans un texte fondamental qui vient d’être réédité chez Bayard : Le monothéisme, un problème politique. Dans le texte le plus important de ce recueil d’études, une simple petite note concerne Carl Schmitt, mais elle fut déterminante pour lui car, au demeurant, la démonstration de l’inadéquation de la théologie trinitaire avec une prétendue théologie politique rendait vaine toute sa théorie : « Le concept de théologie politique a été introduit dans la littérature par les travaux de Carl Schmitt, Théologie politique, Munich, 1922 – ces considérations, à l’époque, n’ont pas été exposées de façon systématique. Nous avons tenté ici de démontrer à partir d’un exemple concret l’impossibilité d’une telle théologie politique. »
Cette formule lapidaire, Schmitt la recevra, si j’ose dire, comme un direct à l’estomac, et il ne la digérera jamais. À ce point qu’on peut considérer qu’il répond implicitement encore à Peterson dans un autre livre publié dans ses vieux jours. Mais la querelle a une portée générale qui a rebondi avec les diverses théologies de la révolution ou de la libération, a priori étrangères à un théoricien conservateur mais qui ont un lien direct avec sa problématisation. Je voudrais pour le moment tirer de cela une première conclusion. Peterson est d’accord avec Schmitt sur la notion de décision, capitale en philosophie et en science politique mais il diffère de lui par son insistance quant à la différence entre la décision politique et la décision ecclésiale qui appartiennent à des ordres spécifiques. Une telle distinction est d’évidence pertinente à une heure où il y a danger d’absorption totalitaire du spirituel au travers d’une Reichthéologie, mais elle subsiste aujourd’hui avec une même évidence dès lors qu’il s’agit de penser la relation avec un cadre institutionnel démocratique. Le danger consisterait à effacer la décision spirituelle dans la moulinette de la délibération libérale qui met toutes les opinions à égalité. Non que le spirituel ait à redouter quoi que ce soit de la discussion rationnelle. C’est de la décision démocratique (aux voix) qui substitue le poids des suffrages à celui des arguments, que résulte le déni de légitimité du spirituel en lui-même. Sauf si est préservé le droit à l’objection de conscience qui est l’ultime digue de la liberté intérieure.
Peterson a donc raison de défendre le principe de la décision ecclésiale à l’encontre de l’imperium de la décision politique, fût-elle démocratique. Mais cette décision n’est justifiée que par une théologie trinitaire qui l’établit dans un autre ordre, à l’encontre d’un certain arianisme politique qui reproduit la divinisation païenne de l’État. J’aurais donc là-dessus une réelle divergence avec Bernard Bourdin qui a rédigé la préface du recueil de Peterson. Certes, il y a chez Schmitt une résistance au fait démocratique-libéral solidaire de sa théologie politique. Si son contradicteur ne semble pas prendre en compte cette dimension, c’est aussi que la dualité temporel-spirituel ne saurait être abolie dans le cadre démocratique-libéral. On le mesure aujourd’hui avec les incompatibilités éthiques qui opposent une morale purement procédurale à une morale pénétrée de principes anthropologiques.
20 NOVEMBRE
Il est d’autres raisons qui m’ont fait entrer dans la démarche d’Erik Peterson, notamment à travers sa correspondance avec Adolf Harnack : quelques lettres échangées en 1928 et suivies d’un « épilogue » qui tire la leçon de ce qu’on pourrait appeler un dialogue de sourds, avec cette nuance que les sourds ne sont pas dupes de leur surdité. Cette discussion rejoint pour moi la querelle à propos des textes de Rome qui contestent la dénomination d’Églises aux communautés issues de la Réforme. Peterson n’a pas encore franchi le pas qui l’amènera à entrer dans l’Église catholique (1930). Mais tout indique que, deux ans auparavant, il est dans une logique qui l’y mènera en toute rigueur. La discussion tourne autour de la nature de l’Église et Harnack lui écrit : « le protestantisme doit admettre sans hésitation aucune qu’il ne veut et ne peut pas être une Église comme l’Église catholique, qu’il rejette toute autorité formelle, et qu’il compte exclusivement sur l’impression qu’évoque en lui le message de Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. » à quoi Peterson répond que l’on ne peut échapper à ce qu’est et doit être l’Église et qu’il est inconséquent de vouloir poursuivre l’enseignement de la théologie si celui-ci n’est pas adossé à une autorité dogmatique : « Mais peut-on compter sur un intérêt pour l’histoire des dogmes si on a rayé la dogmatique ; si on a mis un terme à « l’autorité formelle » du dogme dans l’Église ? Quel peut être l’intérêt de l’histoire de l’Église une fois qu’il n’y a plus d’Église ? »
Cet échange se passe dans le contexte historique très précis de l’Allemagne et de son rapport avec la Réforme. Le cadre politique a longtemps assuré l’existence de l’Église luthérienne. Maintenant que ce cadre a disparu, le lien ecclésial risque de ressembler à celui des congrégations américaines ou autres conventicules. Mais, remarque Peterson, ce n’est pas ce qu’a voulu Luther, et si nous voulons revenir à ce qu’a voulu le réformateur, il faudrait revenir au XVIe siècle, ce qui est impossible pour des raisons pratiques et théologiques. Faute de quoi, c’est vers le statut de secte qu’on s’achemine.
Si j’en reviens aux polémiques actuelles, c’est-à-dire aux reproches amers d’une non reconnaissance par Rome du statut ecclésial du protestantisme, je me demande si le dialogue œcuménique et l’histoire récente – le pontificat de Jean-Paul II – n’ont pas produit une modification qui nous ramène au protestantisme ancien évoqué par Peterson. Quand celui-ci explique que ce protestantisme des réformateurs avait conscience de son lien dialectique avec l’Église-mère jusque dans ses excès polémiques. Il y avait une communauté de foi attestée par des références au credo de Nicée-Constantinople et rejet explicite de « toutes les hérésies et thèses introduites contre celui-ci dans l’Église ». Ne reviendrait-on pas à ce stade ancien, en contradiction avec le subjectivisme et l’œuvre de déliaison progressive consécutive à la dissolution du dogme et de la communauté de foi ?
23 NOVEMBRE
Grève des transports… Circulation difficile pour un banlieusard comme moi mais il me faut bien aller à Paris lorsque l’urgence et la nécessité font loi. Justement, il y a deux jours, j’avais trois rendez-vous parisiens : la vente des écrivains catholiques à la mairie du VIe arrondissement, face à St-Sulpice, une réunion le soir de l’autre côté de la place sur le Jésus de Benoît XVI, avec le père de Villefranche, organisée par l’association Sénevé, et enfin une rencontre avec des journalistes de France 3. Ils m’avaient téléphoné pour me demander un petit entretien sur le cardinalat de l’archevêque de Paris. Pourquoi ne pas se retrouver à la mairie du VIe ? Cela leur éviterait un déplacement plus périlleux…
N’empêche que le jour dit, il leur fallut près de deux heures pour venir depuis le siège de France-télévision dans le XVe jusqu’à notre point de rencontre… La mairie ne leur convenait pas comme cadre d’entretien. Pourquoi ne pas aller dans l’église St-Sulpice, malgré l’obscurité du soir ? Sitôt dit, sitôt fait. Mais il serait plus courtois de demander l’autorisation avant de filmer ! Un prêtre est en train de confesser. Nous ne pouvons le déranger. Les dames de l’accueil sont trop occupées. Nous nous adressons à un monsieur qui est sans doute sacristain. Aimablement, il nous laisse procéder à notre gré et nous nous retrouvons dans le déambulatoire où nous disposons deux chaises pour l’entretien. Celui-ci commence sous l’œil de la caméra… mais voici le prêtre, sorti de son confessionnal qui vient vers nous très vite, visiblement inquiet. Qui sommes-nous ? Que venons-nous faire dans son église ? Les explications vont le rassurer, mais la raison de son trouble est évidente. Depuis la publication du Da Vinci code, les prêtres et les laïcs de la paroisse n’ont cessé d’être importunés par des questions saugrenues de la part de groupes de touristes en visite initiatiques et par des reportages télévisés indiscrets si ce n’est tapageurs. Non, nous n’appartenons pas à cette cohorte insupportable.
Quant à la soirée sur le Jésus de Benoît XVI, elle m’a donné le goût de recommencer : l’attention du public à l’écoute surtout de la parole du Père de Villefranche était d’une qualité remarquable. Il faudrait souvent inviter les auditoires les plus divers à entrer dans cette recherche intime de l’essentiel.
25 NOVEMBRE
Etienne Fouilloux est un historien engagé, toujours intéressant. Plus proche de Congar que de Lubac – ce qui est quand même un programme. Mais sagace et maître de son sujet dont il sait évaluer la subtilité et les nuances. Son essai biographique sur le Père François Varillon (Desclée-de Brouwer) m’a captivé aussi bien à cause du personnage qu’il fait revivre que pour l’époque avec ses petites et grandes péripéties. Le religieux sort grandi de ce travail d’élucidation, parce qu’il apparaît en toute occasion, plus homme de Dieu que partisan au sens politique, même s’il est toujours trouvé proche des enjeux et des discussions du moment. L’idéologie n’était pas son fort et sa sensibilité littéraire (entre Péguy et Claudel) le gardait des tentations auxquelles n’ont pas échappé beaucoup de ses contemporains.
Associé étroitement à l’aventure de l’Action catholique, du côté des milieux indépendants, mais aussi de la direction de l’ACJF, le jésuite s’est trouvé en délicatesse avec l’épiscopat, notamment avec Mgr Guerry, archevêque de Cambrai et grand responsable de ce secteur. Comme la plupart des militants d’A.C. de cette période, il a été mendésiste, vouant à l’éphémère président du Conseil de la IVe République une admiration assez forte pour l’avoir vivement séparé de Remi Montagne, tombeur de Mendès-France à Louviers en 1958. L’affaire rompt une amitié profonde. Pierre Varillon était présent au mariage des Montagne à Clermont-Ferrand. Il n’est pas le seul à avoir vécu ce combat, dont Mendès-France ne s’est jamais relevé, comme une trahison. René Rémond, lors d’un entretien qu’il m’avait accordé à Science-Po, m’avait dit que sa rupture avec Remi Montagne avait été consommée à cause du même dissentiment. Leur amitié datait de la guerre, lors d’une rencontre mémorable, qui s’était tenue au Sacré-Cœur de Montmartre en 1942.
Il y a là un symptôme à analyser pour comprendre le destin de l’Action catholique et d’une sensibilité qui fut dominante dans le catholicisme de toute une génération. Le Père Varillon était trop spirituel pour être complètement lié à cette logique. Dans son Journal personnel, il décroche du politique dans la période post-soixante-huitarde et il est alors singulièrement soucieux de rappeler le cœur de la foi dans une démarche culturelle qui lui est familière. C’est aussi le moment où il se concentre sur son œuvre de théologien, avec les grands thèmes kénotique de la faiblesse et de la souffrance de Dieu, sur lesquels le Père de Lubac émettait quelques réserves.
28 NOVEMBRE
Je ne savais pas que le Père Varillon avait ainsi porté la contradiction à Marcel Légaut à un moment où ce dernier jouissait dans le monde catholique d’un sérieux prestige. Contradiction assez rude sur le fond, courtoise dans le face à face. Je n’ai pas pratiqué beaucoup Légaux qui m’a toutefois intrigué sans que je me passionne pour sa pensée. Je l’ai rencontré une fois dans les années 80, en Creuse, chez un curieux curé de campagne à la fois bûcheron, conducteur de car scolaire et théologien libre-penseur. Je n’affirmerais pas qu’il était le lecteur type de Légaux, qu’il avait l’air de bien connaître au point de l’inviter chez lui pour des exposés devant des auditoires de sympathisants.
Je suis bien incapable de résumer aujourd’hui les propos du berger mathématicien. Je me rappelle surtout mon effarement devant les conceptions liturgiques du prêtre invitant. Seuls les Évangiles avaient droit à la parole – si j’ose dire – durant sa messe. Saint Paul n’était pas autorisé à se faire entendre, sans doute parce que trop spéculatif et dogmatique. Je ne dis pas que ce prêtre était sans mérite et sans qualités. Mais je retrouvais chez lui ce que je redoute chez certains farouches anarchistes : leur liberté revendiquée ne va pas sans autoritarisme sur leur entourage ou leur auditoire dès lors qu’ils assènent leur propre système de pensée. J’ai souvenir d’interminables discours, plus longs que la liturgie où il officiait, et où il imposait son savoir « scientifique » à un auditoire frigorifié. Dehors, il gelait à pierre fendre. Encore une fois, je ne prétends pas qu’il était le disciple-type de Marcel Légaux. N’empêche que son cas est significatif d’une époque, d’un climat intellectuel encore dépendant des séquelles de la crise moderniste.