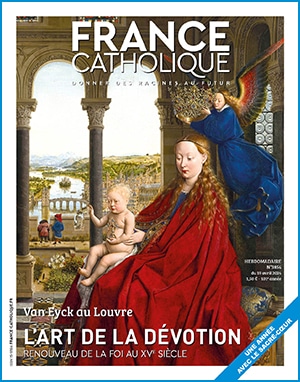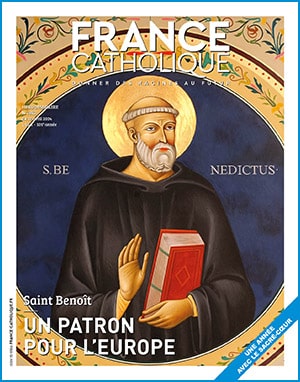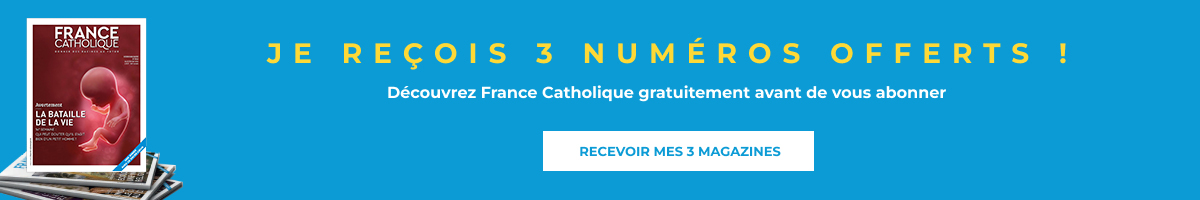La tristesse et le mal de vivre sont deux choses différentes. La première est instructive, le second destructeur. (J’ai réfléchi à cette opposition.) Un bon chrétien qui a perdu un camarade, un parent, un enfant, un ami intime pourrait être décrit comme « malheureux », mais ce serait maladroit. Le serait-il qu’il ne serait pas désespéré, il ne pleurerait pas le bien qui lui a été arraché. Il se sentirait plutôt déplorable.
La semaine passée, j’étais à Ottawa pour assister aux obsèques d’une amie très chère, l’épouse d’un bon camarade, mère de trois remarquables enfants, grand-mère d’une douzaine d’autres, et aimée de tant de personnes que les bancs de l’immense basilique Saint-Patrick, au centre-ville, étaient complets. Pour chacun de ceux que j’ai rencontrés, Mary était une sorte de « meilleure amie ».
Nous ne faisons pas d’éloge funèbre à l’église, ou tout du moins nous ne sommes pas censés en faire un, mais nous pouvons le faire dans des articles de magazine. Le mien se cantonnera à trois points. Mary était vraiment altruiste, profondément croyante et totalement saine d’esprit. Ce dernier point pourrait sembler une plaisanterie, venant après les deux autres. Mais non, une complète santé de l’esprit n’est pas si répandue que cela de nos jours.
Elle a souvent dû faire face à des circonstances qui auraient éprouvé la force d’âme de n’importe qui, et personne ne l’a jamais vu faiblir. Son catholicisme était solide comme le roc, immuable. Pourtant son empathie bienveillante et son humour la gardaient consciente des limites des gens. Elle regardait simplement à tout. Elle poussait les gens quelquefois, mais jamais plus loin qu’ils n’étaient capable d’aller ; ni sciemment dans une direction pénible.
J’ai mis en avant le fait d’être sain d’esprit en vue d’explorer cette notion de « bonheur ». Mary Scheer est un exemple que j’ai actuellement sans cesse à l’esprit, car elle était l’incarnation de la personne heureuse, et je dirais même obstinément heureuse. Elle recherchait et trouvait le bon dans chaque personne, même quand cela nécessitait une recherche poussée, et elle se nourrissait de tout le bonheur qu’elle trouvait dans ces personnes. Mais elle n’était aucunement évaporée.
Ce sont les choses que les catholiques sont censés faire – à supposer qu’ils aient été instruits dans le domaine de la foi – mais elles doivent être dures à apprendre, car ces qualités sont fort rares.
D’autres luttent, et j’admire leurs efforts. Ils se battent contre un monde devenu à moitié fou. Ou peut-être le monde a-t-il toujours été ainsi, je ne suis au courant que pour cinq générations au plus. A travers elles, cependant, j’ai observé un glissement, par lequel les normes de la civilisation chrétienne se sont visiblement effondrées.
Et il semble que toute satisfaction se soit évanouie avec cette chute ; que l’aptitude à prendre ce qui est offert a été confisquée ; que le mal de vivre s’est répandu comme un cancer.
La tristesse – la tristesse due à une perte personnelle – était bien connue de la génération de mes grands-parents, et également la souffrance, la privation, la tyrannie et le stress. Pourtant ces infortunes ne pouvaient affecter aussi profondément que maintenant, en raison de la foi en la religion reçue, sous-jacente dans la famille et chez les amis. Etant jeune, j’ai vu cela presque partout durant mes voyages, bien au-delà des frontières des anciens domaines chrétiens : une foi dans un ordre naturel des choses dans lequel tous (ou presque) pouvaient reconnaître l’ordre et la providence divine comme étant le cadre de toute vie humaine.
Malgré tout, les horreurs du vingtième siècle étaient inscrites en ceux qui étaient revenus d’une « guerre totale », et inscrites une nouvelle fois dans la génération de mes parents lorsqu’ils en ont connu une nouvelle. L’évitement de la réalité était écrite dans ma propre génération, celle du « baby boom », et un étrange gnosticisme est devenu la norme dans le consumérisme et l’évasion de la réalité d’une culture de médias, accentués par les drogues – des surfaces obturées devenues imperméables à la profondeur humaine. Les hommes sont devenus plats, sans envergure (voyez C.S. Lewis).
Inaperçu, quelque chose nous rongeait, non explicable par les événements. Les politiciens nous disent que nous sommes « en colère » en raison du chômage ou du manque de croissance économique ; parce que nous ne pouvons pas obtenir ce que nous voulons. Comparez si vous voulez la réponse à la Grande Dépression (NDT : la crise de 1929) avec nos réponses à des fardeaux bien plus légers.
Le mal de vivre que j’évoque va plus profond que ses possibles causes matérielles ; et même à la surface, je pense que le bruit, la laideur et le caractère impersonnel de nos redditions à plus d’effet sur nous que tout déficit de production.
Dans sa « mission » d’infirmière puis de femme au foyer, de mère et de secouriste là où on l’appelait, Mary Scheer s’est trouvé maintenir ensemble des petits morceaux du monde. Pour elle comme pour tant d’autres, la vie a été une action constante de sauvegarde contre tant de choses tombant en morceaux ; volant (souvent au sens propre) vers où on avait le plus besoin d’elle. Elle n’entretenait pas d’illusions.
A travers la clarté de son propre bonheur de vivre fondamental, elle discernait des choses difficilement évidentes pour d’autres. Tenace, je l’ai dit, dans son bonheur, elle pouvait voir que la plupart du temps, le mal de vivre était également obstinément voulu. Il brisait les mariages, dressait les générations les unes contre les autres, opposait l’ami à l’ami, invariablement en référence à des « problèmes » extérieurs alors que les causes étaient internes.
Nos exigences aigries pour « l’égalité » et autres du même acabit ne sont pas ce qu’elles semblent être. Elles se dissimulent derrière des concepts comme « le divorce sans torts » alors que les fautes crèvent les yeux. Nous avons ce phénomène démoniaque de l’époux insatisfait qui fait le malheur de son ou sa partenaire – même pas dans un but de revanche, mais comme un moyen d’accroître son propre malheur. Car les déracinés s’en prennent finalement à eux-mêmes.
Je donne cet exemple comme quelque chose de très commun, et pourtant non diagnostiqué. Je suppose qu’actuellement une grande proportion de la société nord-américaine est non-mariable et inapaisable ; que toute relation que ces gens noueraient (via la luxure) est vouée à l’échec. Souvent, c’est le cas pour les deux parties, et les portes de l’enfer sont ouvertes à tous. La société se désintègre autour d’eux. Les ressentiments s’accumulent et la grâce de Dieu est repoussée avec indignation.
Mary m’a un jour donné une description clinique de cette terrible maladie qui embrase notre société et qui dépasse l’égoïsme ; elle m’a également parlé de son seul remède. En saine conviction, on devrait « choisir le bonheur ». C’est presque équivalent à « choisir la vie ».
David Warren est ancien rédacteur du magazine Idler et chroniqueur de Ottawa Citizen. Il a une profonde expérience du Proche-Orient et de l’Extrême-Orient.
Illustration : « Les saintes femmes au Tombeau » par William-Adolphe Bouguereau, vers 1900 [collection privée]
Source :https://www.thecatholicthing.org/2017/03/17/the-cure-for-unhappiness/
Pour aller plus loin :
- Le défi du développement des peuples et le pacte de Marrakech - la fuite en avant des Nations Unies
- Mots codés et fausses questions
- Vladimir Ghika : le contexte politique avant la guerre de 1914-1918
- Quand le virtuel se rebelle contre le réel, l’irrationnel détruit l’humanité
- La France et le cœur de Jésus et Marie