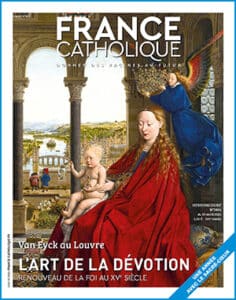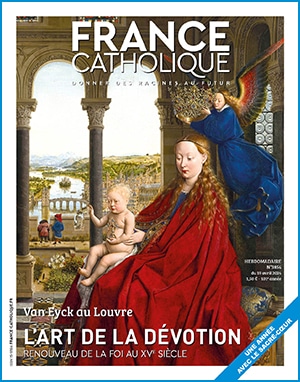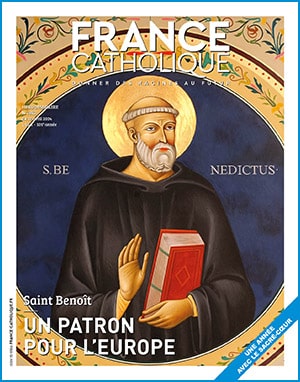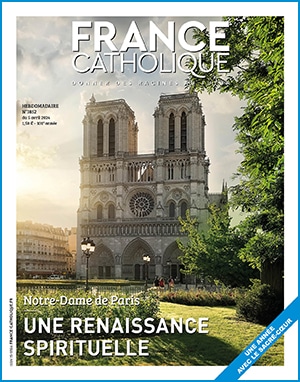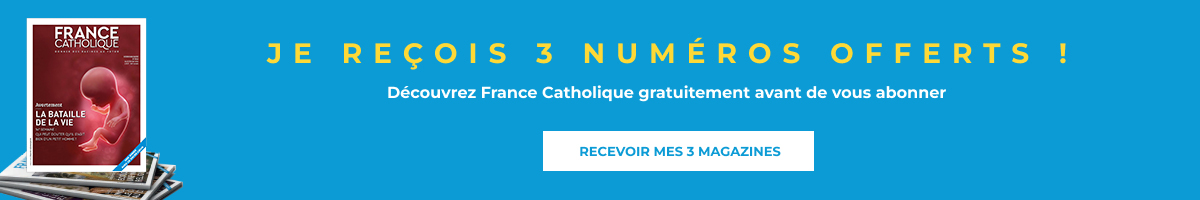Il y a tout juste deux siècles, à quelques mois d’intervalle, mouraient les deux vrais maîtres des temps modernes : Rousseau et Voltaire.
Les deux vrais maîtres, bien plus révolutionnaires et puissants sur nos esprits et sur l’histoire que Marx et Freud, qui règnent, certes, du moins un moment encore, mais sur les ruines laissées derrière eux par les deux grands idéologues du XVIIIe siècle.
Je ne sais plus qui a écrit que Rousseau, « du moins, demeure dans un XVIIIe siècle complètement déchristianisé comme le dernier pitoyable témoin du Christ ». Il est vrai que quand je lis la Profession de foi du Vicaire savoyard (dans l’Émile)1, je me dis, comparant avec tant d’homélies anarcho-éco-freudo-marxiste, qu’il me faut comme vous écouter sous les voûtes de nos églises et même à nos enterrements2 : « Comme il parle bien ! quel bon chrétien ! quelle belle religion ! quelle piété ! », tant il est facile de toujours trouver des comparaisons consolatrices. Plût au ciel que l’on nous fît toujours des prêches aussi chrétiens que celui du Vicaire !
[|*|]
Mais dans la Profession de foi du Vicaire Savoyard, les contemporains ne virent pas ce qui restait du christianisme : ils ne virent que ce qui en était effacé, et avec quelle éloquence !
De plus, cette Profession ne pouvait être lue séparément. Comme Rousseau le répète sans cesse dans ses Confessions et encore plus dans le Contrat social, sa pensée forma un tout, « il ne peut pas dire tout à la fois », tout se tient, et il faut tout lire.
Il faut lire d’abord et surtout le Contrat social, puisque c’est la société que Rousseau entendait renouveler.
Le Contrat, avec son style de Code civil, a toutes les apparences d’un Traité. On croirait lire un Chat fourré plus éloquent qu’il n’est ordinairement permis à un Chat fourré. Puissance insondable du génie ! On lit le Contrat, on est emporté par sa logique oratoire, on croit n’avoir retenu qu’elle, on se croit converti à des idées, et que s’est-il passé en vérité ?
Il s’est passé ceci qu’au-delà des idées seules exprimées, on sort de cette austère lecture le cœur à jamais transformé par un sentiment, ou plutôt un ressentiment : que si la société est malade, boiteuse, injuste, criminelle, il est facile de la transformer – précisément en se conformant aux principes si simples et évidents du Contrat – que si cette réforme si raisonnable se heurte à des résistances, c’est parce qu’il peut y avoir parmi les hommes des ennemis du peuple, et que ces ennemis du peuple, il faut « les tuer », c’est expliqué bien clairement (Livre II, chap. 5).
Le Contrat expose avec la dernière clarté les deux principes fondamentaux de toutes les Terreurs de l’histoire depuis deux siècles, et en particulier les deux principes irréfutables du stalinisme :
1. La société « idéale » doit détenir une « puissance souveraine », qui n’a « nul besoin de garant envers ses sujets parce qu’il est impossible que le corps veuille nuire à ses membres ».
2. Inversement (et par voie de conséquence), celui qui s’oppose à la puissance souveraine est un « malfaiteur », la conservation de l’État « est incompatible avec la sienne, il faut que l’un périsse », ils sont mutuellement en état de guerre, « et c’est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu ».
Plus que toutes les autres utopies historiques réductrices de l’homme, le Contrat est tellement évident, tellement irrésistible que je défie le lecteur qui se fait une âme, disons du milieu du XVIIIe siècle, effaçant de son esprit toute la suite de l’histoire, oui, je le défie de ne pas sortir de sa lecture transporté d’enthousiasme et désireux de faire descendre sur terre cette société si facile à établir, si simple, si juste, si gratifiante. Comment des âmes nobles et grandes – je pense surtout au tout jeune Saint-Just – eussent-elles pu y résister, ne pas se laisser entraîner à tout sacrifier pour un idéal si beau, si parfait, si rédempteur d’une histoire jusque-là criminelle ?3
Le jeune lecteur du Contrat, s’il sentait en lui le désir des nobles entreprises, ne pouvait pas ne pas s’engager dans le fatal engrenage dont le terme inévitable était la sainte Guillotine dressée en permanence sur la place de la Concorde pour y extirper l’« ennemi du peuple ».
Si la poésie est l’art de remplir le cœur d’un élan irrésistible, jamais exprimé mais présent sous tous les mots, le Contrat social est un des plus grands poèmes de l’humanité. Se sentant étranger dans son siècle, dit Michel Mourre, Jean-Jacques se dressa seul orgueilleusement contre une société et une civilisation, et il les brisa.
[|*|]
Malheureusement pour l’histoire, heureusement pour nous, l’homme n’est pas ce que croyait Rousseau.
L’homme n’est pas un bon sauvage que corrompent les sciences et les arts.
Il est un être spirituel, ni ange ni bête, et qui se cherche en gémissant dans l’aube d’une lumière longue à s’établir – une lumière qui vient d’ailleurs[Cette définition est directement inspirée de Pascal qui, comme on l’a déjà signalé, affleure partout dans ces chroniques.]].
L’homme « naturel » de Rousseau n’existe ni n’a jamais existé. Même l’Homme de Neandertal ensevelissait ses morts en les couvrant de fleurs, preuve qu’il ne croyait pas à l’effacement de l’âme par la corruption du corps. Pour faire tenir l’homme-tel-qu’il-est dans la société de Rousseau, il faut couper tout ce qui dépasse, c’est-à-dire la tête. Ce qu’on ne tarda pas à faire allègrement avec l’aide du bon docteur Guillotin.
[|*|]
Comme c’est curieux après deux siècles sanglants occupés à couper et inlassablement recouper tout ce qui dépasse4 – en vain, en vain, cela repousse toujours, même au tréfonds glacé des Goulags – je lis Voltaire avec reconnaissance et amitié, lui qui jusqu’au seuil de la mort dénonça en Jean-Jacques…
cet ennemi de la nature humaine.
Voltaire a rassemblé sur sa personne tout le ressentiment des malheureux sur qui le siècle s’effondra, et qui dans son « hideux sourire » crurent reconnaître celui de Méphisto.
Pour moi, je ne trouve pas que son sourire soit « hideux ». Certes, il a écrit l’ignoble Pucelle5, il a consumé ses forces à vouloir « écraser l’infâme ». Mais je ne pense pas qu’un seul lecteur de ce journal, revenant au XVIIIe siècle aurait la moindre envie de défendre ce que Voltaire voulait écraser, les petits abbés intrigants et corrompus, les grands prélats mécréants et cyniques uniquement préoccupés de leurs revenus et de leur ambition, et même ce qu’il appelle « l’orgueil infernal des Jésuites ».
Voltaire mentait tant qu’il pouvait, il poussait des clameurs d’agressé qu’on égorge dès qu’un de ses adversaires s’avisait de riposter ; il prêchait noblement la libération des esclaves en plaçant son argent chez les négriers, sa correspondance, tant vantée, est insupportable par son ton de perpétuelle flatterie, « caressant et cajoleur » disait Rousseau – sauf quand il peut cogner impunément – bref, Voltaire est un bon pécheur moyen, plein de petitesse.
Mais toute sa vie il s’est élevé contre les faiseurs de système, dénonçant sans jamais se lasser leur sanglante influence, toujours il prêcha l’indulgence, la douceur des mœurs, la « tolérance ». À Ferney, il voulut avoir pour ses paroissiens un bon vrai curé enseignant le catéchisme, et lui-même, donnant l’exemple, allait à la messe ! Personne ne lit plus Voltaire, et le lecteur aura peine à croire ce que je vais dire : il serait facile, de son œuvre immense, de tirer un livre profond sur l’amour de Dieu, sur la contemplation, sur l’adoration divine, presque aussi épais que les Pensées de Pascal !
Voltaire n’a jamais su résister au plaisir de polissonner, de chahuter au fond de son siècle comme au fond d’une classe mal régentée.
Mais il n’a jamais fait que rire et faire rire. J’avoue toujours le relire en riant (sauf la Pucelle… mais rappelons-nous que Jeanne ne fut canonisée qu’après la victoire française de 1918). Oh ! ce n’est pas un auteur édifiant. Il est très vain de lui-même. Il n’a pas la « vertu » de Jean-Jacques (qu’il ne faut d’ailleurs pas examiner de trop près – s’il nous reste du temps pour examiner celle des autres après avoir donné à la nôtre l’attention nécessaire).
Mais Voltaire eut le pressentiment des excès de la « vertu » rousseauiste6. Il ne lui manque sur le paysage tragique du XVIIIe siècle que d’être mort trop tôt pour se faire guillotiner comme ennemi de cette « vertu » sanglante, dont le fantôme aveugle et hagard continue, deux siècles après, de moissonner les hommes avec sa longue faux.
Aimé MICHEL
Chronique n° 305 parue dans F.C. – N ° 1629 – 3 mars 1978. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, Aldane, Cointrin, 2008 (www.aldane.com), pp. 387-389.
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 12 août 2014
- La Profession de foi du Vicaire Savoyard (1762) forme une partie importante du livre IV de l’Émile, mais écrite à part et clairement délimitée par un intertitre (http://sami.is.free.fr/Oeuvres/rousseau_savoyard.html). Rousseau y développe une réflexion métaphysique sur le Monde, Dieu, l’Âme, le Mal qui sert de soubassement aux propositions concrètes pour remédier au Mal par l’éducation des individus dans l’Émile et par la réforme de la société dans le Contrat social. Rousseau y fonde une religion « sans temples et sans autels, sans rites, bornée au culte purement intérieur du Dieu Suprême et aux devoirs éternels de la morale », fondée sur la conscience, cet « instinct divin » en nous qui juge du bien et du mal. C’est un rejet ferme du matérialisme et de l’athéisme : Dieu existe, l’homme est libre, la conscience est infaillible, l’âme est immortelle ; le mal provient intégralement de la liberté de l’homme, mais de l’homme en société, non de l’homme à l’état de nature. Aux religions révélées, diverses, intolérantes, fondées sur des miracles, le Vicaire préfère une religion naturelle, sans dogme, sans prières, sans prêtres, prônant la tolérance universelle. (Le propos de Rousseau sur le christianisme dans le Contrat social montre au demeurant qu’il n’entendait pas grand-chose à l’Évangile : « Le christianisme, y écrit-il, est une religion toute spirituelle, occupée uniquement des choses du ciel ; la patrie du chrétien n’est pas de ce monde.(…) Pourvu qu’il n’ait rien à se reprocher, peu importe au chrétien que tout aille bien ou mal ici-bas. »)
L’Émile fut condamné non seulement à Paris par le Parlement, la Sorbonne et l’Église mais aussi à Genève par le Petit Conseil. Rousseau trouva refuge près de Neuchâtel où il demeura deux ans (1763-1764) sous la protection du roi de Prusse. C’est là qu’il écrivit contre ses détracteurs les Lettres écrites de la montagne dont il a déjà été question à propos du miracle dans la chronique n° 160, La science et le mystère – Rousseau, Gödel et Saint Vincent de Paul (mise en ligne le 18.07.2011).
- Au tournant des années 70 de nombreux prêtres se laissèrent tenter par un certain activisme politique. Aimé Michel a fait plusieurs fois allusion à cette période de confusion, voir par exemple la chronique n° 6, Zadig, la rose et les imans de Babylone, mise en ligne le 20.07.2009.
- Cette capacité à « transporter le lecteur d’enthousiasme » est une caractéristique des grandes œuvres. Ce serait bel et bon si les grandes œuvres étaient capables de nous apporter une explication exacte de la vie et du monde mais il n’en va pas ainsi. Rousseau n’est qu’un exemple et son influence pernicieuse un symptôme parmi d’autres de la grande difficulté de l’esprit humain à décrire le monde réel et donc à agir sur lui. Jean Fourastié dans son maître livre Les conditions de l’esprit scientifique (coll. Idées, Gallimard, Paris, 1966) confirme et généralise les remarques d’Aimé Michel :
« [L]es grandes œuvres humaines, écrit-il, celles auxquelles vont l’admiration et le prestige, ne sont pas celles qui décrivent le réel ou s’accordent à lui, mais au contraire celles qui séduisent l’esprit humain par une imagination originale, fût-elle arbitraire, affirmée par une forte volonté, dans une forme brillante. En somme notre jugement sur nos œuvres est indépendant du réel ; nous n’avons pas de référence extérieure ; nous ne jugeons nos œuvres que par d’autres œuvres et nos jugements eux-mêmes que par d’autres jugements. » (p. 73)
« Ces grandes œuvres élisent certains aspects du réel au détriment de millions d’autres, et les développent, souvent monstrueusement, jusqu’à leur donner l’apparence de constituer à eux seuls tout le réel. Tout ce qui s’écarte de la ligne imposée, tout ce qui gêne la logique étroite de leur construction mentale, elles font plus que le nier, elles le saccagent, elles en décrètent la destruction.
Et nous, lecteurs bien sages, nous admirons, parce que c’est beau, parce que c’est émouvant, parce que c’est fort. Et en général parce que nous admirons, nous croyons, nous adhérons. (…) Et lorsque le lecteur ne se contente pas de chercher dans ces œuvres prestigieuses de l’émotion, de la distraction, l’évasion du réel ; quand justement il y cherche et croit y trouver une information valable sur le réel, alors les déceptions commencent. Les défauts d’adéquation de la pensée à l’action se révèlent en effet alors, et alors seulement. L’état politique, social et technique du monde actuel, après 50 000 ans qu’il y des hommes, et qui pensent, ne laisse, je le pense , aucun doute sur cette inadéquation.
Les grandes catastrophes naissent de la conjonction de la violence politique et de la foi philosophique : “L’humanité qui se massacre n’oserait plus le faire pour ses seuls intérêts. Des intérêts, elle ne s’en vante point, mais elle se vante de ses idées qui sont mille fois plus meurtrières.” Et nous savons aujourd’hui que la guerre internationale à laquelle pensait Romain Rolland n’est qu’un cas particulier (en général, si l’on peut dire, moins atroce) des guerres civiles et des dictatures (…). » (pp. 102-103).
Alors quelles solutions demanderez-vous ? D’abord prendre conscience de ces infirmités de la raison humaine ; recourir quand on le peut à la seule méthode qui ait fait ses preuves pour connaître la réalité sensible, l’esprit scientifique expérimental, et à la philosophie, la morale et la religion quand ses lumières ne suffisent plus ; s’armer de patience et de tolérance, seules adaptées à la diversité des hommes et à la complexité du monde… - Rousseau n’a pas été le seul à vouloir faire le bonheur du genre humain pendant ces deux siècles : ses successeurs s’appellent entre autres Marx, Staline, Hitler, Mao. Il ne faut pas y voir seulement de l’histoire ancienne : il y a et il y aura d’autres utopies car c’est une tentation permanente de l’esprit humain. Comme c’est un thème constant de réflexion d’Aimé Michel nous aurons l’occasion d’y revenir.
- Dans La Pucelle (composée en 1738, publiée en 1762) Voltaire prend Jeanne d’Arc pour cible et la ridiculise en n’hésitant pas à recourir à la pornographie. Cette « épopée » fut fort admirée de son temps ; d’ailleurs Beaumarchais et les Encyclopédistes tenaient Jeanne pour une « idiote » manipulée par des fripons et Montesquieu n’y voyait qu’une « pieuse fourberie ». Curieusement ce sont des poètes étrangers, l’Anglais Robert Southey et l’Allemand Friedrich von Schiller qui les premiers défendent Jeanne et en font une héroïne romantique. Le poème de Schiller, La pucelle d’Orléans (Die Jungfrau von Orleans), composé en 1801, trouve le ton juste pour dénoncer la raillerie de Voltaire :
La pucelle d’Orléans
Pour ravaler la noble image de l’humanité,
la raillerie t’a traîné dans la plus épaisse poussière :
l’esprit moqueur est en lutte éternelle avec le beau ;
il ne croit ni à l’ange, ni au dieu ;
il veut ravir au cœur ses trésors, il combat l’espérance et blesse la foi.Mais, issue, comme toi-même, d’une race candide,
pieuse bergère comme toi, la Poésie te tend sa main divine ;
elle s’élance avec toi vers les astres éternels.
Elle t’a entourée d’une auréole ;
le cœur t’a créé, tu vivras immortelle.Le monde aime à noircir ce qui rayonne et à traîner le sublime dans la poudre.
Mais sois sans crainte !
Il est encore de belles âmes qui s’enflamment pour ce qui est élevé et grand.
Que Momus divertisse la halle bruyante ;
un noble esprit aime de plus nobles figures.Une note du site où j’ai trouvé ce poème (http://www.larecherchedubonheur.com/article-3182271.html) ne dit pas qui en est le traducteur mais précise que Momus est le dieu de la raillerie, des « malicieuses critiques et des bons mots » et qu’il est représenté levant son masque et tenant à la main une marotte, symbole de la folie.
« Le monde, note Schiller, aime à noircir ce qui rayonne et à traîner le sublime dans la poudre ». Pour Aimé Michel qui partage ce jugement, cette « sottise de l’intellect et du cœur », cette « mesquinerie des sots à qui on ne la fait pas » doit bien servir à quelque chose puisqu’elle forme « le fond de l’espèce, sa majorité ». N’empêche, ajoute-t-il, « je hais cet esprit, y compris quand j’ai le dégoût de le trouver en moi. Je le hais en pensant que tout ce qu’il y a de bien en nous monte du sang prodigue de nos rêveurs rayés de l’histoire pour cause de sublimité. (…) Si notre médiocrité ne nous aveuglait, peut-être comprendrions-nous que (…) l’histoire est d’abord une sublime aventure où les héros et les petits ont travaillé plus que les sots occupés à les regarder crever en ricanant. » (L’apocalypse molle, lettre du 28 août 1981, op. cit., pp. 221-222). - Au nombre des pressentiments de Voltaire on pourrait compter cet avertissement : « Tremblez que le jour de la raison n’arrive ! » qui termine l’article « Abbé » de son Dictionnaire philosophique (Garnier-Flammarion). Mais il faudrait pour cela l’isoler de son contexte qui est d’annoncer la disparition des « abbés » : « vous avez profité des temps d’ignorance, de superstition, de démence, pour nous dépouiller de nos héritages et pour nous fouler à vos pieds, pour vous engraisser de la substance des malheureux : tremblez… ».