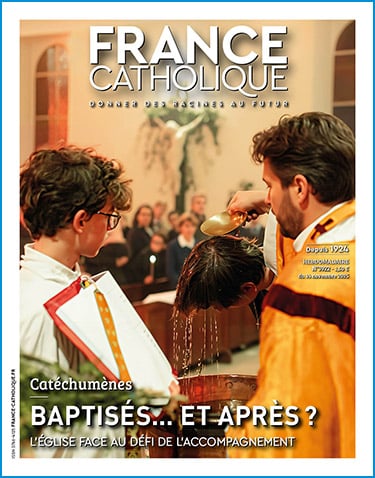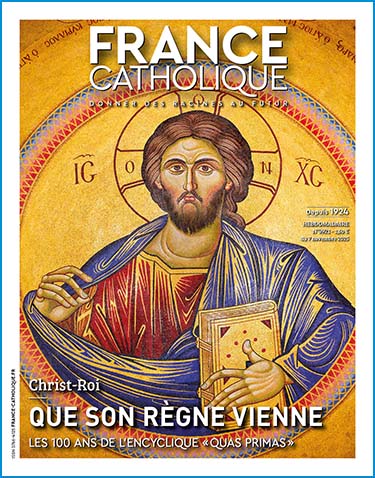Au cours d’un entretien suivant l’attentat du 11 septembre, on demandait à Joseph Ratzinger son avis sur la théorie de la « guerre juste ». Extrait de sa réponse :
« À mon avis, les réponses apportées par la tradition chrétienne sur ce sujet méritent d’être mises à jour en raison des nouvelles méthodes de destruction et des nouveaux dangers encourus. Par exemple, une population n’a aucun moyen de se défendre contre une bombe atomique. Il faut donc tout revoir.»
Bien que craignant de mal interpréter la pensée de ce grand homme, je suis frappé par l’idée sous-entendue de préemption. Dieu le sait, il ne s’agit pas d’une sorte de blanc-seing pour toute intervention imaginable que tel ou tel dirigeant envisagerait, et je ne pense pas qu’il s’agisse de justifier de quelque manière que ce soit l’attaque que le Président Obama envisage pour punir le régime Assad d’avoir employé des armes chimiques contre les « rebelles ».
On discutera toujours de la décision prise en 1945 par le Président Truman d’employer l’arme nucléaire contre le Japon. Selon les documents auxquels j’ai eu accès, M. Truman était convaincu que les bombes le dispenseraient d’un débarquement genre « Jour-J » susceptible de coûter la vie d’un million d’Américains. Dieu seul sait combien de vies de soldats et civils japonais auraient été enlevées. (il y eut environ 250 000 victimes à Hiroshima et Nagasaki). Évidemment, nous ignorons ce qui se serait passé en cas de débarquement — qui n’a pas eu lieu.
Autre temps, nul ne songe à une bombe atomique sur Damas. Mais nous pouvons admettre — à part les autres possibilités offertes au Président Truman (et les conséquences prévisibles) — qu’il a pris une décision pleine de prudence. Ce n’était pas une ruse, qui n’est que fausse prudence.
En fait, la décision de Truman répondait à presque tous les principes de la théorie de la « juste guerre », sauf un: la proportionnalité. Comme dans le cas du bombardement incendiaire de Dresde, en Allemagne, on a peine à voir comment le choix de l’objectif (bien que militairement significatif) se justifiait devant l’importance de la population civile.
Je peux bien soutenir, même à contre-cœur, le Président Truman (facile, il s’agit d’événements survenus avant ma naissance, et ayant abouti à la réconciliation avec le Japon et l’Allemagne), parce que la paix résultait de ses décisions.
Alors, comment juger Obama et la Syrie ? Selon l’Administration gouvernementale, l’affaire n’est pas très pure, il s’agirait d’éliminer (ou d’en empêcher l’emploi futur) les armes chimiques. Bien que je croie à la compétence des services de la Présidence des USA (et guère à celle des Nations Unies) je ne suis pas persuadé qu’une action isolée dans le cas de la Syrie soit sensée, particulièrement — selon un argument-clé de la théorie de la « juste guerre » — quand la sécurité de notre nation n’est pas en cause. En fait, comme aime à le rappeler un de mes correspondants, la Syrie n’est qu’un épiphénomène. (Ce qui pourrait changer si un jour l’Iran brandissait la menace nucléaire contre Israël).
Où que soient entreposées les armes chimiques dont dispose Assad, et quels que soient les pays d’où elles proviennent (ainsi que toutes autres armes de destruction massive) chaque entrepôt est vraisemblablement protégé par un bouclier humain de civils, rendant improbable une attaque américaine proportionnelle. Ou efficace, et il y a des tas de raison pour le croire.
Je suis de plus en plus convaincu que dans une guerre il ne faut que très rarement, sinon jamais, prendre des demi-mesures — et jamais, au grand jamais, se livrer à des gesticulations futiles. Les plans de M. Obama — si on peut appeler « plan » son charabia noyé dans l’anxiété, et celui de ses collaborateurs, de ses ministres Kerry et Hagel — semblent établis pour ne rien faire susceptible d’encourager la paix dans la guerre civile syrienne, mais en fait attiser les flammes d’un conflit dont on ne sait où il va.
Et, à propos — quel que soit le discours gaucho-rosâtre du Sénateur McCain — qui sont donc ces rebelles opposés au gouvernement Assad? On s’inquiète d’avoir rencontré l’ennemi, oui, l’ennemi. Comme précédemment au Caire. Nous n’avons guère de talent pour choisir le bon cheval. Comme actuellement à Kaboul. Lors des conférences éditoriales de la « National Review », James Burnham (décédé deux ans avant que j’y travaille) écoutait ce genre d’affaires « perdant-perdant » chaudement débattues autour de la table, puis concluait : « Eh bien, mesdames et messieurs, s’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de problème.»
Ce qui peut paraître cynique, mais à mon avis, c’est du simple bon sens.
Tout catholique devrait, et pas seulement à la messe du dimanche, prier chaque jour pour la paix. Le Pape nous l’a demandé. Et nous devrions prier pour le Président Obama, afin qu’il prenne une décision de prudence, et non pas politicienne.
Dans son ouvrage La grande croisade sur la Seconde Guerre mondiale, H.P. Willmot remarque que le lâchage de la Mandchourie par les Occidentaux— en ne renforçant pas les traités avec la Chine — contre l’invasion japonaise en 1931 était une incitation à la guerre mondiale. Hitler vit que la Mandchourie était abandonnée aux vents de l’histoire, et en fut encouragé pour envahir les Sudètes. Soixante millions de morts, résultat de quinze années de massacres.
On a discuté en 1991 avec la guerre du Golfe, pensant qu’il ne s’agissait que de pétrole. Lors d’une émission avec la National Review j’expliquais que l’avenir de la paix était en jeu, comme dans les années 1930, et qu’il fallait penser qu’un simple tison flottant au loin dans la brise pourrait tomber sur une mèche et enflammer le monde. Ce qui pourrait se produire en Syrie (je ne le pense quand-même pas).
Et le seul motif pour un bombardement préventif en Syrie serait la prévention d’une troisième guerre mondiale, ce que nul ne voudrait envisager.
Triste constatation, l’unique superpuissance mondiale s’est produite dans un spectacle affligeant de faiblesse. Ce qui pourrait nous coûter fort cher à l’avenir.
Photo : Les rebelles.
Source : http://www.thecatholicthing.org/columns/2013/syria-two-arguments-why-to-say-no.html