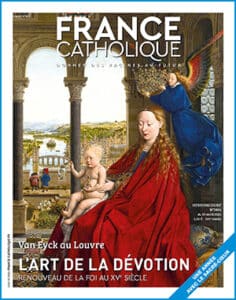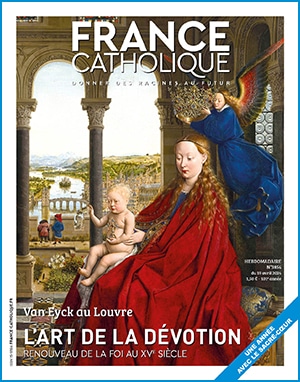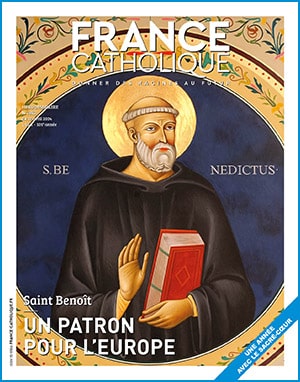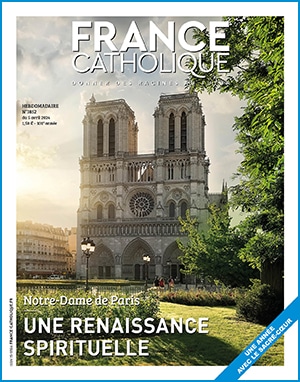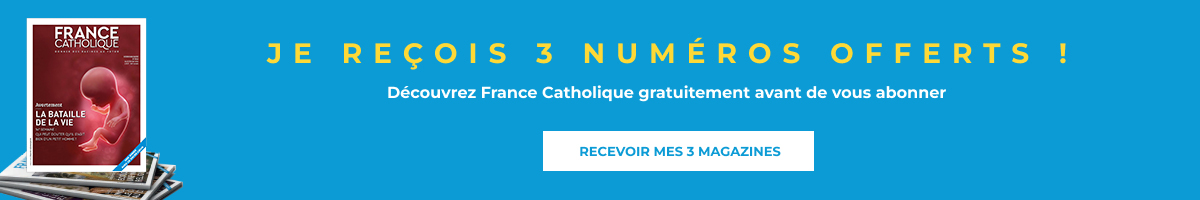La Belgique pourra-t-elle se relever de la terrible crise politique qu’elle vit depuis de longs mois ? Avis d’un célèbre journaliste flamand et francophone…
Entretien avec Luc Beyer de Ryke
Votre histoire familiale est significative. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Je suis né à Gand. Cette ville a vu naître trois hommes célèbres : Charles Quint, Maeterlinck, écrivain francophone des Flandres qui reçut le Prix Nobel de littérature et De Geyter qui a composé la musique de l’Internationale.
Pour ma part, je suis Flamand de langue française. Je suis né dans une ville, où la « bonne société » était divisée en salons catholiques et salons libéraux ; ils se sont ensuite mélangés face à la montée du flamingantisme. J’appartiens par ma famille à la bourgeoisie libérale : mon grand-père et mon père étaient chirurgiens. Mon père est mort jeune et ma mère s’est remariée avec un avocat professeur à l’université de Bruxelles, assesseur au Conseil d’État et bâtonnier à Gand. Mon grand-père maternel était magistrat. Je suis le « mouton noir » de cette famille puisque je suis devenu journaliste !
Présentateur du journal télévisé de la RTBF pendant 18 ans, j’ai été au cours de cette même période conseiller provincial de Flandre orientale et pendant 14 ans conseiller municipal de Gand où la loi m’interdisait de prononcer un mot de français.
Que sommes-nous aujourd’hui, nous francophones de Flandre ? Rien !
Vous avez fait vos études en quelle langue ?
À l’exception d’un passage de deux années à l’Athénée, j’ai fait mes études en français uniquement. À Gand jusqu’à la fin du secondaire puis à Bruxelles dans l’enseignement supérieur. Dans ma ville natale, j’ai commencé avec les Dames de l’Instruction chrétienne, qui était encore une école francophone, puis je suis allé chez les Frères des Écoles chrétiennes où l’on étudiait également en français. Ensuite ce fut l’enseignement public, à l’école moyenne, puis je suis entré à l’Institut de Gand, qui était une école libre mais non catholique, où les cours de latin, de grec et de français étaient donnés par des professeurs français dépêchés et payés par le Quai d’Orsay.
Aucun Belge ne pourrait faire aujourd’hui le même parcours scolaire en Flandre. Autre impossibilité : au cours de ma vie politique, j’ai été élu dans toutes les régions du pays – à Gand puis à Uccle où je suis toujours conseiller municipal. J’ai été élu comme parlementaire européen dans une circonscription qui regroupait Bruxelles, la Wallonie et le petit territoire de langue allemande. Aucun Belge ne pourrait aujourd’hui être successivement élu par des citoyens appartenant aux trois groupes linguistiques du pays. Sauf, pour l’instant encore – mais pour combien de temps ? – dans le dernier arrondissement bilingue, celui de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Comment expliquez-vous la crise politique qui a gravement affecté la Belgique dans les derniers mois de 2007 ?
Cette crise s’inscrit dans un long processus. Mon livre* commence avec la fameuse émission de la RTBF annonçant l’indépendance de la Flandre. En France, on a parlé de canular. Mais cette émission de fiction était plutôt un acte politique. Son animateur, Philippe Dutilleul, est connu en France grâce à l’émission « Strip-Tease » : il m’avait parlé de son projet et songeait à moi pour présenter l’émission spéciale. Il voulait faire prendre conscience de la situation critique dans laquelle la Belgique se trouvait – et je ne pouvais lui donner tort. Mais j’étais circonspect, je craignais une « prédiction créatrice », l’annonce fictive de la séparation provoquant un choc conduisant à l’éclatement réel du pays. J’ai différé ma réponse, en pensant que cette émission ne serait pas avalisée par la hiérarchie. Je me trompais : le présentateur en titre du journal télévisé a accepté de jouer son propre rôle dans la fiction et toute la hiérarchie a participé à l’émission.
Sa diffusion a provoqué une onde de choc : 80 % des auditeurs francophones ont cru à la véracité de la nouvelle car le scénario était déjà dans toutes les têtes.
Chacun savait que tous les dossiers communautaires seraient mis à plat après les élections et que, par conséquent, la formation d’un gouvernement serait extraordinairement difficile. L’émission n’a pas créé la crise mais elle a contribué à son emballement.
Venons-en à ces dossiers communautaires. En France, on ne se rend pas compte de ce que peut signifier leur remise à plat.
Je commencerai par la fin. Du côté francophone, l’écrasante majorité des citoyens ne veut pas la division du pays. Les francophones, bruxellois ou wallons, veulent le statu quo et beaucoup ont la nostalgie de la Belgique d’autrefois.
Les Flamands veulent une profonde réforme de l’État. Mais la majorité des néerlandophones n’est pas séparatiste : seule une minorité – il est vrai importante – milite en ce sens. Mais l’écrasante majorité souhaite un approfondissement du confédéralisme. Or ce confédéralisme est de plus en plus un séparatisme de facto. Nombre de Flamands veulent que la Sécurité sociale soit coupée en deux, que l’organisation judiciaire soit elle aussi scindée, certains voudraient des plaques d’immatriculation différentes pour les automobiles : la volonté de vivre séparément sous un label commun est flagrante. J’ai souvent entendu dire dans des milieux flamands qui ne sont pas nécessairement extrémistes : « Avec la Belgique si l’on peut, sans la Belgique s’il le faut ».
Démocrate-chrétien, Premier ministre pendant douze ans, père du fédéralisme, Wilfried Martens croyait que le fédéralisme était un processus qui trouverait un jour son achèvement. Il se trompait : le processus ne peut être arrêté.
La Belgique a maintenant un gouvernement…
Guy Verhofstadt a réussi un tour de force en mettant sur pied un gouvernement transitoire : il durera jusqu’au 23 mars, date à laquelle Yves Leterme devrait lui succéder. Ce dernier, entouré d’un groupe de personnalités politiques qualifiées de « sages », est en train de préparer des réformes institutionnelles. Nul ne sait ce qui se passera lorsqu’il sera en mesure de les présenter.
Dans l’histoire de la Belgique, quels sont les facteurs qui expliquent ce processus ?
Le premier, c’est bien évidemment la révolution de 1830 et la constitution de l’État belge. À ce propos je précise que la fête nationale belge ne célèbre pas la révolution du 21 juillet 1830 mais le 21 juillet 1831, date de la prestation de serment du premier roi des Belges, Léopold Ier, marié à Louise-Marie, fille de votre roi Louis-Philippe.
Il est important de souligner que cet État est né d’une révolution bourgeoise et qu’il va être gouverné en français du nord au sud : toute la classe intellectuelle, les médecins, les magistrats… sont francophones. Il n’y a pas alors une langue flamande unifiée mais des patois qui balkanisent cette partie de la Belgique.
Le deuxième fait important, c’est la guerre de 1914-1918. Avant d’écrire mon livre, j’ai rencontré des personnalités de toutes les obédiences et de toutes les communautés. Quand je parlais à des Flamands, y compris à de jeunes Flamands, tous évoquaient la Grande Guerre. Pour résumer en une phrase sans doute excessive mais qui est pour les Flamands d’une criante vérité : sur le front, on commandait en français et on mourait en flamand.
C’est pendant la première guerre mondiale qu’un petit cercle d’intellectuels flamands se lie à l’Allemagne wilhelminienne. Celle-ci pratique la Flamenpolitik : le gouverneur allemand Von Bissing crée la première université flamande à Gand : on y parle flamand mais on y pense en allemand. Cette université disparaîtra en 1918 mais dans l’entre-deux-guerres on assiste à une montée impressionnante du mouvement flamand. Certains de ceux qui avaient collaboré avec les Allemands pendant la guerre de 1914-1918 reprendront la politique de collaboration pendant la seconde guerre mondiale – par exemple Auguste Borms, fusillé en 1946. Après la Libération, la répression sera dure et les blessures resteront profondes dans le mouvement flamand.
Il y eut des collaborateurs, non des moindres, chez les francophones !
Léon Degrelle fut le chef de la division SS-Wallonie. Mais que reste-t-il du rexisme aujourd’hui ? Rien. La Collaboration flamande, quant à elle, n’était pas liée à un homme mais elle est beaucoup plus profonde et étendue que la Collaboration francophone.
Vous accordez une grande importance à l’éclatement de l’Université de Louvain…
Que l’on soit catholique ou non, le traumatisme créé par la division entre l’Université de Louvain-la-Neuve et l’Université de Leuven reste profond. Louvain était une des plus prestigieuses universités catholiques du monde ! Souvenons-nous du slogan de l’époque qui est aujourd’hui repris : Franse ratten rol uw matten (rats français roulez vos tapis !) On a divisé la bibliothèque en numéros pairs et impairs – les uns allant aux francophones, les autres aux néerlandophones. Péché contre l’esprit !
La monarchie maintient malgré tout l’unité ?
C’est vrai et c’est faux. Je reprends la formule célèbre d’un ancien Premier ministre socialiste, Achille Van Acker, qui était très hostile au roi Léopold pendant la Question royale : « La Belgique a besoin de monarchie comme de pain ».
Sans monarchie, la Belgique cesserait d’exister dans les huit jours. En République, se poserait immédiatement la question du chef de l’État : un président wallon, flamand, bruxellois ?
Cela dit, la monarchie ne suffit plus à préserver l’intégrité de la Belgique. Nous sommes dans un régime de particratie absolue. Le roi ne nommera jamais un ministre qui n’aurait pas l’aval des partis. Le roi Albert n’a pas l’influence qu’avait le roi Baudouin grâce à l’expérience qu’il avait acquise au cours de son long règne. Le roi des Belges est en mauvaise santé et sa succession n’est pas assurée car le prince Philippe a débordé de son rôle, par exemple en critiquant le Vlaams Belang, en signant un document patronal ou en prenant publiquement à partie des journalistes flamands. Pendant la Question royale, 70 % des Flamands étaient favorables à la monarchie, alors que maintenant une importante minorité souhaite une République flamande.
Le sort de Bruxelles est-il lié à la Wallonie ?
Bruxellois et Wallons ne s’aiment pas beaucoup. Les Flamands considèrent que Bruxelles est la capitale de la Flandre et ils voudraient partir en annexant la ville et en accordant des facilités aux francophones bruxellois. Le morceau est sans doute trop gros, mais l’intention est clairement exprimée.
Les francophones constituent entre 85 et 90% de la population – dont 44% sont d’origine belge. La proportion des immigrés, dont beaucoup sont citoyens belges, est donc importante. Cela permet aux Flamands d’affirmer que Bruxelles est une ville multilingue dans laquelle on compte 10% de néerlandophones mais aussi des anglophones, des arabophones, etc. Pour eux, c’est une grande ville internationale en territoire flamand.
Tout cela est exagéré mais il est vrai que Bruxelles est sur la ligne de front. Nous avons autour de Bruxelles les communes « à facilités ». Bruxelles est totalement encerclée par des territoires flamands et les communes « à facilités » sont composées d’une très forte majorité de francophones (entre 70 et 80%). Jusqu’ici ils disposaient de « facilités linguistiques » en matière administrative, juridique et politique (voter par exemple pour des candidats francophones). Mais les Flamands les remettent en question et de toute manière exigent que les délibérations municipales soient prises en langue flamande : s’il y a un mot de français, les décisions sont annulées par la tutelle.
Frank Vandenbroucke, le ministre flamand de l’éducation, qui est socialiste, écrit que la loi ne lui permet pas encore de régir l’usage de la langue dans le domaine privé. Je connais des communes où les commerçants ne peuvent pas présenter leurs produits en français et où il est interdit de vendre un terrain à une personne ne connaissant pas le flamand. À Fouron, il a été décrété que l’usage du français constituait un « trouble à l’ordre public ». Voilà où nous en sommes.
Pour en revenir à Bruxelles, je remarque que la capitale est prise dans le mouvement général de communautarisation : les Bruxellois se sentent avant tout bruxellois, plus que belges. Certains d’entre eux souhaitent que leur ville devienne un district européen.
La Wallonie n’est pas aussi unie qu’on le croit. Si la Flandre fait sécession, il y aura une République flamande et non une unification avec la Hollande. La province wallonne du Luxembourg est attirée par le Grand Duché alors que les Liégeois sont francolâtres.
Comment voit-on cette crise dans les institutions de l’Union européenne ?
Avant d’écrire mon livre, je suis allé au Comité des régions où l’on m’a tenu des propos officiels qui ne me renseignent pas vraiment sur la politique européenne : « On encourage les régions mais dans le cadre des États » m’a-t-on dit. Mais si j’en juge d’après un entretien avec Hubert Védrine, la Commission, en encourageant financièrement les régions, a « joué avec le feu ». Aujourd’hui, devant ce qui se passe en Belgique, elle est inquiète. Elle se souvient que son siège se trouve à Bruxelles. On la sent prise entre son désir de « régionalisme » et la crainte de voir des mouvements nationalitaires tels les Catalans et les Basques durcir leurs revendications. « L’Europe aux cent drapeaux » voulue par l’indépendantiste breton Yann Fouéré est une image poétique, mais aussi l’incertitude attachée au morcellement et à l’éclatement des Nations qui transformerait l’Europe en habit d’Arlequin.
Luc Beyer de Ryke, « La Belgique en sursis », éd. François-Xavier de Guibert, 165 pp., 15 e.
Vient de paraître également, de Pol Vandromme : « Belgique, la descente au tombeau », éditions du Rocher, 106 pp., 14,50 e.
Pour vous abonner en Belgique, contactez Emmanuel Kerkhove, chaussée de Dottignies 50 – 7730 Estaimpuis, tél. 056 330585 – compte bancaire 275 0512 029 11